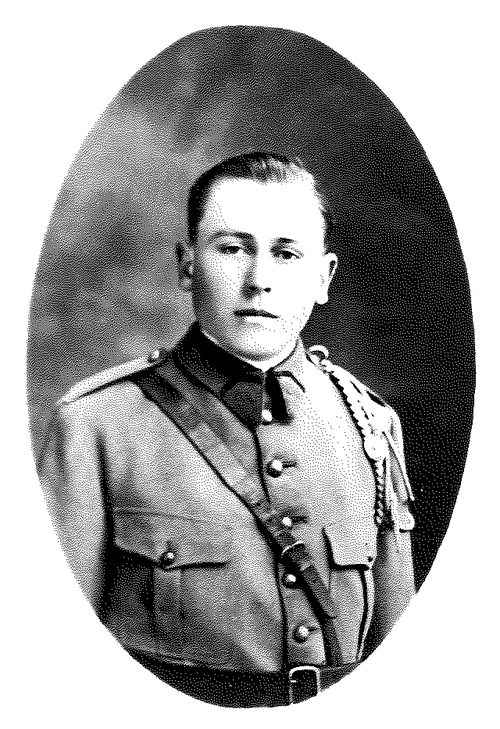-
Il est cinq heures et demie, Guy-Michel me réveille et m'annonce la bagarre, j'entends d'ailleurs encore les derniers coups de feu. C'est simplement un groupe de reconnaissance allemand composé de deux autos dans lesquelles sont huit soldats qui, attirés par les fréquents parachutages, est venu voir ce qui se passait et s'est heurté au feu de nos FM. Nous en avons tué quatre, fait prisonniers trois, dont un grièvement blessé et le dernier s'est échappé avec une des voitures.
Sans plus faire attention à cet incident, je vais, avant la messe qui est à huit heures, voir les chauffeurs qui s'affairent autour de leurs jeeps descendues comme eux du ciel, cette nuit. Ils montent des fusils mitrailleurs dessus car toutes les mitrailleuses se sont écrasées au sol. Pourtant, avec les débris de plusieurs, un caporal parachutiste arrive à en reconstituer une. Pendant ce temps, tout en les regardant et en les questionnant, je mange presque une boite entière de bonbons vitaminés qu'ils viennent de me donner.
Et voici la messe. C'est l'aumônier du camp qui la dit. Nous y assistons très nombreux. Après l'évangile, le prêtre nous dit quelques mots :"il ne faut pas parler de vengeance, mais de revanche ; ils ont gagné la première manche, nous gagnerons la seconde avec l'aide de Dieu. Préparons-nous au combat". A peine la messe finie, je n'ai pas seulement le temps d'aller dire bonjour à Victoire et à ses filles et de déjeuner que la bataille commence. L'allemand échappé est parti avertir à Ploërmel et ce sont plusieurs compagnies allemandes qui arrivent à l'attaque. Nos gars sont prêts, derrière les taillis et ils les attendent fermement.
L'effervescence règne au camp. Chacun s'agite et la mitraille se poursuit sans arrêt. Au premier assaut, les FFI en ligne ont eu peur et partaient déjà, mais le lieutenant Marienne était là, qui les a remis en place, je peux dire "à coups de pieds dans le derrière". Les allemands tombent comme des quilles.
Revenons au camp. Dans notre groupe des "plantons", ou "agents du GG", nous n'avions pas encore été armés et notre chef, le lieutenant Colineaux, assisté du Sergent Pretseille, y procèdent. J'ai toutes les peines du monde à obtenir une carabine. Heureusement, j'avais la permission de maman. Le pauvre Guichou n'y parvient pas et pleure à chaudes larmes ; mais il vaut bien mieux ainsi. Comme armement, on me donne une carabine américaine, merveilleuse arme légère semiautomatique et dont la précision est très appréciée.
Me voici à l'œuvre, aidé par Guy, dans notre cabane des plantons en train de nettoyer nos armes et de faire nos provisions de munitions. Je sors et rencontre le capitaine Puech-Samson qui n'a pas l'air très content de me voir ainsi habillé et armé. Il m'appelle et me dit : "Loïc, avec quelle permission ?". Celle de maman, mon capitaine ... et aussitôt, il me fait un grand sourire et me dit : "Bon, eh bien, viens avec moi à la bagarre, tu as deux minutes". Je vais vite embrasser mon petit guy-guy qui pleure encore, le pauvre gars, de me voir partir et de rester seul. Mais le commandant Bourgoin s'en occupe et va le faire partir avec les Pondart à qui il a donné l'ordre de quitter "la Nouette". Je les embrasse eux aussi, ils sont pleins de courage et les voilà qui s'en vont à travers champs, laissant tout.
Les allemands n'ont pas fait un pas et les commandants Bourgoin et Morice nous ont bien donné l'ordre de ne pas avancer afin qu'il y ait le moins de perte possible, mais seulement de maintenir fermes les positions. Je pars enfin de mon côté, avec le capitaine, vers les Hardis, Bois-Joli et Sainte-Geneviève, afin de contacter avec les bataillons engagés (deux) et de transmettre les ordres. Il n'a pour toute arme que deux grenades et force jumelles, cartes, crayons, papiers, etc... Je suis très fier d'être son garde du corps, comme il m'a dit, et je fais claquer les vieilles bottes de grand-père, que j'ai adoptées.
Avant d'arriver aux Grands Hardis, nous voyons le commandant Le Garrec qui commande le bataillon engagé, devant la Nouette. Tout va bien dans son secteur, aussi, nous continuons sur le Bois-Joli où il semble que la poussée soit la plus forte. Il faut ramper car les balles sifflent de tous les côtés. Arrivés aux Grands Hardis, on a vraiment l'impression qu'on rentre dans le bain ; le capitaine donne plusieurs ordres et nous continuons.
Un peu avant le Bois-Joli, je trouve une mitraillette chargée, abandonnée, que je donne au capitaine. Puis, nous obliquons à droite, derrière des haies, à quelques trente mètres des boches. C'est palpitant, la première ligne de nos fusils mitrailleurs se trouve à 5 mètres en arrière, à côté du petit bois à moitié en feu, auquel nous avons abouti. C'est un tonnerre du diable et sans arrêt on entend des rafales de FM et force coups de fusils, etc... Ces cochons de boches ont installé une mitrailleuse lourde dans le clocher de Saint-Marcel et elle nous gêne et nous arrose bien.
Pendant ce temps, par la radio, nous avons demandé que des avions viennent détruire et mitrailler les observatoires de Villeneuve, Saint-Marcel (le clocher de l'église) et Plumelec. Le capitaine inspecte à la jumelle et Loïc accroupi est à côté de lui, prêt à le défendre. Nos fusils mitrailleurs tirent sans arrêt tout à côté de nous et j'en ai les oreilles déconfites. Soudain, des coups crépitent et nous sifflent aux oreilles. Je tire quelques coups, mais le capitaine me dit :"Loïc, je suis touché", et il tombe. Je me précipite vers lui et constate avec un autre parachutiste venu lui aussi en le voyant tomber; que c'est une blessure à la cuisse, sans gravité.
Je lui fais avec un vieux bandage un pansement tant bien que mal, puis, alors que le parachutiste le ramène derrière la haie et le remet en train, je reprends ma carabine et fou de joie de tirer dans ces cochons et anxieux pour mon capitaine, je m'amuse une minute. Puis il faut ramener le capitaine au camp. Nous ne sommes pas très loin de la petite route Saint-Marcel - Serent qui passe près de la Nouette et où sont nos autos mitrailleuses. Aussi, chacun d'un côté, nous l'aidons à marcher. Il est d'un courage magnifique et aux petits FFI qui le voient passer traînant la patte, il leur dit pour ne pas les démoraliser : "ce n'est rien, je me suis simplement foulé le pied en sautant un fossé, allez, du courage mes petits".
Nous arrivons enfin et une jeep devenue ambulance nous transporte au camp à l'infirmerie où le médecin FFI Mahéo (ou Sassoun) le soigne. Toujours d'un courage magnifique et exemplaire, mon capitaine subit une piqûre dans le ventre qui a dû lui faire un "tout petit peu mal", mais il ne dit mot. Puis je raccompagne le capitaine dans la chambre de la ferme servant de PC. Là, sont les commandants Bourgoin, Morice, Le Gouvello, les capitaines Guimard, Brunet, etc... Il s'allonge sur un lit et, sur sa demande, je m'allonge moi aussi à côté de lui. Je suis lassé et un peu impressionné et je fais un petit somme, alors que la mitraille continue toujours.
Vers trois heures, je me lève et suis chargé par Émile Guimard de fermer les armoires des Pondart. Obligation bien difficile à remplir car, sur les trois armoires, je m'aperçois qu'aucune ne peut fermer. Apercevant un joli petit mouchoir blanc, brodé, je le prends avec l'intention de le donner à son propriétaire en souvenir. À ce moment-là, je savais déjà que nous devrons décrocher ce soir, faute d'arme lourde.
Soudain un vrombissement ; 12 avions arrivent vers nous. Ce sont nos mosquitos tant attendus. En voilà déjà un qui pique sur Villeneuve, suivi du bruit sec de sa mitraille. C'est maintenant le clocher repère qui est mitraillé. Les troupes allemandes, devenues plus nombreuses, sont désemparées et leur feu ralentit. Mais ce n'est pas pour longtemps, car aussitôt les avions repartis, ça recommence de plus belle.
Je m'en vais un moment du PC et vais avec Xavier, un très chic type, Pierre et Marie, nettoyer nos armes dans la maison de cette pauvre et vaillante madame Salles, partie elle aussi il y a quelques heures. Nous buvons en même temps une dernière de ses bouteilles, puis, les aumôniers arrivant, nous causons cinq minutes avec eux. Je reviens vers mon capitaine qui, maintenant assis, s'occupe de faire taper des ordres. Le Bataillon Caro qui est établi en la ferme de Bois Séjour est en réserve et ne se bat pas, ainsi que toutes les troupes se trouvant vers la route "Malestroit-Sérent".
Tout marchait bien quand, soudain, éclatent dans la cour de la ferme plusieurs coups de feu, suivis d'une fusillade beaucoup plus proche. Aussitôt, des FFI partent vers le lieu d'où viennent les coups, c'est-à-dire vers Bohal. Les allemands, en effet, ayant bien repéré nos positions, ont fait un détour et attaquent maintenant de ce côté là encore. Ils se sont installés sur la petite colline du bois de Behellec et ne s'en font pas. Heureusement, les postes avancés, constitués par des parachutistes, les reçoivent comme il faut et les allemands tombent là comme dans tous les autres coins, c'est-à-dire par dizaines. C'est le poste du lieutenant Ranfast, premier parachutiste arrivé au camp, qui fait le plus beau travail : ils ont quatre fusils-mitrailleurs, et il faut que je cite les noms de : Crizik, De Aima, Gérard, Chilou.
Il est maintenant six heures et demie du soir. Le capitaine ne veut pas que je retourne me battre car la mitraille est tellement forte que ce serait un réel danger. Je me contente de faire des petites liaisons et d'aider de mon mieux le capitaine et les autres officiers en les faisant boire et manger. En effet, il ne reste plus une femme au camp. Elles ont toutes été évacuées.
Nous préparons maintenant le départ, le décrochage se fera à minuit et en même temps toutes les munitions et armes que l'on n'aura pas pu emporter en camion sauteront. D'ailleurs, le capitaine charge le sergent Charles Decrept de préparer ses charges et de faire sauter le tout. Nous devrons tous partir en colonnes ou par petits groupes au Château de Callac qui se trouve à peu près à 15 kilomètres de la Nouette. Nous devrons tous nous y retrouver demain matin et nous nous y reformerons.
Pendant ce temps, le lieutenant de Camaret, accompagné de 20 parachutistes, part à SainteGeneviève où la situation est plus critique. En effet, les allemands, voyant de très loin les grands murs blancs du château s'y acharnent, croyant trouver là les chefs de ce "maquis" et, pourtant, les FFI ne sont pas aussi forts là que devant La Nouette. Le temps passe vite et la nuit, déjà, tombe. Par un émissaire, nous apprenons que les allemands ont été repoussés du secteur de Sainte-Geneviève, vers Saint-Marcel.
Le capitaine me prend à part et me dit : "Comme blessé et ne pouvant pas marcher, je vais partir en jeep. Je n'ai pas de place pour toi, mon petit Loïc ; tu vas partir à pied avec les commandants et je suis sûr que nous nous retrouverons tous les deux demain matin". Je m'étais bien juré de ne plus me séparer de mon capitaine, mais je n'osais pas résister afin qu'il ne crût pas que je voulais aller en jeep. Je fis donc mon petit bagage et suivis le commandant Bourgoin. Je dis au revoir une dernière fois au capitaine et, peu après, vers 9 heures et demi, nous partîmes, direction "Serent".
Nous nous arrêtons dans des fossés, à 800 mètres de la ferme de la Nouette, pour attendre la compagnie Cadoudal. Pendant ce temps nous sommes un peu repérés et, de la colline d'en face, les allemands nous tirent dedans. Ça me fait une drôle d'impression d'entendre les balles siffler dans les champs de blé. Puis, tout à coup, une sorte de petite explosion, suivie de plusieurs autres… Elles paraissent très proches ; ne sachant ce que c'est, je me blottis dans le fossé et serre bien fort contre ma poitrine cette carabine que je suis si heureux de porter. Les bois de monsieur Philippe sont en feu ; ça produit un curieux effet, alors que la nuit approche. Plusieurs autres qui étaient avec nous dans les bois partent dans une "citron" pilotée par Jean Grignon et Lili Fochou, deux braves ; ils emmènent le commandant Bourgoin qui, s'étant foulé la cheville en descendant au sol l'autre soir, ne peut pas marcher. Je lui refile ma petite valise dans laquelle sont mes habits civils, ça me fera toujours ça de moins à porter.
Enfin, voici Cadoudal et nous partons ; nous sommes quatre à cinq cents à la file indienne le long des chemins et au demi-clair de lune qu'il y a cette nuit, ça fait une impression bien particulière. Je suis entre Gilbert Énain et Jacques Quitelier, parachutistes radios, très chics.
Nous voici maintenant sur la grande route après avoir longtemps suivi des chemins détournés. Mais, qu'arrive-t-il ? Une grande lueur illumine toute la campagne, puis c'est une énorme explosion ; je me jette dans le fossé, comme tous les autres d'ailleurs, ce doit être les munitions qui sautent, il est minuit et demi. Nous obliquons dans un petit chemin, mais les autres ne suivent pas ; le guide va voir ce qui se passe et ne revient pas. Nous attendons, blottis dans le fossé, quand une autre lueur est suivie d'une autre grande explosion : toujours les armes et munitions qui sautent. Le lieutenant Wagner envoie Gilbert vers la route nationale, mais l'ayant rejoint, il nous avertit que la colonne est perdue. Ce qui fait que nous sommes dix, dont neuf parachutistes et un patriote, le gars Loïc, qui ne connaît pas du tout la région. Nous repérons quand même un chemin et partons vers Callac après avoir consulté une carte. Nous traversons des bois, longeons des haies, traversons des fossés, toujours sous le clair de lune et aussi prêts à recevoir les boches.
Nous arrivons ainsi près de grands ravins quand, tout près de nous, des voix, des bruits de pas très nombreux, etc... Qui est-ce ? Des FFI, des boches ? Pour plus de sûreté nous ne nous faisons pas remarquer et restons tous les dix, seuls. Puis des maisons nous apparaissent, alors le lieutenant m'envoie frapper à la porte car, n'ayant pas d'uniforme, je me ferais moins remarquer. Ce bon lieutenant oublie sans doute que j'ai des bottes aux pieds et que sous ma veste sont cousus tous mes insignes de parachutiste et autres... Je pose donc mes armes et pars en bras de chemise frapper à la porte. Rien ne répond, il est une heure du matin et les gens doivent avoir une belle peur à cause des explosions de tout de suite et de la mitraille de toute la journée.
Que faire ? Nous nous penchons de nouveau à la lueur de nos lampes sur nos cartes, mais ne trouvons rien ; de tous côtés des bois, une route, quelques maisons, un petit ravin et un ruisseau dans le fond. Ajoutons à cela la lune et un beau ciel, voilà un paysage magnifique et féerique. Nous continuons, cette fois-ci, à travers la forêt ; pas loin de nous patrouillent des cosaques mais tout va bien, et ne sachant où nous sommes nous décidons de dormir là en attendant le jour. Ce qui fut dit fut fait et me voilà allongé, la tête appuyée sur une racine et grelottant car il ne fait pas chaud.
Je dors quand même un peu, quant, à 4 h et demi, réveil. De l'autre côté de la forêt, nous apercevons un fermier et les parachutistes m'envoient lui demander des renseignements. Je repars donc en bras de chemise et fais un peu partout des points de repère. Arrivé à la maisonnette, je frappe, personne. C'est alors que de derrière le tas de fagots j'aperçois un pauvre bougre, tremblant, qui s'approche. Il ne peut presque pas répondre à mes questions tellement il a peur de moi. Cet homme a couché dehors, ayant peur que, par suite des explosions, sa maison ne tombe par terre. Callac, d'après ses maigres renseignements, doit se trouver à 4 kilomètres à l'est. Je repars trouver les autres, mais plus personne. Pourtant je siffle l'air : "Sur le pont d'Avignon" et, enfin, Gilbert se lève de derrière un talus. Les autres sont partis et lui est resté m'attendre. Je me rhabille et nous partons quand le lieutenant Loïc Ranfast, Petit chef, et une vingtaine de parachutistes, passent sur la route. Nous nous joignons à eux et nous voilà partis vers Callac. Après une bonne petite marche, nous traversons la ville et nous dirigeons sur le château de Callac, grand rendez-vous. Nous nous arrêtons à une ferme et demandons à boire, mais toujours rien à manger, je commence à avoir faim. Je cause beaucoup avec Petit Chef qui me raconte le décrochage à minuit.
Enfin nous arrivons aux gorges et, enfin, voici le fameux bois où nous devons tous nous retrouver. Il y a là déjà tous les camions et les blessés. C'est la joie pour les parachutistes de se retrouver entre eux. Je retrouve le lieutenant Colineaux et le commandant Le Gouvello.
Les radios sont déjà affairés autour de la camionnette où se trouvaient leurs affaires. Ils me proposent de rester avec eux mais j'ai dans la tête de retrouver le capitaine Puech-Samson qui, lui, doit être là depuis hier soir. Je monte donc au château et là se trouvent tous les chefs en discussion, entre autres les commandants Bourgoin et Morice, mais pas de capitaine. Découragé et affamé et surtout bien fatigué, je me couche au pied d'un talus non loin des chefs et m'endors, je ne sais combien de temps, mais ce que je sais c'est que, tout à coup, je me sens réveillé et, ouvrant les yeux, j'aperçois le commandant Bourgoin qui, devant moi, me regarde en riant. Je me lève aussitôt et veux me mettre au garde à vous, mais je retombe tellement je suis fatigué. Alors, très gentiment, le commandant s'occupe de moi et me fait monter dans un grenier à foin où je dors vraiment bien.
Quand je me réveille, trois déceptions viennent me frapper : d'abord, une abondante pluie tombe et la cour est déjà inondée ; ça va être gai. Ensuite, j'ai beau chercher partout autour de moi, je ne retrouve plus ma carabine, on me l'a volée, j'en pleure presque, d'autant plus que j'ai encore sur moi toutes mes munitions. Je vais pour descendre, furieux, quand je ne trouve plus d'échelle.
J'appelle Maurice, le cuisinier, qui est en train de faire cuire sous un hangar de la viande pour le repas. Il m'apporte l'échelle, je vais à l'auto du commandant où j'avais mis la veille mon petit baluchon, je le retrouve fort heureusement, mais j'ai beau demander, chercher, m'affairer, toujours pas de carabine.
Il est presque midi, chacun va et vient, les ordres se donnent, les autos vont dans tous les sens et tout cela sous la pluie, dans la boue, et traqués. En effet, les allemands s'amusent maintenant à nous courir après et, déjà, dans quelques bois, les FFI se sont rabattus. Le capitaine n'est toujours pas là ! Je me joins aux radios auxquels le commandant Bourgoin me confie. La décision est prise de se disperser et de ne pas reformer de camp, l'endroit n'étant pas assez propice.
Alors chacun fiche le camp de son côté et va rejoindre sa famille, sa ferme, mais les pauvres parachutistes vont être, eux, obligés de se cacher dans des endroits inconnus. Je vais donc partager leur vie, tant mieux ! Le lieutenant Marienne, toujours avec son bandeau sur la tête, donne des ordres, réunit les jeeps et part pour nous protéger. Enfin le déjeuner ; drôle de déjeuner, un bout de viande sur du pain trempé. La pluie est de plus en plus forte et les traces des roues se voient de mieux en mieux dans la boue. Je reste un peu à arranger le camion des radios et, sur ma demande, ceux-ci m'affirment que ça ne fait rien qu'on m'ait volé ma carabine et qu'il y en a une autre pour moi dans l'auto. Je les crois (mal m'en prit).
Le bois est maintenant à peu près désert. Je vois passer les commandants Bourgoin et Morice et les capitaines Guimard et Brunet, tous en civils, ils vont prendre le vrai maquis. Ils me demandent de les accompagner jusqu'au moulin de Saint-Aubin où il y aura une cachette sûre pour nous. Mais je ne suis pas en civil et je n'ai pas le temps de me changer, car ils sont pressés ; je les rejoindrai donc avec les radios et le camion. La pluie tombe toujours, enfin nous partons. Où sont les allemands ? C'est à peu près calme aussi dans un bruit que l'on trouve pour le moment bien trop fort, la 11 légère avec Lili, Jean Guignon, René Allain, Raymond Guillard, part, suivie de près par notre petite camionnette conduite par un garagiste, chargée d'armes et de matériel radio, avec la lieutenant Hoffman et ses deux radios, Gilbert et Jacques et moi-même.
Le capitaine n'est toujours pas là et je suis désespéré. Voici maintenant la route, puis la route nationale, c'est bien imprudent, enfin tant pis, il faut passer. Les boches patrouillent mais nous n'en rencontrons pas quand soudain, après un petit village, au détour de la route, on nous annonce : "les Cosaques !" Que faire ? Le premier petit chemin venu fait notre affaire, mais pour comble de malheur la camionnette tombe en panne. Je suis très nerveux, nous poussons la voiture, nous voici enfin à l'abri des vues indiscrètes mais non des oreilles, car avec ses petits pneus et la boue, la pauvre Citroën ne peut plus avancer et patine en faisant un boucan du tonnerre.
Nous arrivons tant bien que mal au milieu du chemin et nous arrêtons car, paraît-il, il y a aussi des allemands de l'autre côté ; j'en doute fort étant donné qu'avec le bruit que l'on faisait les fritz devraient déjà être là. Chacun prend un poste de garde de chaque côté. Le premier qui arrive est descendu ! C'est ici la seule fois où j'ai eu vraiment peur car s'ils étaient arrivés nous étions encerclés et pris. J'en profite pour me mettre en civil et mets toutes mes armes et munitions dans le fond de la voiture. Nous fumons une cigarette et, Gilbert étant revenu d'une exploration et ne nous annonçant rien de grave, nous repartons par l'autre côté, ne pouvant faire demi-tour. Voilà la grande route, personne. Et, prudemment, chacun, de peur, rentre chez soi, et d'allemands point ne voit !
Les moteurs ronflent et nous faisons à peu près 3 kilomètres. Déjà, nous apercevons le moulin de Saint-Aubin où je retrouverai le colonel Bourgoin. Enfin, nous quittons cette grande route où tant de fois, il y a 15 jours, nous avons passé Guy et moi à vélo en mission. Nous sortons dans un petit chemin où il y a d'immenses mares d'eau et il pleut toujours. Nous n'en sortons plus. C'est alors qu'apparaît un homme boitant et à l'air un peu farouche. Je l'arrête et le conduit au lieutenant. C'est un dénommé Gaby qui connaît bien les filles Mallard du camp et qui nous mène vers le colonel Bourgoin car nous ne savions plus le chemin. Je pars donc, armé, avec lui qui partira ensuite chercher ses chevaux pour dépanner les autos. Voici le moulin délabré où, à la fenêtre, j'aperçois la tête du colonel. À la bonne heure, ils ne se sont pas perdus.
Je monte le petit escalier de bois et les retrouve en haut autour d'une boite de conserves et d'un bon morceau de pain. Je suis très bien accueilli, il va sans dire ! Et je me restaure moi aussi, quelle faim ! Puis voilà Madame Chenailler, la femme du colonel Chenailler, dont le nom de guerre est Morice, chef de notre camp. Elle vient apporter du beurre. Elle est à la Follette, ferme à 300 mètres d'ici, avec ses deux fils, dans le maquis aussi. Puis les chefs partent et me confient à Yvonne Mallard qui devra m'emmener coucher soi-disant chez le curé de Saint-Aubin ou chez elles, à SaintAubin aussi. Avant de partir, le colonel Bourgoin me dit encore : "Loïc, c'est bien, tu as été magnifique, je ne l'oublierai pas et dès que je pourrai télégraphier je le ferai savoir à ton père. Les FFI comme toi sont vraiment des types épatants". Que d'éloges !! Ils s'en vont, et je reste avec Lili, Jean, etc… Ils s'installent pour la nuit sur des matelas, comme Yvonne tarde à venir. Il fait bien noir quand elle arrive et il pleut encore un peu, vraiment quelle journée ! Sa sœur Marie est venue aussi. Ce sont deux vaillantes filles et qui ont fait depuis bien longtemps déjà de la résistance et qui ont été ruinées par les boches. Un de leurs frères, d'ailleurs, a été tué par eux. Nous nous engouffrons dans la nuit, avec les affaires du colonel Bourgoin, pour les camoufler. C'est un sac assez lourd.
Soudain, un bruit de pas et une ombre qui se profile au clair de lune. Qui est-ce ? Nous nous accroupissons parmi les genêts et l'être passe sans nous avoir vu. La prudence est la mère de la sûreté et ce serait vraiment pas fort de se faire prendre maintenant, on ne sait jamais. Vu la distance de Saint-Aubin et sur mes instances, nous allons à la Follette, nous camouflons dans un fossé le fameux sac et rentrons dans la toute petite maison où se trouvent les chefs. Je monte dans le grenier et m'affale sur la paille, entouré d'une bonne couverture. Pourtant, bien qu'épuisé, je ne peux m'endormir de suite. D'abord, la tension nerveuse est trop forte et les aboiements incessants des chiens, les allemands ne rôdent-ils pas autour ? S'ils arrivent, aucune issue, tant pis.
Et puis où sont maman et les petits ? Que sont devenus grand-mère et tante et aussi SainteGeneviève et puis mon petit Guy parti avec les Pondart, où est-il ? Ah, que de questions angoissantes, puis je m'endors.
L'histoire de ces deux jours, les plus beaux de mon existence, est terminée. Pour une histoire plus complète, il me faudrait raconter mes activités d'avant le camp, du 1er au 7 juin, du camp, du 7 au 17 juin, et après le camp à la Follette, du 19 juin au soir au 3 juillet.
Septembre 1944
 votre commentaire
votre commentaire
-
- Le 6 Juin 1944, le commandant Bourgoin, dit « le Manchot » était parachuté, ainsi que la majorité de ses hommes, dans le département . Le largage de fortes quantités d'armes notamment sur le terrain Baleine, permettait de doter plusieurs bataillons.Le 4e bataillon de chasseurs parachutistes de la France libre et les trois bataillons F.F.I. des régions d'Auray, Ploërmel, Rochefort-en-Terre, Guer, La Gacilly, étaient dans le camp, le 18 juin, lorsque les Allemands attaquèrent massivement le réduit.
- Si les pertes de la Wehrmacht furent importantes, de l’ordre de plusieurs centaines de soldats, 42 hommes de la France Combattante furent tués dans les combats. Le monument, dont la première pierre a été posée par le général de Gaulle, le 27 juillet 1947, a été inauguré le 24 juin 1951 par le général Koenig.
- Implanté à La Nouette, en SÉRENT, il représente un phare dont la lanterne est entourée de croix de Lorraine. Chaque année le 18 juin, ou le dimanche le plus proche de cette date, une cérémonie commémorative y est organisée.
- Se trouve également à Sérent un monument à la mémoire des enfants de Sérent et des « libérateurs venus d’ailleurs » qui portent 34 noms.
- Au lieu dit Pinieux se dresse la croix des parachutistes.
- Sur le territoire de la commune de Saint Marcel, un menhir marqué d’une croix de Lorraine, a été élevé au lieu dit le Bois Joly en hommage aux premiers combattants tombés le matin du 18 juin 1944: Melle S. Berthelot, J. Flanchais, J et P Le Blavec, A. Robino et R.Trunkenbolz.
- 2 stéles aux Hardys- Béhélec et dans le bourg, rendent également hommage aux personnes exécutées en représailles à partir du 19 Juin 1944: Yves Ayoul, Raimond Denece, Félix Guil, Françoise Le Blanc, Jean Morlas, Pierre Moussard, François et Joseph Rio, et Marcel Robert.
- Rappelons enfin que la Maison des Augustines, sise à Malestroit, dont Yvonne Beauvais était la mère supérieure pendant toute la durée de l’occupation, a été citée à l’ordre de l’Armée, le 12 mai 1949, pour avoir hébergé et caché de nombreux résistants dont le Général Audibert, chef de la résistance de l’Ouest, arrêté le 17 mars 1944, et pour avoir recueilli , après les combats de Saint Marcel de nombreux français blessés.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Le Bataillon Caro trouve ses origines dans l’ORA (Organisation de la Résistance Armée) , constituée après la dissolution de l’armée d’armistice et installée en Bretagne au cours de l’été 1943. Tout comme le reste des autres bataillons FFI (Force Française de l’Intérieur) et contrairement aux FTP (Franc Tireur et Partisan), la hommes du Bataillon Caro étaient plus âgés et la majorité de ses cadres se composaient d’officiers d’active ou de réserve.
Le message de la BBC “Il fait chaud à Suez” le 5 juin 1944 oblige le colonel Chenailler (alias Morice), chef des FFI du Morbihan, à lancer le plan rouge. La mobilisation générale des bataillons de Ploermel-Josselin (Bataillon Caro), Vannes, Auray et Guemene est immédiate et représente quelques 3500 hommes.
Le Bataillon Caro doit donc rallier La Nouette, centre névralgique, pour en constituer la garnison permanente. Arrivant le 10 juin au matin, le Commandant Caro est accompagné par son bataillon au complet. Chaque nuit, entre 150 et 200 containers atterrissent sur la Drop Zone “Baleine”. Ainsi les maquisards commencent à être équipés d’armes anglaises et américaines. On assiste aussi à la distribution d’uniformes, de brodequins, de conserves, de cigarettes et de monnaies. Les chefs de groupe ainsi que les parachutistes SAS, fraîchement débarqués d’Angleterre, commencent l’instruction des résistants.
Le 18 juin 1944 à 4h30 (heure solaire), la bataille de St. Marcel débute. Située sur le front ouest, le Bataillon Caro a pour mission principale la sécurisation du PC de La Nouette, de la Drop Zone et surtout d’empêcher tous contournement du dispositif défensif par l’ennemi. Lors de première attaque à 9h, 2 sections du Bataillon Caro sont envoyées en renfort pour stopper l’attaque du Bois-Joly. Beaucoup d’hommes du Bataillon ne verront pas la tourmente des combats. Toutefois, les courriers leur permettrons de suivre les différentes étapes de la bataille. Vers 19h, le Capitaine SAS Larralde, à la tête de ses paras soutenu par des FFI du Bataillon Caro, contre-attaque et reprennent les alentours du château de St. Geneviève. Mais ils ne peuvent déloger l’ennemi qui est maintenant au Bois-Joly. Le décrochage est ordonné vers 22h et c’est dans le calme que les maquisards quittent la zone des combats. La bataille de St. Marcel est désormais finie.
Après une période sombre de traques des maquisards dans toute la région, le Bataillon Caro participe à la libération de Vannes et Lorient à partir d’août 1944.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Dans les faubourgs en ruines de Brest et Hennebont, les FFI combattent et reconquièrent le territoire. Ils font prisonniers les soldats allemands. Les Généraux Allard et Borgnis-Desbordes passent ensuite en revue ces soldats de la Résistance.
 votre commentaire
votre commentaire
-
On peut voir sur la route de Caix à Beaufort-en-Santerre un calvaire, en assez mauvais état, en bordure d’un champ. Il témoigne du massacre commis le 7 juin 1940 sur des prisonniers du 41°RI.
Monument commémoratif des prisonniers de guerre
du 41° R.I et du 10° R.A.D
 votre commentaire
votre commentaire
-
Le sous-lieutenant Primel avait pu sortir de Rosières, en rassemblant une quarantaine d'hommes autour de lui; le plus grand nombre appartenait à sa section : la 4°. Deux kilomètres de marche les conduisirent auprès de Caix; à une centaine de mètres, au carrefour de plusieurs routes, des auto-mitrailleuses ennemies apparurent; elles se dirigeaient vers le groupe. Tous s'affolèrent et coururent à travers champs, à droite ou à gauche. L'ennemi tirait sans cesse, et il fallut progresser par bonds. A 700 ou 800 mètres au sud on apercevait un petit bois. Primel et ses hommes s'y réfugièrent et purent se croire sauvés. Ils ne s'y arrêtèrent qu'un instant, car il fallait enfin sortir de cette zone battue par les Allemands. Il était environ 8 heures du matin.
Le sous-lieutenant Primel et le sergent-chef Tardif consultèrent leur carte, avant de quitter le bois. Puis le groupe, s'orientant toujours vers le sud, se dirigea vers Beaufort, en traversant la plaine. Le calme régnait.
Nos hommes avaient leurs armes individuelles et un fusil-mitrailleur porté par le soldat Pelé. Pour soulager la fatigue de son camarade, le caporal Delatouche s'en chargea. On marche encore, en formation de groupes de combat, jusqu'aux abords de Warvillers. Par prudence, on évita ce village, en obliquant à droite, à travers les blés. Mais voici que, de nouveau, une mitrailleuse se présente; il fallut essuyer son tir; les hommes se couchèrent, et croyant avoir affaire à des Français, ils crièrent qu'ils l'étaient eux aussi. Le tir se fit plus violent; c'était donc l'ennemi. Nos hommes ne se rendirent pas encore; ils essayèrent de repérer l'arme, sans succès.
Le sous-lieutenant Primel estima qu'il n'y avait plus qu'à se rendre. Ce n'était pas facile, car se montrer exposait à se faire tuer. Un mouchoir attaché à un fusil servit de signal. Ce geste de reddition était à peine exécuté que deux auto-mitrailleuses et quelques side-cars arrivèrent et foncèrent droit sur le groupe Primel. Il n'y avait plus qu'à abandonner les armes, se lever et se rendre. Ce mouvement coûta la vie au soldat Armand Levêque, qui fut grièvement blessé et mourut sur place, ainsi qu'à Ange Coquelin, blessé mortellement, et dont on a enseveli le corps au Quesnel.
Les hommes étaient prisonniers; l'ennemi les rassembla assez durement, et les conduisit à 700 ou 800 mètres plus loin, dans un petit chemin de terre, à 500 mètres environ de Beaufort. Leur escorte les y fit arrêter; très inquiets, se demandant de quelle manière tout cela allait finir, les nôtres se mirent à fumer « une vieille cigarette », note Delatouche. Ce devait être la dernière.
Le sous-lieutenant Primel, qui connaissait bien l'allemand, eut une longue conversation avec l'officier ennemi, conversation qui parut favorable.
Une demi-heure se passa; un side-car arriva. L'ordre fut donné au sous-lieutenant Primel d'y prendre place. Ses hommes le virent s'éloigner, et ils restaient seuls, s'interrogeant sur ce qui allait suivre, mais ne se doutant pas encore du terrible sort qui leur était réservé. Quelques minutes après, les troupes S. S. de la Wermacht, les « chemises noires », comme dit Delatouche, furent là. Le groupe était entre leurs mains, et les regardait mettre en position 2 mitrailleuses, sans se rendre compte encore qu'elles étaient pour lui.
Quelques secondes, et voici la minute décisive. Ici, je ne puis mieux faire que de copier la terrible page du survivant :
On nous fait avancer sur du terrain labouré, entre du trèfle et du blé, environ 50 mètres devant ces mitrailleuses; mais là je vous dirai qu'on a compris. On voyait que l'on allait mourir. Notre cœur ne fait plus qu'un tic-tac. On nous tasse dans un rond, debout, serrés les uns contre les autres.
On nous frappe. Dernier cri pour tâcher d'avoir grâce. Mais non; c'est fini; voilà les deux armes en action. C'est un vrai massacre. Cloteaux veut se sauver, on l'abat à coups de crosse; c'est des cris de : Holà! de plus en plus violents, et beaucoup d'appels au bon Dieu. Bref, le tir est fini, et miraculeusement je me tire avec aucune blessure. Seulement, je ne bouge pas, je fais le mort. Maintenant, sans pitié pour nous, c'est au revolver que l'on nous domine. C'est fini; je désespère; j'attends une balle. Deuxième chance, la balle me passe entre les oreilles. Je m'en tire encore. On n'entend plus rien; je crois qu'ils sont déjà tous morts. Pichouron expire couché sur moi.
Maintenant que va-t-il se passer? J'attends de nouveau. Voilà encore les deux mitrailleuses en action. De ce coup, je me dis : c'est fini. Non ! tir terminé. J'ai une toute petite égratignure à la cuisse ; un rien. Bon ! Je continue toujours de faire le mort; je suis couvert du sang de mes camarades. Bref, quelques minutes se passent. J'entends les side-cars qui démarrent. Je pense beaucoup de choses; je réfléchis; quelques heures se passent. Je suis toujours immobile. Tout à coup une voix se fait entendre : « II y en a-t-il qu'ont rien? » Moi, je réponds : « On se barre ! » et bref le voilà parti dans le trèfle. Alors, j'essaie d'en faire autant. Mais les cadavres qui étaient sur moi me suivaient. J'ai coupé mon ceinturon et me suis dépouillé en chemise pour aller rejoindre mon camarade. Quand j'ai parti, Richomme vivait encore, mais trop blessé; je n'ai pu lui porter secours. Tous les deux nous avons fait deux kilomètres au moins de rampé. Nous voilà arrivés à Beaufort, dans un jardin; la nuit commence à tomber; tout à coup, nous apercevons deux ennemis venant dans notre direction; moi, je me planque dans des ronces; mon copain un peu plus loin; pas de chance, mon copain est ramassé; il est prisonnier depuis ce temps; il a été emmené à Cambrai, maintenant en Allemagne; c'est Vallet, de la C. A. 1. Moi, je passe la nuit dans ces ronces. Le lendemain, samedi 8 juin, quand je ne voyais rien, j'allais manger des fraises. Pendant 9 jours, j'ai mené cette vie, quand j'ai vu des premiers réfugiés rentrer. Veine, ils étaient de Rosières. J'ai été avec eux, pendant un mois, j'ai vécu avec ces braves gens, avant de prendre le chemin du retour.
A ce récit pathétique, j'ajoute ce détail puisé dans une autre note du même survivant : « Quand j'ai parti, j'ai vu que tous ces braves copains dormaient en paix, à part un autre comme moi, et un blessé qui essayait de se traîner. Qu'est-il devenu? » Mes renseignements me permettent de dire qu'il est mort à Beaufort. Ce malheureux parvint à gagner une grange, dans ce village où il mourut. Les cadavres de nos camarades restèrent sans sépulture pendant six semaines. Le hasard les fit découvrir. Des habitants de Beaufort, en allant chercher leurs vaches dans les champs, constatèrent qu'elles refusaient absolument de passer par cet endroit, écartées par une affreuse odeur. Ils cherchèrent à se rendre compte, et trouvèrent le monceau de cadavres.
Voici dans quelles conditions j'ai pu avoir toute la vérité sur cet affligeant massacre. Notons d'abord qu'il y eut 4 survivants : l'un, blessé, mourut à Beaufort. Un second, blessé très grièvement, succomba le 9 ou 10 juin, à l'hôpital de Marcoing, près de Cambrai : le caporal Picou, de la 2° Compagnie. Le troisième est Vallet, de la C. A. 1. Le quatrième, le caporal Delatouche, de la 4° section de la l° Compagnie. J'ai reproduit son récit. ( En fait il y eu un cinquième survivant : LEFEVRE de la C.A.1. Gravement blessé, il se cacha dans une dépendance du château puis fut capturé. Son témoignage parut dans un numéro de janvier 1946 des « Nouvelles du 41°)
Mais tous les témoignages se recoupent; on va le voir. Il était seulement possible de recueillir trois témoignages, puisqu'il faut exclure celui du blessé mort à Beaufort. Dès le mois d'octobre 1940, j'eus celui du blessé, mort à Marcoing. Voici comment : j'eus à ce moment l'occasion de rencontrer le médecin-colonel Membrey, de notre 19° Division. Il avait vu à Marcoing, peu auparavant, le docteur Villey, médecin du 117° R. I. Celui-ci, après sa capture à Berny, avait été envoyé à l'hôpital de Marcoing, où il soigna de nombreux blessés de la 19° D. I. Un soldat du 41°, dont il ne se rappelait pas le nom, était mort entre ses main; le 9 ou 10 juin. Dans son agonie, celui-ci racontait qu'après la prise de sa section, les Allemands avaient fait ranger les hommes contre un talus, leur avaient ordonné de lever les bras, en criant : « Vive Hitler »; à ce moment, ils avaient tiré sur eux avec des mitrailleuses et les avaient tous tués, sauf deux; le mourant disait être l'un des deux. Villey étant venu me voir le 15 mars 1941, interrogé par moi, me confirma ce récit, en ajoutant qu'il était peu porté à le croire, à cause de l'excitation de ce soldat agonisant. Cependant, on l'a vu, le fait, pour invraisemblable qu'il parût, était exact.
Deux jours après, j'eus le témoignage d'un autre survivant, celui-là en bonne santé. En effet, le 17 ou 18 mars, j'eus une conversation avec le sergent Clément Angibault (un séminariste) de la 11° Compagnie du 41°; fait prisonnier, il était demeuré en captivité pendant quelque temps à Cambrai. Là, il rencontra un camarade du 41° qui lui rapporta le même fait, à peu près dans les mêmes termes. Ce ne pouvait être que Vallet, de la C. A. 1. Or, à ce double témoignage s'ajouta bientôt celui du 4° en réalité troisième survivant. Le 19 mars 1941, je reçus la visite du P. Le Pape, aumônier de la 19° Division. Au cours du voyage qu'il venait d'accomplir sur les lieux de notre combat, il avait vu, entre les mains du secrétaire de la mairie de Caix, une lettre du caporal Delatouche, rescapé du massacre, dans laquelle étaient exposées les circonstances de ce drame, il situait la tuerie à Beaufort, à quelques kilomètres entre Le Quesnel et Warvillers, au sud de Hallu. Le P. Le Pape avait vu les tombes de nos morts; pour le plus grand nombre, ils étaient alors inconnus. J'eus bientôt connaissance de l'adresse du caporal Delatouche, et par lui tous les détails me furent donnés; mon enquête était achevée.
Voici la liste de nos camarades de Beaufort :
- sergent-chef Robert Honoré, 1ère Compagnie, sous-officier adjoint de la 3e section ;
- soldat Elard, 1ère Compagnie, 3e section;
- soldat Richomme, 1ère Compagnie, 3e section;
- soldat Jean Beaudu, 1ère Compagnie, 4e section;
- soldat Jean Lefilleul, 1ère Compagnie, 4e section;
- soldat Alfred Pelé,1ère Compagnie, 4e section;
- soldat Barbé, 1ère Compagnie, 4e section;
- soldat Prosper Rouault,1ère Compagnie, 4e section;
- soldat Victor Hamel, 1ère Compagnie, 4e section;
- soldat Etienne Gérard, 1ère Compagnie, 4e section;
- soldat Steichen, 1ère Compagnie, 4e section;
- soldat Francis Buchard,1ère Compagnie, 4e section;
- soldat Jean-Louis Cloteaux, 1ère Compagnie, 4e section ;
- sergent-chef Paul Tardif, 1ère Compagnie, sous-officier adjoint de la 4e section;
- soldat Pierre Simon, 1ère Compagnie, 4e section;
- soldat Veillard,1ère Compagnie, 4e section;
- soldat Joseph Philippe, 1ère Compagnie, 4e section;
- soldat Armand Levêque,1ère Compagnie, 4e section;
- soldat Darcel, 1ère Compagnie, 4e section;
- soldat Joseph Legentil, 1ère Compagnie, 1ère section;
- soldat Levrel, 1ère Compagnie,1ère section;
- soldat Guéno, 1ère Compagnie,1ère section;
- soldat Deniau,1ère Compagnie; .
- soldat Moreau, 1ère Compagnie, section de Commandement ;
- soldat Jean Mat, 1ère Compagnie, section de Commandement ;
- caporal Pierre Pichouron, 1ère Compagnie, section de Commandement ;
- soldat Auguste Saudrais, 3e Compagnie, agent de liaison au Bataillon;
- soldat Le Texier;
- adjudant-chef BIBAUD, 10e R.A.D., 3e groupe ;
- 1 inconnuLe Courrier Picard du 7 juin 1977 publia le témoignage d'un des survivants. Il reprend le récit ci-dessus mais l'article apporte quelques précisions sur ce qui s'est passé après.
Nous étions à Foucaucourt où nous avons résisté jusqu'au 7 juin sous une bataille épouvantable. Ce matin-là, ne pouvant plus tenir, on se replie vers Rosières. Là, l'ennemi nous barre la route avec le feu d'une mitrailleuse.
Une grande partie du bataillon est faite prisonnière. Etant compagnie de tête, nous réussissons à passer et continuons notre route en direction de Caix. Avant d'entrer dans ce pays, à une croisée de routes, l'ennemi nous surprend. Ne voulant pas nous rendre, on se sauve, les uns à gauche, les autres à droite, fuyant à travers champs.
Les balles nous sifflent au derrière mais ne nous atteignent pas. Toute la section commandée par le lieutenant Primel est là et nous nous reposons quelques instants. Mais nous ne pouvons pas rester là. Le lieutenant étudie la carte afin de s'en aller dans une bonne direction.
Nous repartons avec nos armes en formation de combat. Tout va bien. Nous marchons toujours à travers champs. Arrivés à quelques centaines de mètres de Beaufort, le lieutenant nous dit qu'il serait plus prudent de ne pas passer au pays…
En effet, à peine avons-nous fait quelques mètres qu'une mitrailleuse tire sur nous. Etant dans du blé, on réussit à se planquer assez bien. On croit tout d'abord que ce sont des Français qui nous tirent dessus Alors nous crions : « Français ! Français ! ». Plus on crie, plus ils tirent. On réalise que c'est l'ennemi. Nous sommes mal pris. On ne peut plus se sauver et se rendre n'est pas facile. Se lever, c'est se faire tuer.
Le lieutenant nous invite à mettre notre mouchoir au bout du fusil et à le lever. Nous avons à peine exécuté cet ordre que deux auto-mitrailleuses, suivies de plusieurs side-cars apparaissent et foncent sur nous. Cette fois, nous n'hésitons plus. Nous lâchons les armes et levons les bras, sans quoi nous étions tous écrasés. Levêque et Coquelin n'ayant pas eu le temps de se redresser, subissent ce sort. Nous voilà cette fois prisonniers. On nous fouille et on nous enlève nos balles. Puis on nous rassemble pour nous conduire à environ huit cent mètres de Beaufort, dans un petit chemin de terre. Là, nous faisons la pose. Le lieutenant, qui parlait allemand, s'entretient une demi-heure avec l'officier ennemi.
Que se dirent-ils ? Nous ne le sûmes jamais. Toujours est-il qu'on le fit monter dans un side-car, puis on l'emmena. Sa dernière parole fut « Les gars vous allez pouvoir écrire ces jours. On ne se doutait de rien et la minute tragique approchait. Voilà que nous changeons de gardiens. Les premiers s'en vont et nous sommes entre les mains de quatre chemises noires. Que va-t-il se passer ? On ne se doute toujours de rien.
Il est environ midi. On nous dit « En route ». On pense partir. Deux auto-mitrailleuses étaient braquées dans ce petit chemin de terre. Alors on nous fait avancer dans un champ de blé à 30-40 mètres de ces armes, le dos tourné. On nous place méchamment dans un rond, serrés les uns contre les autres et là, nous attendons le coup de grâce.
On se voit mourir. C'est horrible, affreux d'entendre les cris. Nous avons du courage et nous ne bougeons pas. Nous crions même jusqu'à « Vive Hitler ! ». Deux ou trois minutes se passent et les deux armes entrent en action. Nous voilà tous affaissés les uns sur les autres. Sous les cris et le sang qui coule, le feu cesse. Moi, je suis sous le tas, couvert de sang, mais sans aucune blessure. Je fais le mort, car maintenant, c'est le coup de grâce : une balle de revolver derrière la tête de chacun.
J'y échappe encore. Je me demande comment. Les armes entrent encore en action. Cette fois, c'est fini, on n'entend plus aucun soupir. Ils nous croient tous morts. J'entends les deux auto-mitrailleuses partir. Par chance, je n'ai qu'une petite égratignure à la cuisse. J'ai passé toute la soirée sous les cadavres. Ce n'est que te soir, lorsqu'un autre camarade qui a eu la même chance que moi, a parlé, que nous sommes partis.
Cela fut dur de quitter mes camarades. J'ai constaté qu'ils avaient tous cessé de vivre, ces braves, à part Richomme qui était trop gravement blessé et à qui nous n'avons pas pu porter secours. Il a survécu, parait-il pendant trois jours.
Je suis rentré chez moi, le 13 juillet Mon camarade n'a pas eu cette chance. Il se fit reprendre le soir-même à Beaufort et fut fait prisonnier en Allemagne ». L'histoire de ces soldats ne s'arrête pas là. Outre les deux rescapés dont l'auteur de la lettre, il y eut un troisième survivant. Ce dernier, blessé au pied, alla se réfugier dans une ferme, à l'entrée du village. De retour chez lui, l'agriculteur trouve l'homme dans son lit. Par crainte de se compromettre au regard des Allemands, il refuse de lui porter secours. Le soldat, gagné par la gangraine décédera quelques jours plus tard. Selon plusieurs témoignages, pour l'enterrer, le paysan lui aurait lié les pieds avec du fil de fer à ballot et l'aurait trainé jusqu'à un trou creusé par lui, à une centaine de mètres de la ferme. Quant aux corps restés dans le champ de blé, ils furent victimes des pilleurs. L'argent et les objets de valeur que portaient les soldats disparurent. Leurs plaques d’identité leur furent même retirées. Quand les familles vinrent chercher leurs morts quelques années après, elles eurent des difficultés à reconnaître les corps. Le (ou l'un des) pilleur(s) fut identifié. Intrigué par le train de vie que menait cet homme, l'épicier du village remarqua des tâches de sang sur certains billets. Il en alerta la gendarmerie et le voleur fut condamné à trois mois d'e prison qu'il purgea à Doullens. Voilà retracée à travers divers témoignages, l'histoire de ces soldats français que l'ennemi massacra à Beaufort parce qu'il avait reçu l'ordre « de ne pas s'embarrasser des petits groupes de prisonniers ».
Qui est responsable ?
Comme bien souvent la réponse est simple : les SS ... Les témoins ne parlent-ils pas de "chemises noires" ? Aucune véritable enquête n'a jamais eut lieu semble-t-il, l'étude de quelques documents permet cependant d'aboutir à une hypothèse bien différente. Une carte des positions des unités apporte un premier élément.
Aucune unité SS ne faisait face à la 19° D.I à laquelle appartenait le 41° R.I, à la place on trouvait la 4° Panzer. Les tenues noires trouvent là une explications : seules les troupes des unités blindées portaient de telles tenues. Leurs coiffures et pattes de col étaient de plus ornées de têtes de mort.
Les criminels étaient équipés d'automitrailleuses et de side-cars ce qui une fois de plus confirme l'hypothèse d'une division blindée. Au sein de la 4° Panzer, la seule unité qui possédait de tels engins était le groupe de reconnaissance : Aufklärungs Abteilung 7.Aufklärungs Abteilung 7
Stab Aufkl. Abt. 7
Kommandeur : Major MARZHAN
Abt. Stab : Hauptmann GERNET
Adjudant : Leutnant HOLZEIT
Ordonnanzoffizier : Leutnant Albrecht1. Schwadron (Panzerspäh = Automitrailleuses)
Chef : Rittermeister Von ROM
Zugführer : Leutnant STAUNTER
Zugführer : Leutnant SEIBOLD2. Schwadron (Panzerspäh = Automitrailleuses)
Chef : Rittermeister SEITZ
Zugführer : Leutnant GLATZEL
Zugführer : Leutnant KAHLE3. Schwadron (Kradschützen = motos)
Chef : Rittermeister Freiherr Von PAAR
Zugführer : Leutnant EISELT
Zugführer : Leutnant RENZ4. Schwadron (Schwere)
Chef : Oberleutnant GRAMS
Zugführer : Leutnant Freiherr Von FIRCKS
Zugführer : Leutnant HAINDLGefreiter du Aufklärungs Abteilung 7
photographié peu après la campagne
de France.Le comportement de la 4° Panzer lors des combats précédents renforce l'accusation. Son itinéraire fut jalonné de crimes de guerre connus . . .
 votre commentaire
votre commentaire
-
Le sergent Morazin obliqua vers la gauche, c'est-à-dire vers le sud-ouest. Rejoint par son caporal-chef, son chargeur, et une vingtaine d'hommes, il prit la bonne direction. Mêlés à des artilleurs, ils arrivèrent à l'Avre; la rivière large de 3 mètres et profonde de 1m 50 environ ne pouvait être franchie qu'en se lançant dans I'eau ; un certain nombre la traversa (Morazin le fit 3 fois, sans doute pour rendre service
à des camarades}. Ceux qui hésitèrent furent saisis par l'ennemi.Toujours suivi de son chargeur et d'une douzaine d'hommes, Morazin entreprit alors de rejoindre la Division. Après une dizaine de jours de marche, ayant gardé leurs armes, ils nous retrouvèrent. Ils étaient passés au milieu des troupes allemandes, par Moreuil, Coullemelle (dans la Somme),
Breteuil, Crèvecoeur-le-Grand, Rotangy et Beauvais, Pontoise et Versailles.Un tout petit groupe, dont faisait partie Joseph Pirotais, suivit à peu près la même route. Pirotais qui se tenait aux côtés de Morazin, à Rosières, avait été blessé d'une balle dans le côté. Néanmoins, avec 5 camarades, à travers les champs et les bois, tombant d'embuscade en embuscade, et les évitant heureusement chaque fois, ils atteignirent Moreuil et Coullemelle, et furent sauvés. A cet endroit, Pirotais fut conduit à l'hôpital de Beauvais, puis à Paris.
(Au groupe Morazin, se joignirent l'adjudant-chef Bochard, également de la 1° Compagnie, et le lieutenant Le Clerc de la Herverie du 10° R. A. D.)
Le Groupe Levitre
Le sergent-chef Levitre, on s'en souvient, avait essayé, avec un tout petit nombre d'hommes de contrebattre le feu de l'ennemi, à Rosières, au moyen du F. M. de Morazin. Mais ce fut en vain; le groupe se divisa pour aller en des directions différentes.
Sous les coups d'un ennemi invisible, qui semblait être dans l'usine, ou des maisons, Levitre se décrocha par bonds. Sous sa direction, les hommes marchèrent vers le sud-ouest, croyaient-ils; car Levitre pensait que les Allemands avaient franchi la Somme de Ham, et qu'ils se dirigeaient vers l'ouest.
Le groupe Levitre avançait aussi vite qu'il pouvait. Sur son chemin se trouvèrent quelques isolés qui se joignirent à lui. Bientôt ils furent une douzaine; la confiance chez eux renaissait; ils continuèrent à marcher, en évitant les routes et les crêtes. Pour mieux se dissimuler, ils descendirent dans un ravineau, près de Caix. Tout paraissait calme, en cet endroit. Mais voici que, soudain, d'un champ de blé, à 50 mètres, surgit toute une compagnie de fantassins allemands. La fuite était impossible. Cependant Bougeard, le tireur du F.M, se mit en batterie; il reçut immédiatement une rafale, et fut blessé au bras gauche. Tous étaient pris.
En un instant, ils furent désarmés et conduits à Caix où fonctionnait déjà un P. C. Bougeard fut soigné par un médecin allemand. Les prisonniers affluaient de tous les côtés : artilleurs, tirailleurs, chasseurs, fantassins. Le spectacle, écrit Levitre, était affreux; ses hommes et lui étaient atterrés.Malgré la défaite, écrit-il, nos braves poilus conservent leur dignité et leur fierté. Quelques instants après; je m'en aperçois par le magnifique pas cadencé et l'impeccable ( tête gauche ) qu'ils exécutent à mon commandement, devant les cadavres de deux des nôtres couchés au bord de la route. Le sous officier allemand est lui-même impressionné par ce geste et nous permet d'enterrer nos deux camarades;
l'un d'eux est le caporal-chef Le Jolivel, de la C. A. 1 du 41°, recrutement de Saint-Brieuc.Ensuite, on nous embarqua dans des camions et, quelques kilomètres plus loin, nous retrouvions les restes de la Compagnie (une cinquantaine en tout) avec les lieutenants de Saint-Sever et Primel parqués dans un champ.
Le Groupe Saint-Sever
Tandis que les sections Levitre et Rochard obliquaient vers le sud, devant la barricade de Rosières, Saint-Sever, Primel et sa 4° section avaient pu franchir cet obstacle, et se mettre en direction de Caix. Le sergent-chef Rougé, avec quelques hommes, avait rejoint le commandant de la 1° Compagnie. Ensemble ils arrivèrent près de Caix. Des auto-mitrailleuses allemandes les y attendaient; elles coupèrent
en deux la petite troupe. Alors que le sous-lieutenant Primel et une quarantaine d'hommes reussisaient à passer une fois de plus, Saint-Sever, Rougé et une dizaine de soldats se virent refouler dans Caix. Ils se cachèrent dans une maison, puis au bout d'un moment, le lieutenant de Saint-Sever demande quels étaient les volontaires pour essayer de forcer les lignes ennemies et se sauver. Le sergent-chef Rougé,
le caporal-chef Orrières, le soldat Roussel se proposèrent; les autres étaient trop épuisés. Ayant brûlé leurs papiers, nos 4 volontaires, revolver au poing traversèrent le village et s'engagèrent ainsi sur la plaine. Ils parcoururent ainsi plusieurs kilomètres; mais ils furent cernés par 18 Allemands, en liaison avec une dizaine d'autres qu'on apercevait à 300 mètres. Toute fuite était impossible. Cependant, Saint-Sever
ne voulait pas se rendre; il fallut se donner beaucoup de peine pour le persuader qu'il n'y avait plus rien d'autre à faire. Il accepta enfin. Le petit groupe était prisonnier.Les Allemands le conduisirent à quelque distance en arrière. Nous campons dans une prairie, écrit Rougé, et je vois arriver le sous-lieutenant Primel qui me dit que sa section a été faite prisonnière, et que lui seul est emmené avec nous. Or, ce qui est drôle: aucun homme de cette section n'a jusqu'ici donné de ses nouvelles.
L'explication est fort simple: tous les soldats qui accompagnaient Primel ont été fusillés par l'ennemi; trois seulement ont échappé au massacre. Je raconterait dans un autre récit cette affreuse tuerie.
Il faut cependant ajouter ici un renseignement qui m'est fourni par l'adjudant-chef Rochard, de la 3° section: plusieurs de ceux qui, d'abord, étaient avec-lui furent pris du côté de Caix, et d'autres dans la plaine avoisinante; l'adjudant Héry (2° section), le sergent Drouiou, le caporal-chef Bodin sont de ce nombre, ainsi que le soldat Joubert, de la 3° section . . .
Le brave lieutenant de Saint-Sever est mort en captivité, dans un camp en Allemagne, le 30 janvier 1941. C'était un excellent officier, d'une rare valeur morale. Resté très affaibli à la suite d'un accident grave, qui l'avait tenu éloigné du Régiment, il n'avait eu de cesse d'y revenir; après de multiples instances, son désir avait été exaucé. Il était de ceux qui font honneur à l'armée.
 votre commentaire
votre commentaire
-
La 1° Compagnie, aux ordres du lieutenant de Saint-Sever est en pointe; la 4° section avec le sous-lieutenant Primel; ouvre la marche; puis viennent la section de Commandement avec le sergent-chef Rougé, adjoint de Saint-Sever, la.2° section, adjudant Héry; la 3° section, adjudant-chef Rochard, et enfin la 1° section, sergent-chef Levitre; cette dernière a mission, s'il y a lieu, de protéger le repli. Quelques éléments de la C. A. 1 et du Génie suivaient la 1° Section.
La Compagnie descendit tout droit sur Rosières. Nos hommes voyaient sur la plaine les cadavres et les équipements de nombreux Allemands, résultat superbe de la belle défense du 41° R.I. et du 10° R. A. D. Devant Herleville, une tête se leva en dessus de la luzerne. Celle d'un soldat ennemi, blessé à la jambe, qui déclare: s'exprimant en français: «Je suis un pauvre soldat comme vous » Il était là depuis 2 jours, et avait soif. Tous les bidons étaient vides. Dans l'impossibilité où il était de le transporter, la 1° Compagnie
le déposa sur le bord du chemin, pour qu'il pût, plus facilement, être remarqué par les sanitaires allemands.A quelques kilomètres, au sud de Foucaucourt, la 1° Compagnie fit halte pour attendre le gros du Bataillon. Il ne vint pas, parce que, comme on le verra, il avait pris d'abord la route de Lihons, allongeant ainsi son parcours.
Tout alla bien, jusqu'à 1 kilomètre environ avant Rosières.
Les hommes, en ordre parfait, avançaient en colonne sur chaque côté de la route. Un petit avion, que l'on crut être, singulière erreur, un avion de la 19 D.I (qui n'en eût jamais) survolait la Compagnie, comme il fit du reste pour toutes les autres formations de la Division; C'était, on s'en doute, un appareil allemand de reconnaissance.
Un peu avant Rosières, 1 kilomètre disent les uns, 500 mètres selon d'autres, le bombardement ennemi s'abattit à gauche de notre colonne, à 250 mètres environ. Le tir venait du sud.
La surprise provoqua un léger flottement dans la marche; la Compagnie quitta un instant la route, pour avancer à travers les champs, puis la reprit. On accéléra l'allure pour franchir ce mauvais endroit; bientôt la marche normale recommença.
Les 2 sections de tête s'engagèrent dans Rosières, là où la rue principale se dirigeant vers le sud était coupée par une barricade. L'ennemi était, nous l'avons dit, dans le village depuis la veille. Une fusillade intense accueillit les sections.
Primel avec sa 4° section, passa sans difficulté la barricade. Mais à peine Rougé et la section de commandement I'atteignirent-ils, qu'un tir violent de mitrailleuses et de canons antichars les arrêta;.Rougé, suivi de quelques hommes, passa cependant. Le reste de la Compagnie prit une autre direction;
tandis que Rougé rejoignait le lieutenant de Saint-Sever pour prendre avec lui la direction de Caix.La dispersion commençait.
Les deux sections de queue : la 3° et la 1°, guidées par Rochard et Levitre (une cinquantaine d'hommes), au lieu de traverser le village, s'orientèrent vers la ligne de chemin de fer et le passage à niveau. Une colonne du 10° R. A. D., avec quelques officiers les suivait. La fusillade avait presque cessé dans le village; mais, au passage à niveau, les mitrailleuses allemandes prirent tout le groupe sous leur feu
intense; des minen tombaient aussi, sans doute parce que les chevaux et les fourgons des artilleurs attiraient les coups des mortiers. Poursuivis par les minen, les artilleurs s'éloignèrent. Les fantassins se mirent à l'abri, un instant, dans les maisons à gauche de la route, et en bordure du passage à niveau.Déjà on ne voyait plus Saint-Sever, ni Primel, partis dans une autre direction.
Pèle-mêle, le gros de la 1° Compagnie s'engagea entre les wagons et une usine proche; le reste, un très petit nombre, emprunta la route de droite.
Par bonds, les voltigeurs essayèrent de progresser dans la plaine, où les balles sifflaient de toutes parts. Ils s'y dispersèrent.
Le sergent-chef Levitre (1° section) rassembla quelques hommes, et prescrivit au sergent Morazin de mettre son F. M. en position, face à Rosières, à 200 mètres du village, sur un chemin de terre, bordé d'arbres. Les coups de l'adversaire paraissaient venir d'une usine. Mais on avait beau observer, on ne voyait rien; on lâcha quelques rafales, au jugé. Des mitrailleurs aussi s'étaient mis en batterie à l'entrée même du village, et tiraient. Levitre, avec quelques hommes qui l'entouraient, le soldat Bougeard, tireur, le caporal Piratais, le sergent Calvez, et quelques autres, essaya une dernière résistance. Le lieutenant Leclerc de la Herverie, qui venait de Soyécourt et était arrivé avec un canon de 75 en même
temps que la 1° Compagnie, mit en batterie sa pièce, mais inutilement. Le sergent Morazin s'était installé
avec son F. M.; mais il lui fut impossible de tirer, car l'herbe trop haute limitait son champ de tir à quelques mètres, et il risquait de frapper les nôtres, éparpillés de tous côtés pour éviter les balles allemandes.Dès lors, chacun se tira d'affaire comme il put.
Les uns partirent vers la droite (c'est-à-dire vers l'ouest) vers Caix et Cayeux, où étaient les Allemands; quelques autres avec Marazin, obliquèrent vers la gauche; c'était la bonne direction, et ils échappèrent à l'étreinte allemande, après bien des dangers. La pièce de 75 elle-même restée la dernière fut cependant sauvée, par la résolution du lieutenant de la Herverie (1).
Pour mettre de la clarté dans mon récit, je dois maintenant distinguer, dans la 1° Compagnie, un certain nombre de groupes:
- Groupe Morazin;
- Groupe Levitre;
- Groupe Saint-Sever;
- Groupe Primel.
On va voir combien leur histoire est dramatique.(1) On trouvera les renseignements sur ce point au chapitre: Retraite du 10° R. A. D.
 votre commentaire
votre commentaire
-
A 2 h 15, le matin du 7, le lieutenant Lucas, adjoint au lIeutenant-colonel Loichot, vient en side-car apporter l'ordre de se replier en direction de Montdidier au capitaine Giovanini.
Celui-ci fait observer qu'il sera très difficile de se décrocher de Foucaucourt, en raison de la proximité de
l'ennemi ; à l'est, les adversaires se mêlent en quelque sorte à l'ouest, nos hommes entendent les cris des Allemands.Immédiatement l'ordre est communiqué aux Compagnies.
Contrairement à son attente, le capitaine Giovanini put, sans difficulté sérieuse, rassembler tout son monde et tout son matériel, en une heure, devant le P. C. du 1° Bataillon.
A l'est, cependant, le petit groupe de Béthuel ne fut pas atteint par l'ordre, car il était entouré par l'ennemi. Essayer de le porter, était s'exposer à une mort ou à une capture certaine. Bethuel et ses 4 hommes restèrent donc sur leur emplacement. La privation totale de munitions les avait contraints à se réfugier dans la cave de la maison. Béthuel ignorant le départ du Bataillon essaiera, de bonne heure de sortir.Mais les Allemands étaient derrière lui, près du canon de 25, inutilement braqué désormais vers la route. A plusieurs reprises dans la journée, il renouvellera sa tentative et chaque fois des mouvements de troupes ennemies la rendront vaine. Dans l'après-midi du 7, vers 13 heures, Béthuel devra
se rendre aux Allemands; deux de ses hommes, on l'a vu, étaient blessés. Le petit groupe fut accueilli par des menaces: les Français tuaient les brancardiers, se servaient de balles explosives; ils méritaient d'être fusillés !, L'officier ennemi déclara à Béthuel qu'il devrait les mettre à mort pour venger les 400 Allemands tombés dans l'attaque du village. Béthuel protesta que lui et ses hommes n'avaient fait que leur devoir.Après en avoir délibéré avec ses lieutenants, l'officier accorda enfin la vie sauve à Béthuel et à ses hommes.
Dirigés sur Fay, ils y retrouveront leurs camarades, blessés également, de la 10° Compagnie, qui n'étaient pas encore évacués.
Au poste de secours furent laissés 7 ou 8 blessés graves qu'on n'avait pu transporter; l'abbé Le Teuff, l'infirmier très dévoué du 1° Bataillon, demeura avec eux pour les remettre aux médecins allemands; plusieurs, de ces blessés, sinon tous, moururent sur place de leurs blessures; ainsi périrent
Le Luduec et Traon, deux braves soldats de la 5° Compagnie.Le rassemblement s'effectue tranquillement pour les autres.
L'unique chenillette, mise quelques jours avant par le Colonel à la disposition du Bataillon eût été insuffisante pour tracter les canons de 25 et emporter le matériel de combat. Deux chenillettes de la C. R. E. arrivèrent opportunément à 3 heures, sur l'initiative du lieutenant Lucas (Lucas m'a dit en avoir envoyé 5).
A 4 heures, le 1° Bataillon se mit en marche dans l'ordre suivant, avec une grande discipline :
La 1° Compagnie en tête, puis la 3° Compagnie, et enfin la 2°. Le Chef de Bataillon partit le dernier.Le moral des hommes était excellent. Ils se considéraient comme vainqueurs dans cette bataille de deux jours contre des forces bien supérieures; ils pensaient que d'autres, plus heureux, allaient les relever, avec l'appui de chars, et Ils ne parlaient que de contre-attaque. Le sergent-chef Levitre (1° Compagnie) écrit dans ses notes qu'à l'annonce faite à ses hommes de l'ordre de repli, ils ne furent pas très contents;
ils étaient plutôt surpris que l'on partît sans attendre la relève. Pour un peu, Ils eussent refusé de quitter leurs Positions. Ils étaient très fiers, et avec raison, d'avoir tenu en échec des forces ennemies plus nombreuses et mieux armées qu'ils ne l'étaient eux-mêmes. De son côté, le sergent Bitaud
(3° Compagnie) exprime le sentiment d'un grand nombre en ces termes: «L'ordre, tel qu'il nous fut présenté, ne pouvait être que bien accueilli; une division de chars montait nous relever; elle était même arrivée à proximité du village; nous n'avions qu'à lui céder la place! Et de fait, dans ce moment
même, on entendait; assez lointain, mais très net, semblant venir de l'est, un grand bruit de moteurs et de
ferraille grinçante : des chars sans aucun doute ».Sans aucun doute, ils étaient allemands.
Le drame du 1° Bataillon va bientôt commencer.
Il faut d'abord étudier la tragique retraite de la 1° Compagnie . . .
 votre commentaire
votre commentaire
-
Le bruit s'était répandu, parmi les hommes du 41°, qu'une contre-attaque puissante viendrait les dégager; même ceux de la 10° Compagnie, enveloppée dans Fay, conservaient cet espoir. Maurice Chareaudeau, ce témoin si précis du combat de Fay, écrit dans ses notes que ses camarades ne pouvaient se résoudre à penser qu'ils seraient abandonnés, et qu'à plusieurs reprises ils crurent entendre derrière eux le tir de
colonnes françaises progressant vers le nord. Au 1° Bataillon de Foucaucourt, la persuasion était absolue, et nos hommes s'en iront avec regret ; ils voudraient au moins que la relève fût là.Cette illusion avait un fondement. Un message de la 19° D.I, transmis par radio dans la soirée du 5 juin ou les premières heures du 6 juin, au 41°, l'avait prévenu qu'il devait s'attendre à une prochaine contre-attaque opérée en vue de le dégager. La nouvelle avait été communiquée aux bataillons.
Le compte rendu du 1° C.A. s'explique ainsi sur ce point : Le 6 juin , une attaque de chars (général
Velvert) doit être entreprise à partir de 4 heures; elle a pour axe Champien-Roye, puis Roye-Chaulnes, et ne doit pas dépasser, jusqu'à nouvel ordre, la voie ferrée Chaulnes-Guillencourt.Partie seulement à 8 heures, par suite de retards divers, cette attaque tourne court, avant d'atteindre la
route Roye-Liancourt. Les chars sont dispersés par un violent bombardement d'aviation. La moitié environ pourra être regroupée, mais le lendemain seulement.L'échec de cette contre-attaque de chars faisait disparaître tout espoir d'une résistance victorieuse dans le
Santerre.Les engins blindés ennemis allaient pouvoir aborder la 2° position tenue en partie par la 47° D. I. (qui avait d'ailleurs passé le 5 juin au soir, aux ordres du 1° C. A.): Dès lors, le Commandement se préoccupe de sauver les unités qui tenaient toujours, mais que l'ennemi commençait de tourner par le sud.
Le décrochage des éléments de la 1° position deviendrait impossible, s'il n'était effectué dans la nuit du 6 au 7. Cette situation était exposée, dès 14 heures, par le Général Commandant le 1° Corps au Général Commandant la VII° Armée.
L'ordre de décrochage parvient au 1° Corps (Q. G. au Château de la Morlière,à Sains-Morainvilliers) à 19 heures.
Certains éléments en ligne ne pourront être prévenus avant 24 heures. Et le jour commence à 4 heures.
Combien il eût été souhaitable, puisque nous devions partir, que les Bataillons du 41° eussent pu être; avertis 2 heures plus tôt ! Le régiment tout entier, sauf la 10° Compagnie encerclée eût été sauvé!Malheureusement ils le furent seulement à 2 h 15.
A 2 h 30 du matin, le 7 juin j'entends du bruit, des chevaux qu'on attelle! Qu'est-ce que cela veut dire? On devait tenir; aucun ordre de repli ne serait donné.
Pourtant l'ordre vient d'arriver, apporté un quart d'heure auparavant par le lieutenant de Wailly, de l'E. M. de la 19° D.I. accompagné du sergent Fontaine, agent de liaison du 41° à la D. I, non sans risques, car le parcours était long et dangereux. Ils avaient pris, en passant par Lihons, seule route possible, le sergent-chef Seour. Ensemble, s'infiltrant à travers les groupes ennemis déjà installés derrière nous, ils
avaient atteint Vermandovillers.On n'eut pas tenu compte d'un ordre transmis par radio, car il avait été prescrit formellement de ne pas se replier et de n'accepter qu'un ordre écrit apporté par un officier.
Le lieutenant-colonel Loichot refusa d'abord d'accepter l'ordre. Il ne s'y résigna qu'après avoir entendu les remarques pressantes du lieutenant de Nailly. La 7° D. I. N. A. était déjà en route, et l'on avait besoin de nous ailleurs.
Les munitions nous manquaient; l'on ne pouvait nous en envoyer; nous resterions isolés et sans appui.
Le Commandement comptait sur nous pour continuer en arrière le combat.
Il faut faire vite, avant le jour, et dans le plus grand silence. En hâte, de Vermandovillers, l'ordre de repli est
porté à Soyécourt, Foucaucourt, Herleville. Il prescrit d'appuyer vers l'ouest, de se retirer en passant par le secteur de la 7° D. 1. N. A.Le chemin de repli, le seul qui reste, passe par Vauvillers et Caix, puis s'infléchit vers Davenescourt, en direction du sud-ouest; nous sommes coupés par le sud. Déjà les chars allemands sont derrière nous.
La 10° Compagnie est cernée depuis 3 jours. Un coureur ne peut l'atteindre; à plusieurs reprises, notre radio lui lance en clair cet ordre : « Rejoignez Jan immédiatement ». Mais la 10° ne répondit pas aux appels.
Dans le plus grand silence, en une demi-heure, à Vermandovillers, on est prêt pour le départ. On emporte tout le matériel.
Nous passons par Lihons, au petit jour, Il est temps. Déjà ce village est évacué par le G. R. D. 21, et la C. H. R. du 41°, avertis à minuit. Quelques cavaliers seulement sont là, comme des ombres. Dans Rosières-en-Santerre, une maison brûle; la route est coupée par un éboulement, et une excavation, travail des bombes allemandes tombées en cet endroit. Il faut faire un détour pour trouver une voie libre. Toute la
rue principale est détruite. A l'entrée de la petite ville, près de la barricade, on voit des auto-mitrailleuses ennemies incendiées.En apparence, tout est calme. Pourtant les Allemands sont ici depuis hier, installés dans les caves, ou même se reposant sur des lits dans les chambres, comme on peut en passant les voir. Quelques petits postes veillent, dissimulés.
Le lieutenant Austruy, averti à temps de cette disposition, peut faire passer les voitures de la C. H. R., en faisant un détour par la gauche, avant l'excavation.
Après lui, un camion chargé d'une cinquantaine d'hommes (fantassins, artilleurs) s'est arrêté devant l'entonnoir, et des motocyclistes allemands l'ont mitraillé. Les hommes, sautant du camion, se dispersent. Mais un sergent du 41°, sans perdre son sang-froid, réussit à faire reculer son véhicule, et à le
mettre sur le bon chemin, Il le sauve.Il n'en est pas de même, malheureusement, des deux camionnettes de la Compagnie de Commandement, restées à Lihons avec la C. H. R. Elles aussi se trouvent en face de l'entonnoir. D'abord le petit poste ennemi s'enfuit. Mais en constatant le manque de résolution des conducteurs, il revient, attaque à la mitraillette, crève les pneus. Les deux véhicules sont abandonnés, avec les bagages des officiers.
Le sergent-chef Perriot, de la 11°, quitte Lihons à 1 h 30 avec les 3 hommes de son train de combat. Il est attaqué par les mitraillettes des chars, à la sortie de Lihons. Poussant résolument,il passe et sauve son matériel et ses hommes.
Avant nous encore un petit groupe de la C. H. R. traverse enfin Rosières; une douzaine de soldats conduits par le sergent Gandon; au début de la nuit, celui-ci avait vu qu'un trou dans la ligne de défense rendrait la liaison difficile au cours du combat ; on n'y attacha pas d'Importance. Cette négligence à tenir compte de l'observation de Gaudon fut cause qu'on ne I'avertit pas du repli. Heureusement, vers 3h 30, pour lutter contre, le sommeil et avoir des renseignements, le sergent alla faire un tour d'inspection sur sa
droite. Il n'y avait plus rien. Les emplacements des voltigeurs étaient inoccupés. Gandon rassemble ses hommes, et un peu avant 1 heures; s'engage sur la route de Rosières. Il avait sauvé ce petit groupe de .la captivité.Le G. R. D. 21, bien avant nous, était passé sans encombre, emportant la totalité de son matériel ; car il avait connu vers minuit l'ordre de départ et s'était mis en route à 1 heure du matin, pour pouvoir se regrouper à Etelfay, à l'est de Montdidier, dans les premières heures de la matinée.
Le G. R. D. eut cependant à déplorer la capture du groupe de l'escadron Hors Rang, conduit par le lieutenant Berger et l'adjudant-chef de Magondeau. Le maréchal des logis Tardivel était avec eux. Une trentaine d'hommes, par lesquels une vingtaine de blessés, les accompagnaient. Ils n'avaient qu'un fusil mitrailleur sans cartouches. Le groupe s'en allait à pied, rencontra I'ennemi et ne put se défendre. Il fut prisionnier.
Le 41° R. I. lui aussi devait passer par Rosières, puisqu'il n'y avait plus d'autre route.
Vers 4 heures du matin, les voitures de I'Etat-Major entrent dans le village, font demi-tour devant l'excavation, reviennent en arrière, et par un détour sortent de Rosières.
C'est peut-être ce qui nous sauva. Vers 4 h 30, la Compagnie de Commandement, les éléments de la C. R. E., la 7° Compagnie, et la section du Génie, parties de Vermandovillers vers 3 heures, y arrivent également. Évitant Lihons, elles avaient pris la petite route d'Herleville, et de là étaient descendues sur Rosières; elles purent voir à Herleville les champs jonchés de cadavres allemands, et le nombreux
matériel abandonné l'avant-veille par les prisonniers.La petite colonne, à laquelle se joignirent des éléments du 10° R. A. D. arriva 5 ou 6 heures plus tard à Becquigny, en passant par Le Quesnel, Hangest-en-Santerre, Davenescourt, où elle franchit l'Avre.
Il était temps qu'elle traversât Rosières, car, un peu plus tard, le 1° Bataillon qui avait pu se décrocher de Foucaucourt, s'y heurta à des forces allemandes bien supérieures.Nous arrivons au chapitre le plus dramatique de l'histoire du 1° Bataillon, histoire un peu compliquée, mais qui s'éclaircit quand on entre dans le détail des faits. Il faut, étudier à part le repli de la 1° Compagnie, puis celui des 2° et 3° Compagnies, et de la C. A. 1. Et encore, pour la 1° Compagnie, sera-t-il nécessaire de distinguer, à partir de Rosières, 4 groupes dont le sort fut très différent . . .
 votre commentaire
votre commentaire
-
Tandis qu'en cette soirée du 6 juin le 41° se' préparait à la lutte suprême, un changement se produisait au 3° groupe du 10° R. A. D., dont le P. C. était à Vermandovillers, et les 7° et 9° batteries au Bois Étoilé.
La journée du 6 juin avait été très calme dans le bois, les alentours ayant été à peu près purgés d'ennemis le 5 juin. Néanmoins les batteries tirèrent beaucoup ce jour là : tirs commandés par le groupe, tirs à vue réglés du poste de guet aussi. Toutefois un ordre du 41° R.I, annonçant une contre-attaque par chars français I'empêche de tirer sur de nombreux chars mal identifiés qui circulaient sur la route
Estrées-Foucaucourt. Or c'étaient des chars allemands. Vers le soir, le lieutenant de Courson prend sur lui de tirer sur ces chars, et la réaction de l'ennemi sous forme d'un bombardement de la position par 105 démontre amplement qu'il a eu raison. (Notes de Courson-Nantois.)Cependant une modification dans la position des batteries pouvait être désirable; la disparition du 117° au sous-secteur du centre, la progression des engins blindés dans les arrières des 19° et 29° D.I mettaient nos pièces très près de l'ennemi.
Le commandement songeait à ce danger.
Les renseignements très précis qu'a bien voulu me communiquer le chef d'escadron Schérer nous permettent de faire l'histoire de nos artilleurs pendant cette journée. On verra combien notre situation était dramatique.
Les passages entre guillemets sont tirés d'un rapport
adressé par Schérer le 26 juillet 1941 au général Doumenc.
« Le 6 juin, dans la matinée, le 3° groupe reçut l'ordre de rechercher une position moins exposée (que celle du Bois Étoilé) qui le rapprocherait de la Division de gauche moins menacée (VIl° D. 1. N. A.). La mission d'appui du groupe n'était pas modifiée. »Cet ordre était envoyé par la Division. Le commandant croit toutefois qu'il venait de plus haut.
« Deux pièces de la 8° batterie restaient en antichars à Soyécourt et 2 autres à Herleville.
Après avoir choisi, dans J'après-midi du 6 juin, deux positions en bordure Nord de la route de Lihons à la Maison Rouge, je rentrais à pied vers Lihons sur la N. 337, lorsque je Comptai, tapis dans les champs face au Nord, une trentaine de casques allemands, sur un front de 500 mètres, à 150 mètres au Sud de la route. Un officier allemand, debout, scrutait le terrain à la jumelle.
« Je défilai au pas devant eux avec le maréchal des logis Datin qui m'accompagnait; puis, après avoir ainsi parcouru environ 800 mètres, je profitai de buissons et de boqueteaux pour piquer brusquement vers le Nord.
« J'alertai au passage les artilleurs des échelons et du P.C. d'un groupe du 321° d'Artillerie installés à la ferme Lihu, et je rejoignis mon P. C. convaincu que la densité de l'ennemi au sud devait être très faible, mais suffisante pour les communications avec le commandement et empêcher les ravitaillements.
« Le soir, à 21 heures, je commençai le mouvement prévu; pour pouvoir le mener à bien au milieu des soldats allemands infestant le terrain, je crus nécessaire de demander au colonel Loichot le concours d'une chenillette d'infanterie, qui, la nuit, ferait un bruit de chars de nature à intimider I'ennemi, Il y ajouta spontanément une demi-section d'infanterie pour encadrer mes servants en cas de combat rapproché.
La chenillette était commandée par Tardiveau. La séparation des 2 P. C. d'infanterie et d'artillerie eut donc lieu en complet accord avec le colonel Loichot, après que le commandant Schérer lui eut offert de ne pas exécuter l'ordre reçu, si le Colonel estimait qu'un changement dans la situation rendît nécessaire le maintien du P. C. III/10°, et du groupe à leurs emplacements actuels.A 21 heures, l'ordre de se transporter sur la nouvelle position est transmis par E. R. 22 au capitaine Magne, commandant la 7° batterie, et, par lui, à la 9° L'ordre est bientôt confirmé par écrit.
La 7° quitte le Bois Étoilé à 22 heures, la 9° à 22 h 30, cette dernière en emportant tout ce qui lui reste de munitions soit 1700 coups. (Notes de Courson-Nantois.)
L'énergie qu'avait mise le capitaine de Nantois à conserver dans le Bois Étoilé ses avant-trains; permettait
l'exécution de ce changement de position.Les batteries passent par la ferme Lihu, Lihons, prennent la route de Lihons à Harbonnières, 150 mètres après la côte 109, le chef d'escadron Schérer les arrête et les fait mettre en batterie. Elles devaient passer la nuit en position sans tirer. (Notes de Courson-Nantois.)
Au cours de ce déplacement, le groupe essuya un seul coup de fusil resté sans réponse.
En passant à la ferme Lihu vers 21 h 30, le Commandant du groupe du 321° R. A. m'apprit qu'il venait de recevoir l'ordre général de repli immédiat; mais, l'ayant égaré, il n'a'pu me le présenter. Ne l'ayant pas reçu moi-même et n'ayant pu en prendre connaissance, je l'ai considéré comme ne concernant pas mon groupe.
Dès la mise en hatterie terminée, j'ai, comme cela était convenu, renvoyé la chenillette et la 1/2 section d'infanterie à Vermandovillers.Une reconnaissance dans Vauvillers, où mes avant-trains devaient chercher ( protection dans ce point d'appui solidement tenu (ordre reçu) m'a révélé qu'il avait été évacué. (Rapport Schérer.)
La nuit fut calme à la côte 109; mais la journée du 7 juin devait être mouvementée . . .
 votre commentaire
votre commentaire
-
A Vermandovillers, la nuit tombée, on évacue les derniers prisonniers.
Du côté d'Ablaincourt, on voit passer des chars allemands.
Avec beaucoup de difficulté, on peut amener les blessés de Foucaucourt, Soyécourt, Herleville, que les ambulances transportent au delà de Lihons, au G. S. D. Il faut louer le courage, en ces jours de combat, des conducteurs de sanitaires et des brancardiers, car le risque est grand sur les chemins, dans l'obscurité; il arrive que des engins blindés leur envoient quelques balles.
A la chute du jour, nous ensevelissons un des nôtres, le sergent Fuzel et un Allemand. Une section rend les honneurs.
Un infirmier autrichien et un autre prisonnier suivent le corps de leur camarade.
Le capitaine Levreux s'occupe de tout avec beaucoup de calme et de courage. Dans les heures difficiles que nous vivons, il exerce avec savoir-faire et autorité le commandement de sa Compagnie et du village; il paraît fatigué.
Nons le sommes tous.
Partout la résistance continue, à Foucaucourt, à Soyécourt, à Herleville, à Fay.
Toutes les heures arrive l'appel par radio de la 10° Compagnie de Fay, encerclée : « Nous tenons toujours, envoyez des renforts, des munitions, des vivres » Hélas! rien ne peut passer.
Nous sentons tous que demain sera la lutte suprême, puisque tout est tombé à notre droite. Déjà l'ennemi est au delà de Chaulnes, et descend sur Roye; il est même derrière nous à Rosières.
Nous avons l'ordre formel de ne pas nous replier, et personne n'y songe.
Le médecin-commandant Le Cars se demande où il pourra soigner les blessés.
Dans leurs tranchées, les hommes continuent de creuser et de veiller.
Notre situation est tragique. Dans une dépendance de la ferme un dernier blessé allemand agonise.
Pour le 41° aussi, c'est l'agonie!
Tandis qu'autour de lui l'étreinte se resserre.
Car les camions allemands, en longues colonnes, descendent sans arrêt, à notre droite, par toutes les routes, vers Chaulnes, vers le sud; leurs phares font des trous de lumière dans les ténèbres, leurs klaxons retentissent.
On perçoit le vrombissement de quelques avions; les projecteurs de la D. C. A. ennemie (le lieutenant Lucas en compte 7) fouillent le ciel; deux de ces projecteurs sont déjà en place à 4 ou 5 kilomètres au sud de Vermandovillers. . .
 votre commentaire
votre commentaire
-
Plaque apposée sur le pignon de la gare TGV Haute-Picardie :
"Sur ce sol d'Ablaincourt, le 5 juin 1940
les 1er et 3ème groupes du 10ème Régiment d'Artillerie
sous les ordres des Chefs d'Escadron LIEVRE et SCHERER,
et le 41ème R.I., sous les ordres du Lieutenant-Colonel LOICHOT,
de la 19ème Division d'Infanterie, originaire de Rennes,
assaillis par les divisions cuirassées allemandes,
ont défendu l'honneur du drapeau au prix de lourdes pertes."La photo de cette plaque a été prise le 19 Février 2017
( Merci à Mr Arnaud Viard )
 votre commentaire
votre commentaire
-
A Foucaucourt, au contraire, c'est le combat acharné.
Dès l'aube, le 6 juin, le bombardement recommence, violent. Le point d'appui est pilonné. Avec plus ou moins d'intensité, il va durer toute la journée.
Vers 7 heures, l'infanterie allemande revient à l'attaque.
L'une après I'autre; les maisons flambent; Notre artillerie ne réagit plus guère, au sentiment des défenseurs; un moment vint où elle se tut.
Les tirs de l'infanterie sont surtout violents dans les secteurs Ouest et Est; le centre est moins fortement attaqué.
Cependant, même au centre, les Allemands s'approchent assez pour que, note le sergent-chef Levitre (1° section de la 1° Cie), on pût tirer sur eux à coup sûr au fusil.
Dans le secteur ouest, l'effectif des assaillants qui essaient, vers 7 heures, d'aborder nos positions est sensiblement le même que la veille; il semblait seulement que ce fussent des troupes fraîches.
La tactique aussi est la même: I'ennemi tente de nous déborder par l'Ouest, comme au même moment il s'efforce de le faire par l'Est sur le groupe Béthuel.
Mais le 6 juin, dans le secteur Ouest, on est mieux préparé; la mitrailleuse du caporal-chef Tamazian (C. A. 1), placée dans un endroit bien choisi, parfaitement camouflée, au point qu'elle ne fut pas repérée de toute la journée, fait un excellent travail et inflige à l'ennemi des pertes sérieuses.
Cette mitrailleuse, par sa position, pouvait atteindre l'ennemi assez loin, avant même qu'il abordât la crête protectrice.
Les témoins s'accordent à dire qu'elle prévenait l'ennemi à plus d'un kilomètre.
Les mêmes témoins disent que la mitrailleuse respecta les voitures sanitaires allemandes qui venaient sur le terrain relever les blessés.
Malgré le travail efficace de la mitrailleuse, I'ennemi réussit à faire passer, comme la veille, une partie de son effectif, car notre artillerie ne pouvait plus intervenir avec la même vigueur. Elle avait subi des pertes, et ses munitions étaient par malheur limitées, Pourtant ses barrages tombaient encore avec une admirable précision, en face de la 3° et de la 1° Compagnies. Cette constatation de Levitre et du
sergent Bitaud est à la louange de nos camarades artilleurs.L'artillerie allemande harcelait sans répit nos hommes, ne leur laissant pas un instant de tranquillité.
Il n'est pas douteux qu'aujourd'hui les Allemands veulent Foucaucourt ; ils s'en rapprochent peu à peu, en rampant dans les champs de luzerne, si bien que ce soir ils seront à 200 ou 300 mètres seulement de nos positions, en certains endroits.
Au travail de l'artillerie ennemie, s'ajoute celui de l'aviation qui jette ses bombes incendiaires.
De tous les côtés, même par le Sud, l'infanterie essaie de progresser; le soldat Piratais (1° section de la 1° Cie) précise que cet effort fut particulièrement violent à 7 heures; vers 10 h 30 et à 14 heures. Tous ces assauts sont repoussés avec des pertes sévères pour l'assaillant. Chez nous le nombre des tués fut beaucoup moindre, malgré le bombardement intense.
Dans l'ensemble, le 1° Bataillon résiste victorieusement pendant toute la journée; sur un point cependant, l'Allemand réalise un gain.
En effet, le groupe du sergent Béthuel (4° section de la 3° Cie) était en position avancée à l'Est, au carrefour des routes Estrées-Soyécourt.
A 5 heures du matin, I'ennemi arrive à ce carrefour. Le groupe Béthuel ouvre le feu, tue et blesse un certain nombre d'Allemands.
Un soldat ennemi veut traverser la route, plus près du groupe; il est abattu; deux autres se montrent et subissent le même sort.
Mais les hommes de Béthuel sont encerclés. L'équipe du canon de 25, de la C. R. E., derrière eux, a sûrement été prise, car on n'entendit pas ce canon tirer sur l'objectif qu'il avait mission de battre.
Il était environ 9 heures.
Dès lors, les Allemands essaient de prendre Béthuel et ses 4 hommes par derrière. Le soldat Gestin voit un officier ennemi sortir vers cette heure là de l'abri du 25, seul sur la route; le sergent BéthueI s'installe à une fenêtre, à très courte distance, et le tue; un second, et, ce semble, un troisième, sont ainsi allongés par le fusil du sergent.Peu de temps après, Gestin est gravement blessé (une balle explosive dans les yeux); son tireur Terranéo, blessé légèrement, n'abandonne pas le combat. Les camarades de Gestin (ils restent 3 avec Béthuel : le tireur Terranéo, les pourvoyeurs Dubois et Albert Guillet) continuent de remplir leur mission; ils tirent sur le carrefour et dans les champs, à droite de la route.
Malheureusement, vers 11 heures, il n'y a plus du tout de munitions, et Béthuel est toujours séparé par l'ennemi du reste de ses voltigeurs, et des autres groupes de la 4° section.
Les 4 hommes se réfugient auprès de Gestin dans la cave, tandis que les Allemands continuent d'attaquer Foucaucourt.
Ceux-ci sont maîtres du carrefour. Toute liaison était devenue impossible au groupe Béthuel,
et la fusillade était continuelle. Jusqu'au lendemain 7 juin, à 16 heures, les 5 hommes resteront dans leur cave, sans être avertis du repli ordonné.Quant aux autres soldats du groupe, placés en arrière, ils rejoindront dans la nuit le gros de leur section; pour leur malheur, car ils seront parmi les fusillés de Beaufort. On lira plus loin ce douloureux et cruel épisode.
Pendant que se livre à la pointe Est de Foucaucourt ce combat, la lutte continue autour du point d'appui.
Dans l'après-midi, le Bataillon est presque enveloppé; il est menacé d'être débordé. Il ya maintenant chez nous, sans parler des morts, beaucoup de blessés qu'on ne peut évacuer.
Le lieutenant Sebag (1° Compagnie) est mis hors de combat au début de l'après-midi; le sergent-chef Levitre le remplace à la tête de la 1° section. A la 3° section de la 1° Cie, le sergent Guyard et le caporal Boulain sont tués à 13 heures.
Les munitions surtout pour les mortiers, sont malheureusement presque épuisées.
Le capitaine Giovanini, commandant le Bataillon, organise la défense de son P. C., désormais plus menacé par sa droite. D'autant plus que des vergers et des boqueteaux favorisaient une progression de l'ennemi.
Roger Cotto et Texier, qui ont vécu, ces journées dans l'entourage immédiat de Giovanini, ont pu me fournir de précieux détails, révélateurs de l'énergie du Capitaine et de ses hommes. Giovanini met tout le personnel de son P. C. dans les positions de combat; lui-même se prodigue. Texier l'a vu à côté de lui et du lieutenant Bellanger (qui avait eu une brillante attitude déjà devant Sarrebrück), tirer sur l'ennemi par les ouvertures du P. C., en direction de l'Est; les Allemands étaient parvenus à 200 mètres du P. C., en
contact avec la droite de la 4° section de la 1° Cie.Texier ajoute un détail que je n'ai pu vérifier, dont il est le seul à parler, parmi mes témoins: il croit que nous avions un lance-flammes, et que l'on s'en servit au moment où les attaquants s'approchèrent si près.
Il est certain, en revanche, que Giovanini fit Installer, à droite de son P. C., dans le jardin derrière la grange, une mitrailleuse qu'il servit lui-même, et dont le tir était dirigé vers la haie, le boqueteau et le carrefour d'Estrées-Soyécourt; il tira sans arrêt les bandes que 3 hommes arrivaient à peine à garnir assez vite, jusqu'au moment où, la pièce étant repérée, les minens rendirent intenable la position.A la fin de l'après-midi, l'artillerie allemande redouble l'intensité de son tir, avec des obus de gros calibre. L'un d'eux tombe sur la mitrailleuse du caporal Delarose, à 10 mètres du 25 de Goesbriant. La pièce est écrasée; Delarose est mortellement blessé, et meurt une demi-heure après; un autre n'a qu'une blessure légère qui lui permet de combattre encore.
A la fin de la journée, le 1° Bataillon sera toujours maître du village, sauf des maisons à l'extrémité Est. Après un dernier arrosage par gros calibre, l'ennemi se maintiendra sur ses positions, à quelques centaines de mètres; le chef de section Bitaud (3° Compagnie) entendait dans le silence de
la nuit, les cris gutturaux des Allemands.Vers 2 h 15 (matin du 7 juin), quand le lieutenant Lucas, adjoint au Colonel viendra de Vermandovillers apporter l'ordre de repli, il recevra, à la barricade Sud de Foucaucourt, des coups de mitraillettes et de minen en provenance justement du Nord-Ouest, secteur de la 3° Compagnie; et, à 1 kilomètre au Sud du village, il verra deux Allemands se lever à son passage.
Pendant cette dure journée du 6 juin, les hommes du 1° Bataillon se sont battus avec courage et sang-froid ; pourtant, depuis le 4 juin, ils n'ont guère mangé! Quelques petits traits sont significatifs de l'excellente tenue morale de nos braves camarades: le sergent-chef Levitre rapporte que le soldat Métairie, agent
de liaison de sa section (1° de la 1° Compagnie), passa presque toute sa journée en allées et venues continuelles, sous le bombardement. Malgré la défense de son chef, il alla lui chercher un bidon d'eau, à 300 mètres de là, sous les obus. D'autres, comme Yon et Cazeneuve, essayaient fort tranquillement, sous le marmitage, de faire un peu de cuisine pour ravitailler les camarades. Le caporal-chef Tamazian, dont la mitrailleuse faucha des centaines d'Allemands, sacrifia son dernier bidon de vin (faute d'eau) pour
refroidir le canon de sa pièce. Sacrifice méritoire, car il faisait très chaud!En de nombreux points l'incendie faisait rage.
Dans l'espace de quelques heures, pendant l'après-midi, le P. C. de la 3° Compagnie doit changer de place deux fois, chassé par le feu. Le sergent Martin, qui s'y trouvait alors (vers 18 ou 19 heures) fit dégager rapidement les munitions et les grenades. Des blessés qu'on ne pouvait évacuer en
raison de la gravité de leur état, remplissaient la cave, déjà atteinte par les flammes; Martin les fit transporter à côté de l'église, pour les mettre à l'abri.Un groupe de la 2° section (sergent Bitaud) était venu prendre position dans une grange, à côté du P. C. de la 3° Compagnie. L'ennemi l'ayant repéré, la situation devint vite intenable, car les minen tombaient avec une grande précision. Le tireur du F. M. venait d'être tué; le chef de groupe (caporal-chef Cassini) et son adjoint avaient été sérieusement blessés. Notre artillerie se taisait, tandis que des avions allemands survolaient, pour les reconnaître, nos groupes de combat.
En cette fin de journée, la lutte était dure, écrit le sergent Armand Martin; chacun tenait son poste avec tranquillité, sans affolement. Partout les sections tenaient bien. On entendait les rafales des fusils mitrailleurs. Personne ne flanchait.
La nuit arriva; elle fut assez calme. Tous les blessés évacuables et, parmi eux, le lieutenant Sebag, furent trans portés sur la chenillette de Roger Cotto, et par les voitures sanitaires à Vermandovillers.
A son retour, Cotto rapporta le reste des cartouches du P. C. R.I., et quelques obus de mortier.
Au milieu de la nuit, le sous-lieutenant Primel, et le 2° groupe de la 4° section de la 1° Compagnie durent abandonner leur maison en flammes, et se joindre au 3° groupe du caporal Delatouche. Au même moment, quelques voltigeurs du groupe Béthuel, qui avaient tenu, jusqu'alors, dans une maison, en arrière du canon de 25 capturé le matin, arrivèrent aussi; ils craignaient d'être pris à la faveur des ténèbres par l'ennemi installé à quelques mètres d'eux.
Comme on le voit, la situation était critique; depuis le 4 juin, aucun ravitaillement en vivres n'avait pu être envoyé, puisqu'il n'yen avait pas, et les munitions elles-mêmes étaient fort réduites.
Quand le lieutenant Lucas apportera l'ordre de repli le capitaine Giovanini pourra lui répondre que l'exécution serait difficile, car, en certains points, Français et Allemands étaient mélangés, maison par maison. C'était sûrement exact pour la section Primel, vouée à un tragique destin.
Depuis deux jours, le Bataillon luttait contre des forces très supérieures; les indications fournies par l'examen des tombes ennemies nous apprennent que les morts appartiennent à 7 Régiments d'infanterie ou groupes de reconnaissance. . .
 votre commentaire
votre commentaire
-
A Herleville, ou la journée d'hier a été tumultueuses, il n'y a rien de notable à signaler le 6 juin.
Le nettoyage de la veille a été si complet, qu'il vaut aujourd'hui à nos camarades une tranquillité relative.
Seuls des bombardements intermittents viennent les troubler, mais sans conséquences sérieuses.
Un autre récit sur Herleville
Extrait du journal de marche du sous-lieutenant PINEL, commandant la section installée dans la ferme GODIER. : « …Les 77 pleuvent toujours. Les avions de reconnaissance allemands passent sans cesse au dessus de nous. Je n’ai pas vu un avion français depuis le début des hostilités. La belle ferme ou nous étions en position n’est plus qu’un amas de pierres et de terre. Nos chevaux sont blessés dans l’écurie. Nous n’avons aucun ravitaillement. Nous avons infligé de fortes pertes aux Allemands. Nul doute qu’ils vont contre-attaquer. Le soir approche. Ils ont reçu des renforts et nous attaquent au lance-flamme. J’ai la barbe grillée et sent le cochon grillé à plein nez. La nuit est troublée maintenant. Les blessés allemands crient toute la nuit. Nous ne pouvons les secourir car nous savons ce qui nous attend. Au petit jour, nouvelle attaque. On les distingue mal. On va ouvrir le feu, mais on entend parler français « Ne tirez pas les gars, nous sommes de la 7ième compagnie ». Les allemands les avaient fait avancer devant eux pour attaquer. Ils étaient prisonniers depuis la veille. On a d’abord tiré en l’air, puis dans le tas. L’attaque est repoussée, mais à quel prix !
A ma gauche, un obus tombe prés d’un groupe de « voltigeurs ». Leur sergent-chef arrive près de moi me disant : « ils ne nous ont pas eu les vaches, seul le chien a été tué. » Cela barde toujours. Nous n’avons pas mangé depuis 3 jours. Quelques débrouillards ont trouvé du pinard, cela nous soutien malgré tout. Quelques Allemands ont réussi à monter dans le clocher du village et nous tirent dessus avec leurs mitraillettes. Notre canon de 25 a vite fait de descendre le clocher. La nuit vient, il faut redoubler de vigilance. Les blessés crient toujours dans la plaine. Les vaches blessées dans les champs beuglent toute la nuit, c’est épouvantable.
Au petit jour, nouvelle attaque. Le capitaine THOURON, les lieutenants PRIGENT et RAVOUX veulent se rendre compte du mauvais fonctionnement des postes radio avec le P.C. Un obus tombe prés d’eux. THOURON a le bras droit arraché. RAVOUX, coté droit criblé d’éclats. PRIGENT est tué. Il avait 25 ans et devait se marier sous peu… Dans la nuit un ordre arrive. Il faut se replier immédiatement, nous sommes encerclés parait-il. Nous rassemblons notre matériel et partons avec les chevaux blessés. La 5ième Cie ferme la marche. Il y a eu de la bagarre ou nous passons ; la route est jonchée de casques allemands et français. Ceci se passe le 7 juin. J’ai su par la suite, et de bonne source que le 41ième avait été considéré par l’état-major comme complètement disparu…
 votre commentaire
votre commentaire
-
A Soyécourt, comme dans tous les points d'appui encore défendus par la 19 D.I., la journée du 6 juin est marquée par de fréquents et violents bombardements.
Dès les premières heures du matin, nos hommes du 3° Bataillon assistent aux assauts livrés par les masses allemandes contre le 1° Bataillon à Foucaucourt. Car, sur cette plaine, rien n'arrête le regard, s'il n'y a pas de boqueteaux pour faire écran.
Aujourd'hui l'artillerie ennemie prend comme objectif spécial les églises. Le clocher de Soyécourt n'est pas épargné.
Vers 9 heures, il reçoit 3 obus de 77; un peu plus tard, 8 obus de 105 le détruisent, et chose curieuse, les cloches y restent suspendues, prêtes à vibrer encore dans leur cadre squelettique.
Le soldat Lesaignoux, de la 11° Compagnie, s'y trouvait en observation; il est atteint par un éclat d'obus
à la tête, et meurt dans l'après-midi.Avec Lesaignoux se tenaient à ce moment, dans le clocher, Zelvelder, chargé du mortier de 60, et le Capitaine de la 11°, Fauchon. De l'observatoire, ils réglaient le tir du mortier sur les groupes allemands, et les coups portaient admirablement.
Un premier obus était tombé sur la nef, sans qu'ils songeassent à abandonner le poste. Le danger se rapprochant, il avait fallu songer à partir. C'est à ce moment que Lesaignoux fut atteint. Fauchon partit le dernier. Le presbytère voisin servit dès lors d'observatoire.
Dans l'après-midi le nombre des blessés va sans cesse croissant, et le bombardement s'intensifie. Le P. C. de la C. A. S est sérieusement marmité; heureusement sa cave était solide.
Le soldat Jarry (4° section de la 11°) est tué. Le soldat Letot n'est sauvé que par l'intervention immédiate du lieutenant d'artillerie Leclerc de la Herverie (du 10° R. A. D.) qui commande les 75 antichars. Cet artilleur est en effet docteur en médecine. Le sergent-chef Métivier, le sergent Lorit, le caporal-chef Chabot, le soldat Khoas, le sergent Godard, de la 11° sont blessés.Il ne vient ni renfort, ni ravitaillement.
Les bombardiers ennemis passent par groupes compacts de 35, 40 ou 50!
La nuit vient, et le calme s'établit. Mais on sait que ce calme est chargé d'orage, et que la journée de demain 7 juin sera décisive. On se rappelle que l'ordre est de tenir sur place, sans regard vers l'arrière.
D'ailleurs, il n'y a plus d'arrière, l'ennemi y est aussi bien que devant et à droite . . .
 votre commentaire
votre commentaire
-
Aujourd'hui encore, et demain, la 10° Compagnie tiendra vaillamment dans son point d'appui de Fay.
La nuit a été tranquille. Cependant à la faveur des ténèbres, un petit groupe de soldats allemands s'est installé dans ce qui reste du clocher, d'où ils espèrent plus facilement mitrailler nos hommes. Rien ne les avait gênés dans l'exécution de cette petite manoeuvre, puisque l'église est en dehors du secteur défendu par la 10° Compagnie, contrainte par son petit nombre de se resserrer autour du P. C. Mais l'ennemi ne va pas longtemps occuper le clocher.
Les bombardements, par mortiers et 77, reprennent de très bonne heure. Les mitraillettes allemandes exécutent des tirs très nourris, par longues rafales. Les balles s'écrasent avec un bruit sec contre les murs des maisons dans lesquelles Le Moal a concentré la défense. Tout le monde remarque le grand sang-froid du jeune commandant du point d'appui.
Les mitraillettes ne cessent de dérouler leurs bandes de cartouches. Les maisons tremblent sous les bombardements surtout quand elles reçoivent des obus.
De temps en temps un blessé se présente au poste de secours.
Un side-car allemand et une camionnette, venant du Sud-Est; par la route d'Estrées, s'égarent dans Fay et sont demolis; deux blessés allemands (les conducteurs) sont amenés au poste de secours et soignés.
Sur la route d'Assevillers à Estrées, à l'Est du point d'appui, nos observateurs disent avoir compté, en moins de 3 heures, 400 blindés au moins en marche vers le Sud.
Le lieutenant Le Moal et ses hommes ont l'impression que partout, en dehors de Fay, on ne tire plus, et qu'un silence angoissant couvre la campagne. Impression exacte seulement pour le 117° R.I., puisque le 22° Étranger se défend âprement, héroïquement, et que le 41° tout entier demeure inébranlable; jusqu'à la dernière minute le 1/41° à Foucaucourt offrira une magnifique résistance, comme on s'en rendra compte en lisant les chapitres consacrés à Foucaucourt.
Très tôt les voltigeurs de la 4° section avertissent les mitrailleurs de Chareaudeau que les Allemands sont dans les restes du clocher: On leur envoie des V. B. Une mitrailleuse est mise en place dans un grenier; le sergent Bernard tire plusieurs bandes. Ses balles ont dû porter car on ne répond plus du côté de I'ennemi.
La pièce est redescendue au rez-de-chaussée, après ce nettoyage. Un sapeur du Génie demeure en haut comme guetteur, Bientôt arrive un 77 ou 150; il a percuté dans le grenier. Le guetteur gît dans les gravats, mortellement blessé; il expire au poste de secours.
Après 3 ou 4 heures de combat, les voltigeurs de la 4° section se replient sur leurs tranchées, car la situation n'est plus tenable dans les maisons où explosent les obus allemands.
Au poste de secours, il n'y a plus d'eau, et l'ennemi a pris possession de la ferme belge et de son réservoir.
Chareaudeau, dans son récit, écrit ces lignes poignantes :
Nous avons toujours de plus en plus soif, et pas une goutte d'eau. Nous ne sentons plus notre faim. Nous avions trouvé dans un buffet une petite bouteille d'eau de fleur d'oranger, et on suçait ça, chacun notre tour. Gillette ayant repéré dans la journée un cerisier, attendit la nuit et alla en chercher un plein casque.La veille, le groupe s'était partagé une boîte de sardines entre 7!... Depuis le soir du 4 juin, aucun ravitaillement en vivres n'est parvenu dans le point d'appui.
Les hommes ne perdent rien de leur vaillance: à la 3° section, le caporal Ollivier blessé à l'épaule vient se faire panser, et retourne prendre la tête de son groupe.
A la 3° encore, le sergent Fischet est tué près de l'église.
Vers 15 heures, deux volontaires partent pour porter un message et essayer d'établir la liaison avec Vermandovillers, en passant par le bois de Fay; l'uni, Henri Martin, est tué par une rafale de mitrailleuse; l'autre, le caporal-chef Leclerc revient vers 20 heures; il n'a pu franchir le cercle des fantassins allemands; dans le cours de la nuit, un motocycliste du Régiment essaie de rejoindre le P. C. du Bataillon; il ne peut
faire que quelques centaines de mètres.Ainsi s'achève, pour la 10° Compagnie, la journée du 6 juin.
La nuit se passe à peu près bien. Mais les hommes sont si fatigués, si nerveux, qu'ils ne peuvent dormir.
Pendant toute la nuit, nos observateurs voient défiler, dans la plaine, sans arrêt, tous feux allumés, les chars et les camions allemands. « Notre impuissance de ne pouvoir agir nous mettait en colère, écrit Launé, lorsque nous voyions les troupes allemandes, les chars et les canons passer sur la route d'Estrées, trop loin de nos fusils. »
Dans le village, il n'y a plus une toiture intacte; et le poste de secours, où l'on voyait nécessairement des entrées et des sorties nombreuses, est l'objet d'un tir constant de l'ennemi qui pensait peut-être avoir affaire au poste de commandement. Les murs étaient percés sur trois côtés par les obus. Heureusement, la cave où gisaient 48 blessés ne fut pas atteinte par un percutant. Un obus de 150 traversa de part en part les murs de la maison, sans éclater.
Par bonheur.
Voici les impressions du docteur Renaud; Je transcris son récit.
Le poste de secours dans la bataille.
Ce qui existait dans la cave, c'était le roulement presque ininterrompu du feu d'infanterie, pendant trois longs jours, le déroulement interminable des bandes de mitrailleuses allemandes s'opposant aux brèves rafales de nos F.M, les crépitations énervantes d'une mitraillette tirant sans cesse dans la porte du poste de secours, particulièrement repéré à cause de l'agitation forcée qui y régnait, et, par dessus tout, le fracas du bombardement d'artillerie qui ne cessa guère pendant trois jours, ne se calmant par moments
que pour se transformer en pilonnage, en tirs de destruction qui n'épargnaient rien.La petite maison de mon poste de secours, à elle seule, a reçu plus de 30 obus; la cour qui l'entourait n'était plus à la fin qu un chaos. Ce bombardement était d'autant plus terrible que c'était lui qui nous tuait et nous blessait des hommes.
Après chaque rafale, je savais qu'il allait falloir envoyer mes brancardiers chercher les blessés. Ma cave
peu à peu, se remplissait : 15 blessés le premier jour plus de 50 à la fin.Des pansenents, de la morphine, j'en avais assez, heureusement. Mais c'est l'eau qui manqua la première. Il fallut, dès le 5 juin au soir, envoyer une corvée de brancardiers dans la grande ferme Sud, presque chez les Allemands, pour s'en procurer un peu. Le lendemain, ce fut encore possible mais le 7 juin, il n'y avait plus moyen - et, à midi, je n'avais plus de pansements, ni de morphine. Ma cave n'était plus qu'un tapis de blessés (dont 2 allemands). Quelques-uns, les plus gravement atteints, hurlaient sans cesse, d'autres
me réclamaient l'évacuation, l'hôpital, Tous souffraient de leurs blessures, mais surtout de la soif. Un véritable enfer. Et toujours de nouveaux blessés arrivaient.Le 5 juin et le 6 juin, nous avions été soutenus par l'espoir d'une contre-attaque française; nous croyions sans cesse entendre le 75. Mais le 7 juin, nous savions que c'était fini. On ne répondait plus à nos appels par T. S. F. Depuis deux jours nous voyions défiler sur la grande route voisine des théories de camions allemands. Nous n'avions plus de munitions pour nos F.M . . .
 votre commentaire
votre commentaire
-
Pendant que se joue et se dénoue, tragiquement, ce 6 juin, le drame du 117° R. I. et du 22° Etranger, l'attaque allemande contre le 41° continue; elle porte contre ses abords Nord et Est. Car la leçon d'hier, au Bois Étoilé; a servi. Les pertes ont été trop grandes pour que l'infanterie ennemie veuille aujourd'hui s'aventurer entre nos points d'appui.
Mais Fay est complètement enveloppé; la 10° Compagnie y demeure inébranlable.
Vers 6 heures du matin, deux éclaireurs allemands viennent en side-car, audacieusement et de très près, reconnaître Vermandovillers. Ils se présentent par le chemin d'Ablaincourt, en face de la grande ferme où est installé le poste de secours; sous ses hangars sont mis à l'abri nos camions et dans les écuries les chevaux de la Compagnie de Commandement; le matériel de cette Compagnie et de la section du 6° Génie est là également. La maison est au centre du village, sur le bord de la route de Lihons-Soyécourt.
Un réseau barre le chemin. Le capitaine Levreux qui observe les patrouilleurs; leur laisse passer la chicane ; à ce moment, il commande le feu au canon de 25 et aux fantassins qui occupent la tranchée à droite et à gauche de l'entrée de la ferme. Malheureusement, les éclaireurs ne sont pas blessés gravement et peuvent s'en aller. Ils ont cru, sans doute, que cette belle maison était le P. C. du Colonel; ce n'était que le poste de secours régimentaire.
Vers 6 h 00, une pièce allemande se met en position entre Ablaincourt et Vermandovillers, et le prend sous son feu. Le premier coup atteint; le rez-de-chaussée; la cave est peu profonde et sans protection. Il semble que la fumée y pénètre. En tâtonnant, dans l'obscurité, je trouve un escalier intérieur et le monte; des gravats le recouvrent ainsi que le vestibule. Un deuxième obus arrive dans le premier étage; au troisième les flammes jaillissent,c'est l'incendie.
Rapidement, il embrase la maison tout entière, confortablement, mais légèrement construite. Sous. les flammes, nos brancardiers s'efforcent de sauver le matériel sanitaire : caisse de médicaments, paniers d'instruments, brancards . . .etc, dont la perte serait un désastre. Ils y réussissent à peu près et non sans péril, car bientôt le plafond de la cave prend feu. Il il'y a pas de vent, heureusement; car sous le grand
hangar, à 15 mètres, une masse considérable ,de foin et paille pressée est entassée, à côté de nos camions, de notre réserve d'essence de nos voitures sanitaires, et notre tranchée court le long de cet hangar, à 3 mètres; elle serait intenable pour les hommes du 6° Génie qui l'occupent. Il est
souhaitable, pour éviter un plus grand désastre, que la maison achève vite de se consumer. En une demi-heure tout est fini, heureusement; de la belle demeure, il ne reste plus que des murs noircis et fumants.Les canons allemands prennent alors pour cible le clocher, qui se dresse à 200 mètres au nord de notre ferme; notre tranchée aboutit à l'église. Sans doute, l'ennemi suppose t-il qu'il y a des observateurs. Le sergent Philippe et ses hommes y sont en effet, et ne le quittent qu'au moment où une partie en est emportée par les obus, pour s'installer dans le grenier d'une maison située à proximité de la route
de Soyécourt. Leur téléphone fonctionnera constamment entre l'observatoire et le P. C. R. I.D'abord les coups sur le clocher viennent de l'Est, pendant plusieurs heures; ils le frappent sans réussir à l'abattre.
Alors l'ennemi le prend par le Sud, avec plus de succès, car dans l'après-midi, vers 16 heures, sous les coups répétés du canon le clocher s'écroule!
Par intermittence, les bombardements sont violents sur notre ferme et sur le village. Ils sont réglés par un avion d'observation qui nous survole constamment, comme Il a fait hier. Il lance une fusée blanche, et peu après les obus arrivent.
Il y a quelques victimes; le médecin-commandant Le Cars les panse sous le hangar, puis, le bombardement s'accentuant, dans la tranchée elle-même, On se doute combien c'est difficile dans un trou de 80 centimètres de large. Tout de même, des vies sont sauvées par cette tranchée !
Vers 14 heures, deux patrouilleurs ennemis viennent encore. en face de notre ferme; ils sont en side-car. Mais ils ne repartiront pas.
Ils sont aperçus; on leur tire dessus avec rage; le chef de musique Martin, bon tireur, prend un fusil
mitrailleur du haut du tas de foin, il les abat; ils sont très blessés; leurs plaies sont affreuses; l'un des
deux meurt quelques heures après; l'autre, que nous serons obligés d'abandonner, aura dû mourir aussi sans doute; n'y avait pas d'espoir.Dans les points d'appui du 41°, on tient fort bien. Preuve évidente : ils nous envoient dans la matinée, non seulement des blessés allemands, mais aussi de nouveaux prisonniers.
En arrière et sur notre droite, sous nos yeux, des troupes descendent des camions arrêtés à la lisière du bois.
Elles n'affrontent pas notre point d'appui de Vermandovillers, ni de Soyécourt. Les chars ennemis, pourtant si nombreux, que nous voyons filer sur Chaulnes et Lihons, nous évitent avec soin, aujourd'hui comme hier.
La raison est Peut-être celle-ci: un habitant notable du pays a entendu un officier allemand lui dire « qu'ils avaient l'ordre de ne pas attaquer Vermandovillers trop fortement tenu.
Il est certain aussi que, les jours précédents, les avions allemands ont toujours été accueillis par un feu très violent nos canons de 25 anti-aériens, si bien qu'ils évitaient Vermandovillers.
Il faut dire enfin que le lieutenant-colonel Loichot avait fort bien organisé le point d'appui. Les tranchées continues furent pour nos hommes une excellente protection. Jusqu'à la dernière minute, ils travaillèrent à les améliorer, bien résolus à s'y défendre vaillamment. Car, le sous-lieutenant Trévilly le note justement, et moi-même je pus le constater au cours de ma dernière tournée, à la nuit, le moral de nos hommes était très bon, bien que la situation fût étrangement critique.
L'ennemi cependant ne nous oubliait pas, car vers 15h 00, on put voir 7 ou 8 chars ou auto-mitrailleuses
venir du Sud-Est et s'avancer jusqu'à 1500 mètres de Vermandovillers.Ils s'arrêtèrent en ligne, suivis d'infanterie descendue de camions à la lisière Nord du bois de Chaulnes.
Une centaine d'hommes environ se dirigea par petits groupes vers Vermandovillers, et s'installa à 2 kilomètres au Sud et au Sud-Est du village, derrière de légers replis de terrain et quelques buissons. Peut-être est-ce cette troupe que le commandant Schérer apercevra le soir en revenant de la ferme Lihu.
Vers 16 heures ou 17 heures, arriva de Pressoir une colonne de camions et d'artillerie tout terrain. Elle atteignit la lisière Nord du bois de Chaulnes pour se mettre en batterie face au Sud, vraisemblablement. Le lieutenant Lucas, adjoint au Colonel du 41°, demanda à l'officier de liaison d'artillerie de faire tirer sur la colonne d'artillerie à ce moment stationnée aux lisières du bois, et sur la concentration d'infanterie.
Malheureusement on ne pouvait sans grands inconvénients accéder à cette demande: il eût fallu
déplacer les pièces dont il ne restait que 7 ou 8 avec peu de munitions; de plus, ce déplacement de nos canons ne permettait plus d'effectuer les tirs nécessaires à la protection de Foucaucourt, Fay, Soyécourt et Herleville; enfin, le déplacement en plein jour eût attiré les avions et les pièces eussent été vite démolies sans grand profit.A la tombée de la nuit, il n'y avait plus, note le lieutenant Lucas, que 3 ou 4 chars en observation au Sud-Est de Vermandovillers . . .
 votre commentaire
votre commentaire
-
Le P. C. de la 19° Division avait heureusement quitté Chaulnes le matin du 3 juin, pour s'établir à Rouvroy.
Dès les premières heures du 5 juin, les alentours étaient infestés d'engins blindés ennemis; ils venaient même à l'entrée du village. Le général Lenclud sentait que l'attaque glissait sur sa droite. La nécessité s'imposait à lui pour pouvoir exercer plus facilement son commandement de porter son P. C. plus légèrement à gauche et à même hauteur.
Ce changement se fit d'accord avec le général Sciard, commandant du 1° Corps, à la demande du général Lenclud.
Il envoya le lieutenant Grasset à Guerbigny, préparer l'installation du P. C. Puis les diverses fractions de l'État-Major se glissèrent entre les chars allemands, et commencèrent d'arriver vers 10 h 30 à Guerbigny, où se trouvaient déjà les Compagnies télégraphique et Radio, la Compagnie hippomobile de la D.I. et la C. H. R. du 117° R.I. Le général Lenclud quitta le dernier le village de Rouvroy.
Vers midi, l'État-Major tout entier était établi à Guerbigny, auprès des écoles, au carrefour proche de l'église. Une demi heure après le départ du Général, l'aviation allemande écrasait de ses bombes la ferme qui venait d'être abandonnée.
Le rapport du 1° Corps d'armée confirme ces données. Il note, en effet, pour la journée du 6 juin :
L'ennemi lance, dans l'étroit couloir des sous-secteurs Centre et Est, anéantis, de la 19° Division, une masse d'engins blindés que des observateurs évaluent à 700 ou 800.Cette masse, pendant la journée, se répand en éventail sur les arrières de la 19° D.I. (Le P. C. doit être évacué vers 17 heures) et gagne les arrières de la 29° D.I. (Le P. C. est évacué à 16 heures) et même les arrières de la 7° D. I. N. A . . .
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles
Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires