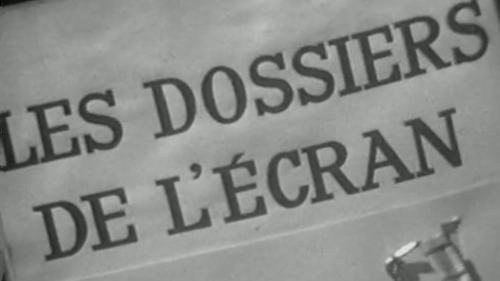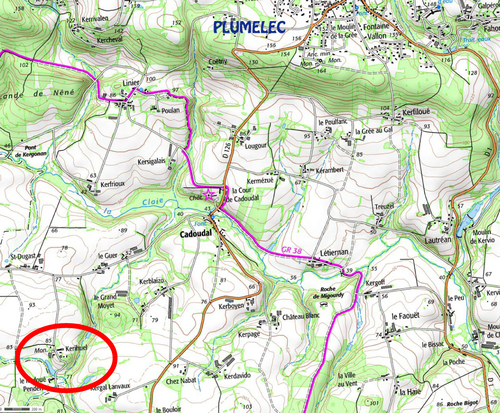-
06 - les combats de St Marcel
Les combats de Saint-Marcel constituent une page emblématique de la Résistance bretonne.
Non loin de Vannes, aux confins occidentaux du village de Saint-Marcel, le terrain de la Ferme de la Nouette est choisi, dès février 1943, comme terrain de parachutage d'hommes et de matériel pour la Résistance morbihannaise par le Bureau des opérations aériennes de la France Libre. Cette opération prend le nom de code de "Baleine". Le premier et unique parachutage avant les combats de 1944 aura lieu en mai 1943.
Cependant, fin 1943, ce terrain est choisi par le chef départemental de l'Armée Secrète pour la réception d'armes et des renforts qui doivent être parachutés au moment du futur débarquement. Un petit groupe de résistants se constitue autour du camp.

Zone d'opérations des SAS et des maquis en Bretagne. Source : GNU Free Documentation License.
Dès le mois de mai 1944, les premières opérations de sabotage des voies ferrées de la région commencent alors qu'arrive à la Nouette le délégué militaire régional et chef du bataillon d'ouvriers de l'artillerie (BOA) de Bretagne, Valentin Abeille. Dès le 23 mai, le Plan Vert est mis en place pour la destruction de toutes les voies ferrées de la région ainsi que le Plan Violet destiné à la destruction des lignes téléphoniques. Le département du Morbihan est divisé en 5 secteurs FFI.
Tandis que le 3 juin 1944, l'ennemi réussit à arrêter Valentin Abeille et son adjoint, Edouard Paysant du BOA arrive dans le Morbihan avec un équipement radio. Dès le lendemain, la radio de Londres ordonne l'exécution immédiate du Plan Vert et du Plan Violet, puis le 5 juin suit l'ordre de l'exécution du Plan Rouge (déclenchement des opérations de Guérilla). Toutes ces opérations sont destinées à faciliter le débarquement imminent en désorganisant les communications de l'ennemi. Cependant, le colonel Morice, chef des FFI du Finistère décrète la mobilisation générale et le regroupement de 4 bataillons FFI tandis qu'il adresse à l'état major allié une demande de parachutage d'armes.

Paul Chanaillier, alias Colonel Morice. Source : DR
Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, en même temps que les premières troupes aéroportées anglo-américaines touchent le sol de la Normandie, les premiers parachutistes sont largués en Bretagne.

A la porte d'un avion C-47 "Dakota", un parachutiste français du SAS (Special Air Service) French Squadron est prêt pour le saut. A ses pieds, le sac (appelé gaine) qui contient son équipement. Source : ECPAD
Ils font partie des parachutistes de la France Libre, dépendant du SAS (Spécial Airbonne Service), 2e régiment de chasseurs parachutistes qui a déjà participé à des combats glorieux, notamment au sein de la 8e armée britannique pendant la campagne de Libye de 1942 à 1943. Cette unité est sous les ordres du colonel Bourgoin.

Colonel Bourgoin. Source : Musée de l'Ordre de la Libération
Les parachutistes ont une double mission : exécution des sabotages pour isoler la presqu'île bretonne et empêcher l'envoi de renforts allemands vers les lieux de débarquements, infiltration à l'intérieur de la Bretagne et constitution de bases destinées à recevoir des unités parachutées ou aéroportées. C'est ainsi que deux détachements précurseurs sont lâchés dans les Côtes du Nord et le Morbihan afin d'examiner les forces de l'ennemi et les possibilités défensives en coopération avec la Résistance pour former une base d'accueil pour les opérations futures.
De même, dans le Morbihan, le groupe du lieutenant Marienne est parachuté à Plumelec, le groupement du lieutenant Deplante près de Guéhenno. Le groupe de Marienne essuie un feu nourri de la garnison allemande de Plumelec et perd un de ses hommes, le caporal Bouëtard, breton, premier soldat allié tombé dans les combats de la Libération. Trois radios seront capturés avec le matériel de transmission.

Lieutenant Marienne. Source : DR
Dans la journée du 6 juin, les chefs locaux et départementaux de la Résistance se regroupent au camp de la Nouette. Des maquisards y arrivent également, rejoints dès le 7 juin par beaucoup de volontaires notamment un important personnel féminin et des parachutistes dont les chefs Marienne et Deplante.

Retrospective des années 40. Source : Ouest France
La Nouette, sous le nom de base Dingson, est le point de ralliement des parachutistes du Morbihan. Dès le 8 juin, impressionné par l'importance et l'organisation du maquis, Marienne envoie au colonel Bourgoin, alors à Londres, un message par lequel il réclame des armes, de l'essence, du matériel sanitaire et des uniformes. Il presse son chef de le rejoindre. Les jours suivants, le maquis est renforcé par notamment un bataillon venant de Ploërmel-Josselin puis par le colonel Bourgoin. Quelques jours plus tard également, une cinquantaine d'hommes les rejoignent puis cent cinquante autres. Des avions britanniques larguent un important matériel (700 containers dans la nuit du 13 au 14 juin).
Tandis que le colonel Bourgoin décide de continuer les opérations de guérilla en évitant toutes batailles rangées, les Allemands lancent 6 régiments des "Unités de l'Est" à la recherche de ceux qu'ils appellent des "terroristes". C'est ainsi que les combats vont s'engager avant que l'ordre de dispersion des maquis ait pu être donné. Au moment des combats, le camp de la Nouette est défendu par environ 2 400 hommes résistants et parachutistes. Les Allemands vont attaquer avec des effectifs doubles et un armement supérieur.
Dans la matinée du 18 juin 1944, les Allemands vont lancer deux attaques successives. Après plusieurs heures de combats, ils sont obligés de se replier avec de lourdes pertes. Dans l'après-midi, la Wehrmacht lance une troisième attaque après avoir reçu des renforts provenant notamment d'une division de parachutistes. L'avance de l'ennemi est contenue au cours de violents combats tandis que les Allemands sont bombardés par des avions britanniques. Les Allemands reçoivent toujours des renforts. Si la ferme du Bois Joly est prise par l'ennemi, une contre-offensive de flanc le repousse. Cependant, dans la soirée, la poussée allemande reprend en force. Les combats sont très violents et les colonels Bourgoin et Morice ordonnent le décrochage et la dispersion du maquis. Le camp est lentement évacué après que l'on ait fait sauter les réserves d'explosifs et de munitions. Le lendemain, 19 juin, les Allemands investissent complètement le camp.

Retrospective des années 40. Source : Ouest France
A Saint-Marcel et les communes des environs les maquisards sont traqués, les populations terrorisées. Les brutalités se multiplient, accompagnées d'exécutions sommaires notamment de plusieurs résistants et parachutistes ainsi que de civils. Les 25 et 27 juin les châteaux de Sainte-Geneviève et des Hardys-Béhélec sont incendiés et ce qu’il reste des fermes et du bourg de Saint Marcel sont détruits.

Les forces allemandes interrogent les habitants d’un village breton qu’ils soupçonnent d’être des terroristes. Juillet 1944. Source : German Federal Archive
Rappelons que lors des combats, une trentaine de Français ont trouvé la mort, une soixantaine ont été blessés et une quinzaine faits prisonniers. Les pertes allemandes évaluées entre trois cents et cinq cents hommes montre bien l'intensité des combats.
Après la dispersion, les parachutistes et les résistants continuent leur mission de harcèlement et de désorganisation des arrières de l'ennemi.
Il faut attendre le mois d’août, et la percée américaine à Avranches vers l’est et le sud, pour que toute la Bretagne passe sous le contrôle des maquisards. Ce sont alors près de 80 000 hommes qui combattent aux côtés des Américains et libèrent la côte sud de la Bretagne jusqu’à Quiberon et Crozon, fin août. Les Allemands doivent se retrancher dans les ports de Brest, Lorient et Saint-Nazaire.
Source : MINDEF/SGA/DMPA -
Par sgidplan le 15 Octobre 2015 à 09:11
Zeller traque sans répit les résistants et parachutistes réfugiés dans le département. Cette poursuite aboutit finalement à la capture du capitaine Marienne le 12 juillet 1944 au village de Kerihuel (ou Kerhihuel). Mais laissons Marie Chamming’s, jeune agent de liaison, raconter ce drame.
« L’homme était entré brusquement (dans le café Gilet) : les patriotes qui buvaient un verre de cidre restèrent une seconde immobile, le regardant. Il ouvrit son imperméable et se montra en tenue de parachutiste. Les garçons se levèrent, troublés. On commençait à beaucoup parler de faux parachutistes. Voyant leur hésitation, Munoz (un agent de l’Abwher) sortit une carte d’identité. " Vous voyez bien que je suis des vôtres" leur dit-il. Ils se passèrent la carte du lieutenant parachutiste Grey de main en main. Comment auraient-ils deviné qu’il venait d’être arrêté avec Jego (le 11 juillet à Lizio). Pas de doute, elle était bonne.Il leur avait demandé où était le boucher Mahieux."C’est lui ; leur avait-il confié, qui me conduira au capitaine Marienne." A quoi bon Mahieux ! puisque eux, les garçons, ils savaient où l’envoyer ! "Adressez vous au charron de Cadoudal, près de Kerhihuel", dirent ils enfin.
(Les trois résistants, le patron du café et le boucher Mahieux seront arrêtés par les hommes de Zeller et envoyés à Locminé où ils seront interrogés et torturés par des hommes du Bezen Perrot et du SD- DCT).L’aube (12 juillet) va se lever. Le jeune garde s’est assoupi. Un coq a chanté. Dans les taillis où ils (parachutistes) ont établi le nouveau camp, ils dorment encore profondément. Trois voitures ont déjà quitté Locminé, avec douze hommes armés de révolvers et de mitraillettes. Munoz est accompagné cette fois de Zeller, avec Gross (Abwehr), Luis Deniz, Herr et Fischer.
Munoz descendit un peu avant le village de Cadoudal et vint chez le charron. "Allez chez Danet, à la ferme qui est là", lui dit celui-ci."Demandez aux gens qui dorment ici" dit à son tour le fermier quand Munoz s’enquit du capitaine. Zeller, les miliciens et les Allemands suivaient l’approche, cachés derrière les talus. Munoz ayant fait le signe convenu, ils se démasquèrent et encerclèrent l’appentis où couchaient huit jeunes gens. Leurs armes étaient entassées à l’entrée. "Où est Marienne ?" hurla Fischer. (Marienne et ses hommes sont arrêtés) Au bout d’un quart d’heure de coups et d’injures, n’en tirant rien, les Allemands menèrent leurs prisonniers jusqu’à la cour de Kerhihuel. Les jeunes F.F.I. étaient toujours étendus sur le sol."Où sont les officiers ?"demandèrent les Allemands. Marienne et Martin (François, lieutenant) s’avancèrent. "N’oubliez pas que nous sommes des soldats !" dit Marienne, mais on l’obligea avec Martin à se coucher à côté des garçons. Les autres parachutistes (Judet, Mendes-Caldas, Beaujean, Bletterie, Marty, Hannicq) furent poussés contre un bâtiment : on leur fit lever les bras et on fouilla encore ceux qui étaient habillés, car plusieurs n’avaient que leur caleçon, comme le sergent Judet. Une première rafale partit et son camarade s’écroula à côté de lui. (Judet sentant sa dernière heure arrivée tente le tout pour le tout et réussit à s’échapper. Il sera tué en Hollande le 09 avril 1945). Ils les tuèrent tous, les huit patriotes (Morizur, Louail, Le Breton, Gondet, Denoual, Grignon, Le Bomin, Garaud), le fermier Danet, Alexandre et Rémy Gicquello, et les sept parachutistes, devant le groupe de femmes épouvantées, debout dans un coin de la cour. Les traîtres se firent photographier devant les hommes étendus morts, la face dans la poussière. Zeller avait le visage sombre, mais les autres riaient."
Les hommes de Zeller récupèrent des documents sur les cadavres des parachutistes qui leur permettent d’identifier d’autres camps. Ainsi la troupe du lieutenant de Kerillis, dit Skinner, est capturée deux jours plus tard dans la région de Trédion. Zeller torture la femme et la fille du fermier qui abritait les résistants et tous les hommes à l’exception des deux officiers, (Skinner, Fleuriot) sont abattus puis jetés dans les flammes de l’incendie de la ferme. Skinner et Fleuriot, blessés, sont enfermés dans la prison de Pontivy. Ils sont exécutés par Zeller et ses hommes quatre jours p lus tard, dans la région de Bieuzy.
Jusqu’à la fin du mois de juillet, la traque se poursuit. Devant la progression des trois forces blindées américaines, les hommes de la FAT quittent Pontivy le 03 août, direction Angers. Les collaborateurs s’y regroupent le 06 août, avant de gagner Paris le 12, puis l’Allemagne où Zeller tentera de monter des commandos destinés à opérer en France. Il est finalement arrêté le 04 mai 1945, à la frontière Suisse par des gendarmes français. Il sera jugé et fusillé à Rennes en 1946, en compagnie de Gross et de Munoz . . .Source: BRETAGNE - Occupation et Libération (forum)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par sgidplan le 14 Octobre 2015 à 13:48
Un document d'archive retrouvé: Le rapport que le sergent Judet à adressé à ses chefs le 13 juillet 1944 après la tuerie de Kerihuel en Plumelec en représailles des combats de Saint-Marcel.
Le Sergent Judet, qui venait d'échapper à la mort, devait trouver une fin glorieuse au cours de l'opération Hollande.
Le 12 juillet, vers 6 heures du matin, nous fûmes réveillés brutalement, le Capitaine Marienne, le lieutenant Martin, le sergent Marty, le caporal Beaujan, les soldats Bletterie, Flamant et moi même, par une quinzaine de miliciens et agents de la Gestapo en civil et quelques allemand en uniforme. Deux miliciens étaient entrés sous notre tente, braquant chacun, sur nous, une mitraillette et nous injuriant à qui mieux mieux. Nous fûmes conduits à la ferme qui nous ravitaillait. En arrivant dans la cour, je vis étendus par terre, les mains sous la tête, mais encore vivants, une vingtaine de civils hommes et une dizaine de femmes debout. Nous fûmes fouillés. Le Capitaine Marienne et le Lieutenant Martin fûrent séparés de nous et sur un ordre, se couchaient à côté des civils, dans la même position que ces derniers.
Jusque là je croyais encore être simplement fait prisonnier et échafaudais déjà un plan d'évasion, lorsque j'entendis une rafale et vis mon camarade Flamant à ma droite se crisper. Alors, jouant le tout pour le tout, j'ai tenté ma chance et sauté par dessus le corps de Flamant et je me suis enfui à travers buissons situés tout près. Poursuivi par deux de nos exécuteurs dont je ne puis préciser la nationalité qui m'arrosèrent copieusement de rafales de mitraillettes sans parvenir à me toucher.
La poursuite dura une dizaine de minute. Je marchais à travers la campagne sans but, encore sous le choc, lorsque j'ai rencontré le Caporal Chef Pacifici. Nous fîmes alors route ensemble en direction de Callac. Sachant que des documents très importants pour notre sécurité à tous étaient tombés aux mains de l'ennemi, nous avons tout de suite pensé à assurer une liaison avec l'Etat-Major pour le prévenir des événements et prendre les mesures nécessaires.
J'insiste sur le fait qu'un officier allemand, ainsi que deux autres militaires allemands également en tenue prirent une part active à notre capture et l'assassinat de mes camarades.
Le Sergent Judet
Signé: Judet
Additif au rapport du Sergent.
Un témoin oculaire dont je ne puis révéler des maintenant l'identité, interrogé par moi, à déclaré ce qui suit :
Le matin du 12 juillet 1944, vers 4 h 00 ( heure solaire ), des miliciens en civil et des allemands en uniforme entrent dans la ferme. Les femmes furent rassemblées dehors. Les fermiers et les F.F.I reçurent l'ordre de se coucher dans la cour, les mains sous la tête. Un peu plus tard, j'ai vu arriver un groupe de parachutiste, l'un deux à peu près nu, encadrés d'allemands et de miliciens. Les parachutistes furent mis au mur. Le Capitaine Marienne et le Lieutenant Martin reçurent l'ordre de se coucher à côté des patriotes. Tous furent fusillés. J'entendis alors de nombreux coups de feu. Ne pouvant contenir mon émotion, je fermai les yeux. Lorsque je les rouvris, les parachutistes gisaient inanimés. Le capitaine Mariennes, le Lieutenant Martin, ainsi qu'une quinzaine de patriotes avaient été assassinés. J'appris plus tard, qu'un parachutiste et quelques patriotes s'étaient évadés. Les allemands pillèrent ensuite le hameau, puis incendièrent les bâtiments. Les corps de quelques parachutistes et patriotes brûlèrent avec la ferme. Un autre parachutiste fut pris ensuite et fut roué de coups pour le faire parler, puis fut ensuite emmené.
Le 13 juillet 1944, Sergent Judet
Nous, Sergent Detroy Jacques, Caporal-chef Pacifici, déclaront l'authenticité de la présente déclaration, ayant été présent à l'interrogatoire du témoin . . .
Source: Ami entend-tu n°30 de 1975.
 1 commentaire
1 commentaire
-
Par sgidplan le 30 Septembre 2015 à 22:46
Le docteur Edouard Mahéo ( témoin des " Dossiers de l'Ecran " )
émission parue sur la 2 ème chaîne, le 17 juin 1970
Après deux grandes séquences sur la bataille de France et Dunkerque, la télévision a ouvert le Mercredi 17 Juin 1970 un « dossier de l'écran » où le Morbihan se retrouve en tout premier plan de l'actualité qu'il tint dans la guerre, voici 26 ans, en Juin 44, à Saint-Marcel. C'est le dossier du « Bataillon du Ciel » qui a été ouvert , après le film de Kessel présenté en soirée de gala au Royal, le 15 Avril 1947, sous la présidence du général Corniglion-Molinié.
Après le film, un débat eut lieu au cours duquel ont participé, entre autres personnalités, trois anciens de Saint-Marcel: le Capitaine Fey, officier de liaison de l'armée britannique; le Capitaine Desplantes, Président de l'Amicale des Anciens Parachutistes ; le Dr Mahéo, ancien Médecin-Chef du camp.
C'est lui, on se le rappelle, qui le premier , le 14 Mai , à Plumelec, devant le cercueil du Colonel Bourgoin, avait pris la parole pour saluer le chef du bataillon du ciel « au nom des obscurs , des sans-grade ». Ce
qui était une manière de dire modeste car la direction du service de santé n'était pas une mince affaire.Ce service lui avait été confié par un jeu de circonstances imprévues, car s'il était bien médecin, alors à Baden, c'est effectivement en résistant sans galon qu'il s'enrôle dans le 2 ème bataillon du Colonel Le Garrec à l'appel duquel tous les jeunes (tous à trois exceptions près) se présentèrent pour la levée en nombre de Saint-Marcel. Jusque là il se contentait de faire sauter les trains allemands !
Donc lui aussi rejoignit Saint-Marcel comme combattant jusqu'au jour où le Colonel Bourgoin s'étant fait une entorse , il s'enquit près d u Colonel Morice d'un infirmier.
Un infirmier ! lui répondit M. Chenailler; mais j'ai mieux : un lieutenant qui est un vrai toubib.
Un toubib ! Mais on pourrait en avoir grand besoin pour autre chose que des entorses.
Et c'est ainsi que le Dr Mahéo reçut de la « direction générale » de la Santé, le soin de recruter les infirmières , les secouristes, de se mettre en liaison avec la Croix-Rouge dont la représentation officielle devait rendre de tels services. A lui le soin de constituer une infirmerie, de demander à Londres les brancards et le matériel de premier secours parachutés par retour du courrier, et pour les seconds
secours d'organiser les relais dans les cliniques les plus proches : Vannes et Malestroit, surtout où le Dr Queinnec , à son poste de chirurgien , tint un rôle capital avec la Supérieure des Augustines.Vous étiez seul pour ce travail ?
Non, un autre médecin se trouvait aussi à Saint-Marcel : le Dr Srachard, qui depuis est mort dans un accident d 'avion, et qui fut d 'un dévouement sans borne dans la tâche très difficile d'évacuer les blessés. Avant le 18 Juin, les blessures n'étaient généralement pas graves, consécutives au maniement d 'armes
à l'inexpérience , Avec le 18 Juin ce fut beaucoup plus sérieux, et beaucoup plus difficile d'assurer
le transport des invalides dans des fermes surveillées par des hommes en armes, éventuellement
assurer le repli dans des caches, au fond de bois, de landes et toujours au risque de grands périls.C'est ainsi que le Dr Le Coq de Plumelec - prédécesseur du Dr Renondeau - paya de sa vie son dévouement au service des résistants blessés : arrêté par les SS un matin de Juillet 44 , il était fusillé au Fort Penthièvre.
Louis Houbé, pharmacien dans cette même bourgade, actuellement à Vannes, qui transportait les médicaments dans les fermes et les paillers transformés en infirmeries précaires, fut arrêté par la Gestapo, atrocement martyrisé et laissé pour mort à la prison de Rennes, lors d u départ précipité des
Nazis.Vingt-cinq ans passés sur ces événements, quel souvenir en conservez-vous aujourd'hui ?
Le Docteur Mahéo n'a pas répondu immédiatement à cette question parce que, m'expliqua t-il, les souvenirs d'hier et ceux d'aujourd'hui se chevauchent nécessairement. Ils ne sont pas séparés par une cloison étanche.
Enfin, finit-il par me dire, j'ai conscience d'avoir agi par devoir , sons réaliser sur le coup que ces journées qui passaient au fil des semaines , ne seraient pas des journées comme les autres, à les regarder plus tard. Nous étions embarqués dans une aventure dont ni moi ni beaucoup d 'autres ne réalisions les risques exacts, et cela valait peut-être mieux.
Que Saint-Marcel ne fut qu'une péripétie locale dans une immense guerre, sans doute.
C'est tout de même son patronage qui a été retenu l'an dernier, 25 ème anniversaire de la bataille , pour baptiser la promotion d'officiers de réserve d'infanterie.
Source: Ami entends-tu n°13 de 1970
 2 commentaires
2 commentaires
-
Par sgidplan le 4 Juillet 2015 à 22:14
Depuis le 6 juin et le débarquement en Normandie (1 ), des maquis se forment un peu partout
en Bretagne . L'un d'eux se forme près du village de Saint-Marcel (2), au hameau de la Nouette. Le 10 au
matin, le commandant Caro et 500 hommes rejoignent le poste de commandement, afin d'en assurer
la protection.Dans la nuit du 9 au 10, une cinquantaine d' hommes du commandant Bourgoin (3) sautent sur le camp, et une centaine d'autres vont suivre dans les nuits suivantes .
Sur la demande de Bourgoin, Morice (4) invite les bataillons FFI à rallier la Nouette, par petits groupes, afin de percevoir des armes. Presque toutes les nuits, des avions larguent des containers (5) .
Durant la nuit du 13 au 14, les FFI de Le Garrec (région d'Auray) rejoignent le camp. Une telle activité ne peut passer inaperçue et les Allemands soupçonnent assez vite l'existence du "camp de Saint-Marcel" (6). Le 18, à l'aube, un accrochage oppose deux véhicules de la Feldgendarmerie et des FFI sur la route de Saint-Marcel à l'abbaye.
Ce son t les premiers coups de feu. La garnison allemande de Malestroit est alertée (7), et deux compagnies sont mises sur pied pour investir le camp. Les Allemands ne pensent avoir affaire
qu'à un faible parti de maquisards. Ils se déploient de Saint-Marcel vers le Bois-Joly. Un poste FFI est
surpris, mais l'alerte est donnée. Il est environ 9 heures.L'ennemi est à son tour pris à partie par un feu nourri qui lui cause des pertes. Il parvient à gagner la
ferme de Bois-Joly, mais il est repoussé en subissant de lourdes pertes. A 10 heures il reprend son
attaque, avec des effectifs doubles, soit deux compagnies; l'axe est le même, mais l'effort est porté vers le nord du Bois-Joly et Sainte-Geneviève. Les Allemands utilisent des mortiers, mais l'attaque est arrêtée devant le bois de Sainte-Geneviève et les pertes sont nombreuses. Le combat cesse vers 12 heures. Une nouvelle attaque débute à 14 heures, l'ennemi ayant reçu des renforts (8).(1) Nom de code "Ouerlord",
(2) Saint-Marcel est situé à trois kilomètres à l'ouest de Malestroit.
(3) Le commandant Bourgoin appartient au 4th S.A.S bataillon, futur 2ème R.C.P.
(4) Morice est le pseudonyme du colonel Chenailler, chef des F.F.I.du Morbihan.
(5) L'armement perçu est anglais : pistolets, mitraillettes Sten, engins anti-chars, grenades. . .
(6) Un plan retrouvé montre que les Allemands avaient localisé le camp puisqu'ils le situaient au nord de la route de Saint-Marcel à l'abbaye, entre le hameau des Hardis et la ferme de la Nouette.
(7) Un bataillon de la Wehrmacht (500 hommes).
(8 ) Il s'agit des parachutistes de la division Kreta (venus de Josselin), d'un groupement de la 279ème DI (Redon) et de Géorgiens.Le front s'étend sur 2500 mètres, entre le château de Sainte Geneviève au nord, et le château des Hardys-Behelec au sud. Au nord, les combats opposent Français et Géorgiens; la lutte dure jusqu'à 19 heures sur un front qui se stabilise à hauteur du château.
Au centre, l'attaque allemande est vigoureuse. A 17 heures 30, la ferme du Bois-Joly est prise. Les
Français se replient en lisière des bois, 300 mètres en arrière.A 19 heures, une contre-attaque française permet de reprendre le secteur du château de Sainte Geneviève, mais échoue devant la ferme du Bois-Joly. De son côté, l'ennemi accentue sa pression
qui s'étend au sud vers les Hardys-Behelec et l'abbaye. Des rassemblements ennemis sont signalés au nord : à moyen terme, c'est l'encerclement. Le commandant Bourgoin et le colonel Chenailler décident de disperser la base ; commencée à 22 heures, l'évacuation se poursuit jusqu'à minuit (9).Le 19, au matin, l'artillerie allemande pilonne la ferme de la Nouette. Très vite, les occupants constatent
que l'adversaire a disparu . La répression est alors brutale, et une chasse contre les " terroristes"
s'organise dans toute la région (10). Les blessés et prisonniers capturés sont assassinés. . .(9) L'évacuation concerne près de 2400 hommes, une vingtaine de camions et quatre ambulances. Les F.F.I. regagnent leur maquis d'origine sans rencontrer d'opposition sérieuse.
(10) La poursuite est laissée à des unités dites "de l'est" ; il s'agit d'escadrons ukrainiens et de bataillons géorgiens.Au cours du combat, une trentaine de Français ont été tués; les pertes allemandes sont beaucoup plus
sévères (11). La capacité des FFI à rassembler d'importants effectifs et la quantité de la dotation en armements ont surpris l'ennemi. Ils expliquent en partie les lourdes pertes des Allemands.(11) Le chiffre avancé de 560 semble exagéré ; le nombre de 300 Allemands tués (estimation du capitaine Fay, officier de liaison britannique parachuté à la Nouette) paraît plus près de la réalité. . .
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par sgidplan le 9 Mars 2015 à 19:57
Rencontre historique au Musée de Saint-Marcel organisée par Emmanuel Thiebot
*Emmanuel Thiébot historien, responsable des événements culturels au Mémorial de Caen.
Emmanuel Thiébot
Thème : « La résistance une histoire de famille ! »Organisait le 21/11/2009 une rencontre des villageois de Saint Marcel (56) contemporains de la Résistance pendant l'occupation et jusqu'à la libération. Une centaine de personnes avaient fait le déplacement.
Il déclara : " La Résistance n'est pas quelque chose de monolithique, mais plurielle de par les individus mais aussi de par la géographie des lieux où sont menées les actions. "Construit sur les lieux mêmes des combats, dans un parc boisé de 6 hectares, le musée de la Résistance bretonne de St Marcel perpétue le souvenir de l'ombre qui avait refusé le joug de l'occupant.
Les mémoires, malgré l'âge " avancé " des protagonistes étaient bien réactives. Des mots se bousculaient, une anecdote en entraînait une autre. Ils revivaient tous ces acteurs leur jeunesse motivée par l'action et l'envie de libérer leur région, leur pays de cet occupant très, trop envahissant. La région était assiégée par 150 000 soldats provenant des régiments suivants : armée de terre, marine, aviation, organisation Todt, etc… Le PC est situé au Mans, la VIIème armée est aux ordres du général Dollmann. Parmi ces 150 000 hommes 10 000 citoyens soviétiques, servant sous l'uniforme allemand, renforceront les effectifs des différentes unités d'infanterie stationnées en Bretagne. Ces bataillons (un bataillon entre 500 et 1 000 hommes) de l'Est vont participer activement à la lutte contre les maquis (maquis de Saint Marcel). Leur sillage n'était fait que d'exécutions, de pillages, d'incendies et de viols.
Des femmes, des hommes dés 1942, s'étaient organisés, structurés. Des fermiers, boulangers, bouchers abritaient, transportaient messages, armes, munitions, nourriture pour que le Réseau soit soutenu dans son action. Tout le monde, toute la structure familiale agissait. Du facteur dont la sacoche ne comportait pas que des lettres… à la receveuse qui dormait sur des sacs postaux pour laisser son lit à ces combattants de l'ombre. Tout le monde savait, tout le monde agissait, de l'instituteur aux élèves personne ne parlait. Ils ont agi pendant des années dans l'ombre, à la barbe de 150 000 soldats occupants. Le débarquement n'aurait jamais pu se dérouler si ces combattants de l'ombre appuyés par le parachutage de la 2ème compagnie (environ 450 hommes) n'avaient pas inlassablement harcelé l'ennemi pas une multitude de petites actions qui freinaient, voire paralysaient l'occupant dans son action. Les femmes qui participaient à cette rencontre étaient bien plus loquaces que les hommes, petites fourmis infatigables elles semblaient moins vulnérables que les hommes aux yeux de l'ennemi. Bien sûr il y a quelques incohérences à mettre sur le compte du temps, de l'âge ! Cela n'enlevait rien à la qualité des témoignages très dignes, très pudiques voire très réservés. Non nous n'avions pas à faire à des vantards à des mythomanes. Oui nous avons résisté à notre manière, avec nos moyens, mais quoi de plus naturel ! Ces personnes étaient venues spontanément raconter leur vécu dans un contexte bien particulier sans gloriole. Ils racontaient leur guerre de l'ombre comme on raconte des anecdotes de la vie de tous les jours. Ils se " titillaient " pour un détail, pour un vague souvenir, une broutille, mais dans le fond quelle complicité unit encore ces soldat de nulle part. Impressionnant ! Bien sûr comme dans tous les groupes de témoins rassemblés pour revivre ces événements il y avait celui qui : " savait mais ne pouvait pas parler " ! laissant planer sur l'assistance plein de points d'interrogation. Comment dans ces cas retenir le vrai de la vantardise ! Heureusement il était bien isolé et préférait chuchoter à l'oreille de sa voisine plutôt que de dire à voix haute ce qui aurait pu intéresser l'auditoire (…)

L'assemblée attentiveLe maquis de Saint Marcel situé dans les landes de Lanvaux, évoque le célèbre maquis où des milliers de résistants et de français libres se sont rassemblés entre le 6 juin et le 18 juin 1944, résistants et parachutistes SAS (Special Air Service) de la France Libre se sont battus courageusement, infligeant des pertes élevées à l'ennemi avant de décrocher à la faveur de la nuit. En représailles, l'armée allemande brûlera le bourg et les fermes environnants.
Les missions de la Résistance bretonne, dans le cadre du débarquement allié se décomposent ainsi :
Plan vert : sabotage des voies de communications (ferroviaires et routières, en un maximum de points, qui doit ralentir l'acheminement des renforts allemands vers le front de Normandie.
Plan violet : coupure de lignes de télécommunications souterraines et aériennes.
Plan bleu : sabotage de lignes électriques.
Plan rouge : opération de guérilla.
Le 4 juin 1944 la BBC lance un message à l'intention de la Résistance : "les dés sont sur le tapis " annonçant l'imminence du débarquement et l'exécution immédiate des plans vert, violet et bleu.
Au nord de la ferme de la Nouette en Sérent, une prairie particulièrement située avait attiré l'attention d'Emile Guimard et d'Hunter Hue (futur agent du SOE) pour y organiser un terrain de parachutages. Après un contact avec Guy l'Enfant, agent de BCRA (Bureau central de renseignement et d'action) parachuté en Bretagne, ce terrain fut homologué en mai 1943, sous le nom de code " Baleine ". A part un parachutage effectué en mai 1943 pour le compte du BOA (bureau des opérations aériennes), le terrain sera gardé secret jusqu'au jour du débarquement pour y effectuer de gros parachutages d'armes et d'unités aéroportées afin de ralentir la progression des renforts allemands vers le front de Normandie. Jusqu'au jour J, Emile Guimard vient voir régulièrement le fermier de la Nouette, M. Pondard, pour s'assurer que l'ennemi ne se doute de rien.
Le 5 juin 1944, le colonel Chenailler (Morice), chef des FFI du Morbihan, lance un ordre de mobilisation générale aux bataillons de Ploërmel -Josselin, Vannes, Auray et Guémené, ce qui représente 3 500 hommes.
Le premier de ces bataillons doit rallier la Nouette, centre mobilisateur, pour en constituer la garnison permanente. Le reste des FFI du département doit rester en état d'alerte et exécuter les actions de sabotage ordonnées (plan vert)
Le 6 juin à 0h45, le groupe de parachutistes du lieutenant Marienne est accroché par l'ennemi peu après avoir touché le sol. Le caporal Emile Bouëtard est tué (première victime de l'opération Overlord) et les radios sont faits prisonniers avec leurs matériels. Le 7 juin, les groupes des lieutenants Déplante et Marienne arrivent à la Nouette et retrouvent le sergent Raufast et le capitaine André (Hunter Hue, agent SOE) arrivés la veille. La Nouette devient le point de ralliement des parachutistes SAS et des FFI du Morbihan.La Résistance morbihannaise au jour J. La Résistance armée clandestine formée de civils, de professionnels du renseignement, de réseaux d'évasion, etc… étaient encadrés par le SOE, 480 agents de ce service secret furent parachutés en France occupée. Leurs missions étaient d'encadrer, d'armer, de ravitailler, de fournir les moyens de communications, de soigner, en un mot de permettre à ces hommes d'agir de survivre.
Le maquis de Saint Marcel : les résistants de la région de Malestroit arrivent en grand nombre. Une véritable foule se presse vers la Nouette et dans les bois environnants. Les chefs de groupe commencent l'instruction des hommes. Il faut tuer des bêtes pour nourrir tout ce monde; on installe une boucherie, une cuisine et une boulangerie. Des groupes électrogènes sont mis en place pour charger les batteries des postes radio, ainsi qu'un atelier de réparation automobile. Le 10 juin le commandant Caro arrive avec son bataillon au complet. Au fur et à mesure, tous les chefs départementaux de la Résistance arrivent avec leurs radios au PC de la Nouette. Edouard Paysant, chef du BOA, s'installe, quant à lui, à la ferme du Parc avec Irène sa secrétaire et toute son équipe radio disposant d'un important matériel. Des groupes arrivent constamment au maquis, ils viennent de partout, de Redon, de Vannes, de Pontivy, voire de Lorient et de Rennes. Leurs souliers sont troués, beaucoup portent des sabots et vont et viennent, fébrilement, dans des tenues des plus étonnantes. Ces " va-nu-pieds superbes " brûlent du désir de se battre.
Le commandant Bourgoin arrive dans la nuit de 9 au 10 juin, en même temps qu'une cinquantaine de parachutistes et cinquante containers d'armes. Il est surpris par l'atmosphère de kermesse qui règne sur les terrains de parachutages. Tous les civils du voisinage ont assisté au largage et se sont jetés sur son parachute afin d'en déchirer un morceau en souvenir. En effet, celui-ci était de couleur " bleu-blanc-rouge ", petite fantaisie du commandement SAS. Dans la nuit du 13 au 14 juin, le 2ème bataillon FFI du commandant Le Garrec, composé de 900 hommes de la région d'Auray, arrive au camp afin de recevoir des armes. Il s'est fait durement accrocher par l'ennemi dans les bois de Saint Bily (près de Trédion)
Le ravitaillement d'une telle quantité d'hommes pose d'énormes problèmes. Il faut aller chercher quotidiennement vingt barriques d'eau potable dans les fermes alentour. Des paysans des environs se succèdent toute la journée, amenant au camp du bétail, des légumes, du cidre, etc…Trois principales organisations sont implantées dans le Morbihan :
L'AS (armée secrète) regroupe tous les mouvements de la Résistance, des réfractaires STO, des résistants appartenant à des réseaux décimés. Elle compte début 44 quatre bataillons.
Les FTPF (Francs-Tireurs et partisans français. Créés par le parti communiste prônent l'action immédiate par des sabotages et des attentats.
L'ORA (Organisation de la Résistance armée). Installée en Bretagne depuis 1943 avec la majorité de ses cadres d'officiers d'active ou de réserve, elle compte 3 bataillons début 1944.
L'ensemble de ces formations le 1er février 1944 sera regroupé par la CFLN (Comité français de la Libération nationale) au sein des FFI (Forces françaises de l'intérieur).
La Résistance jouera un rôle important le 6 juin 1944 en ralentissant considérablement les mouvements des troupes allemandes vers la Normandie.Le 18 juin, à 4h30 deux tractions avant de la Feldgendarmerie de Plöermel, en patrouille, franchissent l'entrée du camp.
La première voiture est stoppée par un tir d'armes automatiques au premier poste FFI. La seconde, s'apercevant de l'embuscade, accélère l'allure puis est arrêtée au second poste par un projectile d'arme antichar, tiré par le parachutiste Pams. Un bref combat s'engage au cours duquel quatre Feldgendarmes sont tués et trois faits prisonniers.
Un seul s'échappe jusqu'à Malestroit et donne l'alerte. Du côté FFI, on compte un tué et deux blessés graves. Parachutistes et FFI établissent un dispositif défensif et se préparent à soutenir une vive réaction de l'armée allemande qui ne peut manquer de se produire dans les heures à venir.
A 6h30, la garnison allemande de Malestroit est alertée.
A 8h15, la troupe investit le bourg de Saint Marcel. Un jeune cultivateur prend ses jambes à son cou pour prévenir le commandant Le Garrec à son PC situé à la ferme des Grands-Hardys. Le camp est maintenant en alerte.
A 9h00 l'ennemi qui sous-estime l'importance du maquis, déploie une compagnie de (200 hommes) sur un front de 500 mètres, en direction de la ferme du Bois-Joly.
Un groupe d'infanterie équipé d'une mitrailleuse, longeant les fossés et les haies, progresse sans être vu jusqu'au poste FFI. Les allemands mettent leurs armes en batterie et tuent les quatre hommes de la position. Une balle perdue tue également une jeune fille qui garde les vaches. Les fusils mitrailleurs français ouvrent le feu dans toutes les directions. Les soldats allemands masquent leur retraite en lançant des grenades fumigènes.
Durant cette première action qui a duré environ une demi-heure, les allemands ont subi des pertes importantes et doivent se replier en direction de Saint Marcel. Du côté français, le choc a été subi par une section SAS du capitaine Larralde, deux sections du bataillon Caro et une unité du commandant Le Garrec. Le parachutiste SAS Daniel Casa, servant un fusil mitrailleur Bren au sud du Bois-Joly, a été mortellement blessé (il venait d'avoir 20 ans)
A 10h00 les allemands, une fois réorganisés, progressent en direction de Sainte Geneviève qu'ils pensent être le PC. Ils déploient, cette fois, deux compagnies (400 hommes) qui utilisent des mortiers et des grenades en direction de la lisière des bois d'où partent les rafales d'armes automatiques françaises. Les hommes du capitaine Larralde, soutenus par l'appui de feu des jeeps, maintiennent leurs positions mais réclament renforts et munitions. La section Morgant, composée de cheminots d'Auray, leur est envoyée en soutien. Entre-temps, des agriculteurs de la région font le va-et-vient entre le PC de la Nouette et Sainte Geneviève, croulant sous le poids des munitions. Le commandant Le Garrec leur envoie en renfort le " corps franc " Guilas composé de 40 jeunes volontaires et de 3 parachutistes.
Un fusil mitrailleur, placé tous les 10 mètres, stoppe les allemands et l'attaque est de nouveau repoussée avec de lourdes pertes. Du côté français, il y a aussi des morts et des blessés. Les corps de deux parachutistes, le sous-lieutenant Brès et le soldat Malbert, sont évacués en jeep jusqu'à la Nouette.
Au poste de commandement de la Nouette, le commandant Bourgoin demande des ordres et l'appui de l'aviation par radio en Angleterre. Les civils reçoivent l'ordre d'évacuer le camp le plus vite possible, manœuvre très périlleuse car l'ennemi, à l'affût, maintient sa pression et tire sur tout ce qui bouge.Troisième attaque :
A 14h00, les Allemands, renforcés par 300 parachutistes, repartent à l'assaut sur son front de 2 kilomètres. A 15h30, un message tombe à l'état-major du 25ème corps d'armée de Pontivy : Un détachement du 2ème régiment de parachutistes est au combat près de Saint Marcel contre un groupe de terroristes et demande renforts et munitions. La 275e division d'infanterie (PC à Redon) envoie deux commandos de chasse et tient prête à intervenir une autre compagnie.
La situation devient intenable pour les maquisards, ils ont affaire cette fois à l'élite de l'armée allemande ! La défense est démantelée à hauteur du château de Sainte Geneviève et des combats acharnés se déroulent au pistolet mitrailleur, à la grenade et au couteau…
Vers 15h30 trois " squadrons " de chasseurs bombardiers, appartenant à l'USAAF (US Army Air Force), attaquent à la bombe à fragmentation les positions ennemies. Pendant plus d'une heure, ils mitraillent les colonnes et les rassemblements allemands autour de Saint Marcel.
Les soldats ennemis, pris de panique, se dispersent dans tous les sens et les prisonniers en profitent pour s'échapper. Une fois les avions américains partis, les combats reprennent avec acharnement.
A son retour de mission, un des pilotes, le Major Tice, notera dans son rapport que jamais de sa vie il n'a autant tiré sur un seul objectif !
Vers 18h00, une compagnie de la 275e division d'infanterie, venue du camp de Coëtquidan, est débarquée au sud du maquis et attaque en direction du château des Hardys-Béhélec. L'attaque est d'une extrême brutalité. Malgré de lourdes pertes, elle progresse jusqu'à 500 mètres du château, les FFI décrochant pied à pied sous un feu d'enfer.
Dans le même temps, un commando de chasse du 17e état-major de génie de la forteresse, basé au château de Villeneuve, lance une attaque à partir de la rivière de la Claie. Il réussit à progresser jusqu'à une crête située à 700 mètres du PC de la Nouette qu'il prend sous son feu. Une violente contre-attaque du corps franc Guilas délogera l'ennemi, déplorant un mort et un blessé.
Vers 19h00, le capitaine SAS Larralde, à la tête de ses paras, soutenu par les FFI du bataillon Caro, contre-attaque et reprend les alentours du château de Sainte Geneviève mais ne peut déloger l'ennemi du Bois-Joly.
A la tombée de la nuit, l'ennemi déploie maintenant plus de 1 000 hommes en arc de cercle, du château de Sainte Geneviève jusqu'à l'ouest du château des Hardys-Béhélec. En prévision de l'assaut final, la 275e division d'infanterie détache vers Saint Marcel une unité du 298e bataillon géorgien et deux bataillons du 3e régiment d'artillerie…
Au PC de la Nouette, il apparaît évident que l'on ne pourra tenir plus longtemps sans épuiser complètement les munitions. On redoute, non sans raison, que le lendemain l'attaque reprenne avec des troupes fraîches appuyées par de l'artillerie. Le commandant Bourgoin et le colonel Morice décident la dispersion de la base tant qu'il est encore possible de décrocher dans de bonnes conditions, celle-ci n'ayant pas encore été encerclée.
Le décrochage commence vers 22h00 et plus de 2 000 hommes, 20 camions surchargés d'armes et de munitions s'évanouissent dans la nuit, pendant qu'une compagnie d'Auray, encadrée par des parachutistes SAS, reste en protection.
Durant la nuit, des colonnes de FFI se replient sans dommage en direction du château de Callac, lieu de rendez-vous, d'où ils devront regagner leur maquis d'origine. Il faut abandonner une grosse quantité de matériel reçue la nuit précédente.
Le capitaine Puech-Samson, commandant la compagnie de protection, donne l'ordre à deux parachutistes de faire sauter le dépôt d'armes et de munitions, qui représente plusieurs dizaines de tonnes de matériel.
Lorsque les allemands investiront la Nouette, une équipe de l'Abwehr (service de renseignement et de contre-espionnage) dépêchée de Rennes notera dans son rapport : " Un matériel d'une richesse et d'une importance extraordinaires a été découvert au PC du maquis dont le tri demandera plusieurs jours. Après trois jours de travail, on ne peut encore avoir une idée du butin récupéré. 30 camions ont déjà étaient enlevés du camp et sont en cours d'inventaire. "
Au cours de la bataille 28 français ont été tués dont 6 parachutistes SAS. On compte également 60 blessés et 15 prisonniers…
Du côté ennemi, les pertes sont beaucoup plus élevées. Les assaillants avaient sous-estimé l'importance du maquis et la capacité des " terroristes " à se battre. L'armée allemande notera dans le rapport de cette journée : " la résistance ennemie a toujours été tenace et opiniâtre. "
Pour les résistants, des pertes beaucoup plus importantes seront à déplorer dans les jours à venir. Ils seront traqués par les troupes géorgiennes et la milice française lors d'une véritable chasse à l'homme.
Le 19 juin, au lever du jour, les allemands reprennent l'attaque mais doivent constater que les forces qui les ont tenus en échec leur ont filé entre les doigts. Ils se vengent en exécutant les blessés qu'ils découvrent ainsi que les civils restés chez eux.
La Wehrmacht organise une chasse sans merci contre " les terroristes " et lance, dans la campagne, des groupes très mobiles d'environ 80 hommes. Ces unités ukrainiennes et géorgiennes fouillent sans cesse les bois et les villages, massacrant les FFI isolés et terrorisant la population. Les prisonniers seront soit fusillés, soit dirigés vers les camps de déportation.
Le 25 juin elle incendie les châteaux des Hardys-Béhélec et de Sainte Geneviève, puis le 27, les fermes et le bourg de Saint Marcel, n'épargnant que l'église, le presbytère et les écoles.Le combat du maquis de Saint Marcel eut un énorme retentissement dans toute la Bretagne occupée. C'était la première fois que l'armée allemande était tenue en échec par des jeunes combattants FFI, entraînés par le courage de leur chef, l'expérience et la fougue des parachutistes SAS.
Les hommes du maquis savaient désormais que la puissante Wehrmacht n'était pas invincible.
Contemporain de la Seconde GuerreMondiale.
Vous qui passez à proximité car on ne passe pas à Saint Marcel, on y va ! Arrêtez-vous un instant pour commémorer le courage de cette population ordinaire qui a transcendé la terreur qui régnait pendant cette occupation. Comme quoi des villageois, toutes générations confondues, ont su, ont pu résister, se sont organisés pour mener, à leur niveau, avec dignité le combat de l'ombre. Nous ne pouvons que rendre hommage à ces résistants de l'ombre qui ont agi avec courage et désintéressement pour chasser l'ennemi. Ils ont fait la différence. Le courage modeste face à l'esbroufe de ces résistants de la dernière heure.
Je remercie Emmanuel Thiébot de m'avoir donné l'occasion de découvrir ce haut lieu de la Résistance et de la Mémoire.
Je remercie le musée.Jean-Jacques DELORME-HOFFMANN.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par sgidplan le 8 Mars 2015 à 23:41
A 4 h 30 du matin, ce 18 juin 1944, Joseph Jégo et ceux de sa section se reposent. dans une hutte tapissée de parachutes lorsque les premiers coups de feu retentissent. Chacun réagit vite et comprend qu’il s’agit d’un accrochage avec l’ennemi. Les fusillades durent quelques minutes à l’autre bout du camp et à l’opposé des positions de la 7ème compagnie. Tout le monde se remue et s’interroge sur ce qui se passe. Bientôt, il est l’heure pour ceux de la petite corvée, d’aller chercher le petit déjeuner à Beauséjour distant d’un kilomètre. C’est l’occasion d’avoir quelques informations sommaires. Ainsi, Joseph Jégo apprend que deux voitures de la feldgendarmerie ont été interceptées. Parmi les huit occupants, un avait réussi à s’échapper et aurait donné l’alerte…
« Vers 8 h 30, les armes recommencèrent à se faire entendre. Une messe dominicale devait être célébrée à 9 h, dans une prairie située entre La Nouette et Beauséjour. La messe était à peine commencée que le prêtre célébrant fut appelé pour aller donner les secours religieux aux victimes. Chaque homme devait rejoindre immédiatement son poste. L’intensité des tirs indiquait que l’ennemi était arrivé en force.
Nous, 7ème Compagnie, en état d’alerte sur nos positions à l’ ouest du camp, alors que des combats acharnés se déroulaient dans la partie est, sommes restés en place toute la journée. Vers midi, une équipe vint encore avec un camion chercher des containers parachutés la nuit précédente. L’heure de la soupe arrivée, je fus de corvée avec un copain pour aller la chercher. Au P.C. du bataillon, on poussait à l’ardeur au combat en servant généreusement du vin, ce qui ne me sembla pas très sérieux…Vers 19 h 40, alors que la bataille était encore vigoureuse au sud du camp, quelques gars de la section partirent en renfort. L’évacuation du camp étant déjà bien commencée, le chef de mon groupe, Jean Chaumery, reçut un ordre de repli. Nous le suivîmes à travers bois.
Alors qu’il faisait nuit, au lieu-dit Rohéan, Chaumery dit : «Moi, je rentre chez moi, pas question de me suivre jusqu’au bout. Les ordres sont que chacun rejoigne son coin comme il l’entend et attende de nouveaux ordres !». Le groupe se divisa donc. Avec mon ami Gabriel Guimard, nous avons décidé de revenir directement à notre domicile, empruntant chemins et sentiers, traversant fermes et villages; partout les lumières restèrent éteintes malgré les aboiements des chiens. A la ferme du Najeo en Callac, je fus tenté d’ abattre un chien tellement il s’acharnait à nous poursuivre. Nous avons entendu la détonation du dépôt de matériel de guerre, entreposé à la Nouette; une énorme lueur s’éleva dans le ciel… »Au matin du lundi 19 juin, Joseph Jégo eut une discussion sérieuse avec son père : « Dans un tour d’horizon sur les événements, lui, l’ancien combattant de la grande guerre, n’admettait pas facilement le retrait aussi précipité des combattants du camp. Je m’employai alors à le rassurer. Non, nous n’abandonnions pas le combat, comme en juin 40. Coûte que coûte, nous allions combattre jusqu’à la libération et, moi, j’irais jusqu’au bout. L’un comme l’autre, nous nous inquiétions aussi du sort, réservés par l’ennemi à tous ces braves gens – ceux du voisinage du Pelhué notamment- qui soutenaient le maquis »
Le grenier à foin de la ferme était alors encore plein de combattants. Dans les bois de pin du Pelhué, des camions plus ou moins chargés de matériel en provenance du camp de Saint-Marcel, étaient dissimulés. Une pluie fine commençait à tomber lorsque Joseph Jégo partit en compagnie de son ami Gabriel Guimard retrouver leurs chefs.
Morizur l’informa que l’état-major, avec une partie des troupes et du matériel, s’était retranché au château de Callac et dans les bois environnants. Il reçut l’ordre de s’y rendre pour transmettre au reste de la compagnie les directives à suivre.
« Le capitaine Guimard conversait à Callac avec le lieutenant Marienne et trois ou quatre officiers S.A.S. Il me présenta. Marienne, tête nue, le front bandé, très souriant, expliquait par des gestes des deux mains certains épisodes de la bataille de Saint-Marcel… »
Puis, Guimard me demanda de me mettre au service de Marienne. « Je suis le seul, me dit-il, qui reste ici avec les parachutistes pour prendre des décisions. Tu dois accompagner le lieutenant Marienne. Voudrais- tu rechercher avec lui les solutions à adopter pour l’avenir du maquis ?… Il faut s’attendre à une réaction vive de la part des Allemands. Ils ont eu quatre cent cinquante hommes hors de combat alors que de notre côté, nous avons eu quarante-deux tués. Il faut que je rejoigne mes supérieurs, Morice et Bourgoin, sans moi ils sont perdus. Il est vrai qu’ils ne connaissent pas la région et ne sont pas connus de la population qui va se méfier !. Quant à toi, transmets à Morizur l’ordre de rejoindre le bataillon sur les landes de Meslan… ».Après un rapide aller-retour au Pelhué pour voir Morizur, Joseph Jégo était vite de retour au camp dans le bois près du château.. Les S.A.S étaient de guet avec quelques F.F.I.. A sa grande surprise, il constata que les S.A.S. étaient environ quatre-vingts, alors qu’ils les croyait une quarantaine. De petits dépôts d’armes étaient alors un peu partout sur le terrain…
« Les officiers Marienne, Deschamps, Tisné, Skinner, les capitaines anglais André Hunter-Hué et Fay, le sous-lieutenant polonais Jasnienski sont groupés en conversation. Marienne ouvre une grande carte de la région qu’il pose à même le sol, elle est plastifiée, ce qui est heureux car la pluie tombe de plus en plus. Pour l’examiner, chacun prend position accroupi ou à genoux. Marienne me demande s’il serait possible d’organiser le ravitaillement en nourriture pour autant d’hommes, pendant quelques jours… Je m’interroge: comment va réagir la population qui peut, seule, nous soutenir… Je reste hésitant, sans réponse. Marienne conclut : «De toute façon, il faut que nous partions d’ici ! « Puis il me demande de le guider dans la nuit jusqu’au secteur du château de Kerfily. J’arrive à le convaincre que, compte-tenu des chargements des hommes en matériel, de l’état des chemins, du temps si mauvais, un tel parcours est impossible en une nuit. Je propose pour première étape la lisière des bois de pins attenant à la forêt de Lanvaux, un coin situé au sud du pont de Lézourdan. Marienne me demande d’aller prévenir le châtelain, François de Lignière, de notre départ immédiat. Celui-ci, qui avait à plusieurs reprises demandé que l’on quitte ses bois, se montra soulagé… »
C’est dans une obscurité presque totale sous une pluie torrentielle, que la compagnie dirigée par Marienne, accroché à ma veste, s’engagea dans les bois de pins. A Talcoëtmeur d’en haut, Eugène Tastard et son épouse Thérèse étaient aussi sous la pluie, occupés à sortir du pain de leur four de campagne situé à une vingtaine de mètres de leur ferme. Au passage, chacun sentit l’odeur du pain chaud… «L’orage se mit à gronder et la pluie redoubla, l’eau monta vite à mi-jambe et avec la pente, dévala en emportant toutes sortes de détritus. Arrivés à la rivière, Marienne ordonna une halte. Nous nous rendions compte que nous avions perdu la moitié des hommes. Je proposais alors de retourner chercher les égarés mais Marienne ne voulut absolument pas. Tout le long du parcours, il m’avait tenu par la veste !… »
Finalement, le groupe se divisa en se fixant rendez-vous près du pont de la Claie dans la nuit du 4 au 5 juillet. Marienne suivit Joseph Jégo jusque chez lui, à la ferme de Pelhué avec deux compagnons, le capitaine André et l’adjudant Chilou. Marienne était éveillé depuis quarante-cinq heures et venait de se battre quinze heures durant… Le grenier fit encore l’affaire… « Pour moi, affirma Joseph Jégo, je ne vis pas plus de danger à coucher dans mon lit. Mais dés le lendemain, mon inquiétude m’obligea à surveiller autour de la ferme. Très tôt, toute ma famille était debout pour préparer le petit déjeuner. En effet, il y avait encore beaucoup de monde chez nous. Marienne, Chilou et André demandèrent d’utiliser le fil à linge pour faire sécher leurs uniformes…
A 8 heures, ils étaient encore au grenier lorsque Morizur, en uniforme anglais, et le lieutenant S.A.S. Martin pénétrèrent dans la cour. Ils venaient aux nouvelles et prendre le petit déjeuner. A ce moment même, deux Allemands (ou plus exactement des Russes, qui s’étaient engagés auprès d’eux par anticommunisme ), passèrent à cheval à proximité de la ferme. Heureusement, ils ont semblé ne rien voir… Pourtant, les hommes en tenue militaire dans la cour ainsi que les uniformes sur les fils à linge étaient à portée de vue. Un coup d’oeil par une fenêtre en direction des bois nous renseigna qu’une troupe d’hommes venait de s’établir à 300 mètres de notre ferme. Rapidement, Marienne, Chilou et André saisirent leurs uniformes et se réfugièrent dans un chemin creux à 90 mètres au sud de la maison. Marienne, l’uniforme sur le bras, s’habilla dans le chemin. Nous avions établi notre P.C dans un cabanon. Il n’était plus qu’à 300 mètres des Allemands et des Russes. Au Pelhué, il y avait bien des choses compromettantes pour ma famille et une perquisition ennemie était à redouter. Marienne avait souhaité connaître l’importance de cette troupe ennemie. Mon père avait aussitôt demandé à mon frère Lucien, qui n’avait que 14 ans d’aller voir. Il prit alors une hache et alla chercher un petit sapin qu’il coupa au milieu d’eux tout en les comptant : Trente-cinq chevaux étaient attachés aux sapins. Les soldats l’interrogèrent : «Ici, pas terroriste ?» D’un air innocent, il se contenta de dire que non. Puis, il revint à la ferme, le sapin sur l’épaule, et nous transmit ce qu’il avait appris. Le groupe que nous formions alors – une quinzaine d’hommes- décida de rejoindre la Claie et de passer le pont de Lézourdan, pour atteindre la forêt… »
Au pont, un agent de Sérent, Alexis Babin rejoignit le groupe. « Il s’était renseigné au Pelhué. La cavalerie russe était partie en direction de Callac bien avant midi. Il était venu apporter des renseignements à Marienne au sujet de dépôts d’armes et munitions. Puis, Mme Morizur arriva accompagnée d’un agent de liaison, Annick Perrotin. Elles étaient venues du bourg avec bien des difficultés en empruntant d’étroits sentiers, traversant landes et champs pour arriver au P.C. qui avait déjà été évacué… Mme Morizur était très inquiète. Son mari lui recommandait de quitter son domicile. Quant à Annick, elle se vit confiée quelques missions avant de repartir pour le bourg.
Un peu plus tard, Marienne ordonna à Chilou, à Guimard et à moi-même, de tenter de prendre contact avec des groupes de S.A.S. qui, la nuit précédente, devaient s’être «planqués» dans le secteur. C’est ainsi que nous avons retrouvé le lieutenant Tisné qui, avec son équipe, cinq hommes en tout, s’était réfugié dans un lieu particulièrement discret, la Roche du Pélican, site masqué par une étendue de broussailles. Puis, un autre groupe, dans une maison abandonnée dans les bois. Les fermiers voisins avaient pris le risque de les ravitailler…
De retour en haute forêt où nous devions normalement retrouver nos chefs, ceux-ci avaient disparu!… Nous comprenions qu’ils s’étaient volontairement séparés de nous. Il faisait nuit et Guimard nous guida pour revenir au chemin de Lézourdan. A destination, il décida encore de passer la nuit chez lui. J’invitai Chilou à venir avec moi au Pelhué et après un bon dîner, nous passâmes la nuit au grenier avec nos armes… »Le lendemain, jeudi 22 juin, à midi trente, toute la famille Jégo ainsi que Chilou déjeunait lorsque quelqu’un frappa. Tout le monde se tut. Mathurin Jégo dit d’entrer. Une grande jeune femme blonde se présenta. Personne ne la reconnut. Anne Créquer se disait agent de liaison. Elle demandait Joseph Jégo, elle devait se rendre auprès de Marienne. Elle savait qu’il était, ainsi qu’André et Morizur, à la ferme de Kergoff près de la Claie, en direction de Cadoudal chez un certain Le Page.
Joseph Jégo finit, après une longue marche, par retrouver le lieutenant Marienne. « Une petite bâtisse en pierre à la couverture de paille, un peu isolée des autres bâtiments était devenue sa nouvelle cache. Le fermier Le Calonnec est de guet. Immédiatement, sans guère nous parler, il nous conduit à la porte de la maisonnette qui se referme vite derrière nous. C’est une bergerie vide. Dans une sorte de grenier perdu : une construction en rondins recouverts d’une épaisse couche de paille et de foin. C’est là qu’étaient les officiers. Aprés s’être assurés de qui nous étions, Morizur découvre le trou d’accès et place une échelle. Anne Créquer monte la première, échange ses ordres de missions en quelques minutes, puis redescend et repart. A mon tour, je me place sur le cinquième barreau de l’échelle pour échanger des renseignements à voix basse… »
Marienne lui demanda de contacter aussitôt le commandant Bourgoin. Celui-ci campait dans les environs du Creux en Saint-Aubin. Marienne le chargea de réclamer pour lui, au plus vite, une équipe radio. Cette tentative fut vaine.
« Au Rémungol d’en haut, plusieurs personnes nous dirent de nous éloigner vite car les Allemands fouillaient partout et venaient de passer… Nous sommes restés camouflés dans le fossé à même le talus d’un coin de champ, le colt au poing. Après une demi-heure d’attente, une fusillade eut lieu de côté de Talcoëtmeur. « Ils sont sur nos petits gars, c’est certain » affirma Chilou. Pas très rassurés, nous sommes restés au moins deux heures sans bouger… Le soir même, nous décidions de nous rendre à Talcoëtmeur d’en bas. Au gîte des S.A.S,. il n’y avait plus personne, quelques pièces d’armes cassées éparpillées sous un pommier dont le tronc portait une large blessure ; des franges de pansements et de tissus militaires maculés de sang. A la maison Moisan, tout le monde restait sous le choc. Mme Moisan nous dit qu’un de ceux du groupe attaqué devait se tenir dans les environs. Nous sommes partis à sa recherche. Nous suivions les sentiers les uns après les autres. Chilou sifflait légèrement de temps en temps, et dans cette nuit opaque, cela me donnait des frissons. Enfin, un rescapé, le S.A.S André Gas, répondit à notre appel. Nerveux et tremblant, il nous dit que Guégan, son Caporal, avait été blessé et capturé et que ses compagnons avaient fui dans la mauvaise direction. »
Joseph Jégo finit en définitive par apprendre que Marienne était à Quénélec et avait besoin de lui. Il le retrouva vers minuit…
Marienne, mécontent de constater qu’il n’aurait pas d’équipe radio, renvoya Joseph Jégo au Creux pour retrouver le commandant Bourgoin mais, cette fois-ci, accompagné du capitaine anglais « André ». A La Foliette, petit village à deux kilomètres du Creux, Joseph Jégo rejoignit enfin le commandant Bourgoin… Pour ce dernier, les décisions à prendre n’étaient pas simples : il lui fallait maintenir les liaisons, continuer l’action tout en veillant à la sécurité de ses hommes et des populations locales.Le 25 juin, l’observatoire allemand de la Grée fut bombardé, mais l’édifice fut malheureusement épargné.
Le capitaine Guimard avait établi une permanence à la ferme de Jean Perrotin à Bréhélin. Joseph Jégo resta auprès du capitaine, intégré à son « équipe de garde du corps »…« Pendant mon temps libre, je parlais avec Perrotin, homme très aimable, ancien prisonnier de la guerre 1914-1918. J’ai vite compris qu’il est bien conscient d’avoir pris de gros risques en acceptant d’ héberger tout ce monde. La fille, Bernadette, était d’un dévouement admirable, le fils Gabriel surveillait en permanence les approches du village. »
Au cours de cette période, Joseph Jégo fit vraiment beaucoup de marche et de vélo pour accomplir ses missions.
« Avec le capitaine Marienne, je me souviens être allé rejoindre le commandant Bourgoin, alors que des patrouilles ennemies étaient nombreuses à parcourir la région. Marienne prit ses deux musettes, l’une était lourdement chargée de munitions, puis sa mitraillette et une carabine. Pour ce voyage de nuit, nous ne devions emprunter que des petits sentiers à travers la campagne. Aussi, lorsqu’il était indispensable de traverser une route, il nous fallait faire halte et observer avec soin les environs. Il ne fallait pas se laisser surprendre par l’ennemi ou par leurs complices français… Ne connaissant pas bien la région après le village de Kermorin, au nord de Plumelec, je me décidai à prendre le risque de demander notre chemin à Joseph Nicolic, une de mes connaissances. Joseph accepta de nous guider en nous invitant à redoubler de prudence. A l’approche de Kervigo, ne sachant plus comment poursuivre, il dut faire appel à un homme du village, Henri Perrotin. Pendant qu’il était parti le réveiller, je me revois attendre avec Marienne, postés et vigilants au pied d’un gros chêne. Notre guide se faisant longuement attendre, la peur commença à s’emparer de moi… L’ennemi pouvait patrouiller de nuit. Finalement, ce fut Casimir Dréano, un ancien combattant de 1914-1918, qui nous conduisit jusqu’à «La Croix des Epinettes». «Vous avez la route à cinquante mètres, nous dit-il, mais autant que je vous laisse, je ne connais rien après». Alors, j’ai bien dû me diriger à la visée car il était impossible de retrouver les sentiers empruntés de jour. Nous avons encore traversé des champs, des landes, des prairies et d’autres chemins creux, nous arrêtant plusieurs fois au moindre bruit… »Après la bataille de Saint- Marcel, les Allemands n’avaient trouvé à la Nouette qu’un lieu déserté. Ils brûlèrent tout et se vengèrent sur les blessés et les retardataires. Dans les jours qui suivirent, leur hargne à retrouver les terroristes ne fit que croître.
« Quelques temps après cette équipée nocturne, j’appris qu’il devait se passer des choses graves à Plumelec. Inquiet, je décidai d’aller au Pelhué pour en parler à ma famille.. A Bréhé, chez mon oncle Joseph Jégo, à ma surprise, je retrouvai mes deux frères Lucien et Léon. Ils craignaient qu’une femme qui s’était présentait comme agent de liaison, au Pelhué ne soit qu’une complice des Allemands. Nous n’avons pas voulu prendre de risque. Toute la famille devait quitter le Pelhué. Je devais vite y aller. A la maison, Bernadette, ma soeur de 18 ans, finissait de préparer sa valise. Elle avait décidé d’aller chez sa marraine, fermiére à la Grée-Janvier, à Billio. Mon père était terriblement angoissé. Je lui ai recommandé de partir immédiatement, de ne plus s’occuper de la ferme. A Bréhé, beaucoup trop de monde était déjà hébergé, il devait aller du côté de Rémungol où le bon accueil de voisins et amis lui était assuré … »Revenu à la Foliette, afin d’accompagner le retour de Marienne à Quénelec, le commandant Bourgoin venait de prendre connaissance d’ arrestations qui avaient eu lieu à Plumelec. Il confia à M. Jégo cette phrase qui lui est restée gravée en mémoire : «Encore un peu de patience et nous allons saigner le boche…».
Sur le chemin du retour, Joseph Jégo sert encore de guide mais les fermes amies auprès desquelles le petit groupe passe, sont souvent vides… L’ennemi est venu, des parachutistes ont été découverts et les fermiers arrêtés avec eux….
Fin juin, à Quénélec, il y a de plus en plus de monde. Joseph Jégo est pris d’une inquiétude persistante et ne tient pas en place : « Je décide de faire encore un tour dans ma contrée. A l’annonce de mon départ, Marienne et Morizur tentent tout pour me retenir, mais mon intention est de rejoindre le commandant Guimard. Alors Marienne me donne deux billets de mille francs à remettre à l’adjudant Chilou. Je me rends à Lézourdan en évitant Le Pelhué, où personne ne m’attendait plus désormais. A Rémungol d’en Bas, Mme Mounier et sa fille Marie m’informent que l’un de mes frères et Chilou, ainsi que plusieurs autres, se sont retirés dans les bois à 200 mètres à l’est de leurs fermes. Je m’y rends et remets l’argent à l’adjudant, ce qui lui permettra d’acheter un veau ou cochon.Repartant à travers bois et champs, à Bréhélin je retrouve Guimard ; nous échangeons quelques renseignements puis il part aussitôt à bicyclette en mission du côté de Guéhenno et ne sait quand il reviendra. A la maison Perrotin, on m’offre à manger ; Gabriel veut faire un tour au bourg de Saint-Aubin. En cours de route, il rencontre une personne qui le prévient que les Allemands sont là. Ils ont cerné le bourg et rassemblent tous les hommes sur la place de l’église. Il revient aussitôt à la maison et se met à surveiller en direction de Saint-Aubin… Je termine ma toilette lorsque Gabriel entre dans la maison, tout effrayé. «Les Allemands arrivent au moulin à vent à 200 mètres !» s’exclame t-il… Sans hésitation, je cours pour prévenir à la Foliette où je rencontre le capitaine S.A.S. Leblond, habillé alors en civil, qui me dit que Bourgoin et Morice ont quitté le village… Vers où faut-il fuir à notre tour ? Je décide de marcher le premier et de nous enfoncer dans un champ de seigle. Au bout de quelques minutes, des coups de feu sont tirés à proximité, quelques balles sifflent au-dessus de nos têtes. Il nous semble alors plus prudent d’attendre la nuit pour repartir. Une pluie fine commence à tomber. Après quelques temps, le capitaine décide de retourner à la Foliette. Moi, au contraire, je choisis de m’éloigner pour avoir plus de renseignements. Perdu dans un lieu que je connais pas, je marche au hasard et j’arrive à un village inconnu. Là, une femme empressée à son travail, me fait comprendre de ne pas aller plus loin : « Par là, c’est la route et les boches passent à tout moment, même la nuit ! » Le chemin cahoteux et boueux que j’emprunte alors me paraît bien long par cette obscurité presque totale ».
A la Foliette, le village est complètement déserté par les maquisards. «A la fenêtre d’une maison sans lumière, quelqu’un me dit qu’ils doivent être partis du côté du Creux. Je décide d’y aller et j’emprunte alors un interminable champ emblavé de seigle que la pluie alourdit… »
Au Creux, sept ou huit hommes affalés sur un tas de paille, se reposent. Henri Tanguy est l’un d’eux. Il a été capturé à Saint-Aubin, mais grâce à une manoeuvre habile, il a échappé aux Allemands et ses menottes ont pu être coupées…
« Dès que le jour commence à paraître, continua M. Jégo, l’un d’entre nous dit avoir la preuve que les Allemands détiennent la liste des F.F.I de Saint-Aubin, qu’ils vont revenir et qu’il faut décamper au plus vite… Alors, je pars à destination de Rémungol d’en Bas pour me renseigner sur ce qui s’est vraiment passé à Saint-Aubin. Mais je pris la précaution de contourner Saint-Aubin en passant par le village de Landrin. J’interroge les gens. Personne ne sait rien, n’a rien vu, rien entendu… Prudemment, je continue pour atteindre la ferme-manoir de La Saudraie. Mais, cette fois-ci, la fermière, Mme Morice, me dit que Rémungol d’en Bas est en feu et me déconseille d’aller plus loin. Je suis à jeun depuis la veille. Cette brave femme m’invite, malgré tout, à passer à table. Le fils de la maison, Jean, sort dans la cour, puis revient le visage décomposé. A sa mère, interloquée par son comportement, il dit à voix basse : «Ils arrivent !» . Nous fuyons aussitôt en courant aussi vite que nous le pouvons. Les murailles d’enceinte de la cour nous protègent des coups de feu avant que nous reprenions notre course folle à travers champs. Jean me quitte pour avertir du danger à Landrin.Quant à moi, je m’arrête pour souffler. Au moment où je me décide à repartir, des véhicules allemands passent sur la route. Profitant de fougères, je me mets à plat ventre. Malgré une pluie fine et ma position inconfortable, je reste ainsi jusqu’à la nuit. La nuit venue, je me porte à la Ville-au-Gal dans l’intention de rencontrer le sergent du secteur (F.F.I.), Henri Tastard, habitant au village même. A l’entrée du hameau, je rencontre sa mère. Elle est très inquiète et me dit : «Mon p’tit gars, ne reste pas au village, mais ne va pas plus loin, tu risques de te faire prendre… »
Par une nuit noire, je repars dans un chemin creux. A peine ai-je fait 50 mètres que je tombe nez à nez avec Henri qui monte au village à pas de loup, mitraillette en mains. Nous sommes réciproquement soulagés de nous rencontrer. Henri m’invite à passer la nuit en sa compagnie. Dans le flanc du coteau à 200 mètres du nord du village, il s’était creusé un trou. Là, terrés comme des renards et armés de mitraillettes, de fusils-mitrailleurs, nous sommes bien décidés à nous défendre farouchement plutôt que de nous laisser prendre. »
La peur… La peur, non de mourir, mais la peur de souffrir et la crainte de parler lors de tortures… Joseph Jégo vécut avec longtemps, au cours de cette bien singulière époque de sa vie …Le 30 juin, Joseph Jégo apprend qu’à Rémungol l’adjudant Chilou a été tué, Henri Mounier et Robert Pichot sont capturés. Cachés dans la nature, Joseph et Henri sont rejoints par plusieurs compagnons F.F.I.: François Carré, Jean Rougy et Lucien Carré. « Toute la journée, nous sommes aux aguets ; les Allemands circulent à tout moment sur les routes qui sont toutes proches de nous. A chaque alerte, nous devons nous embusquer afin de déclencher un feu sur les assaillants avant de nous enfuir. En fin de journée, Henri a pu faire un tour au village. Il me dit tristement que mon père a été arrêté. Accablé, je reste une deuxième nuit dans le trou du coteau.
Au matin du samedi ler juillet, je décide de rejoindre Marienne pour l’informer de ce qui s’est passé à Plumelec et lui demander s’ il y a toujours une liaison établie avec l’état-major…Au campement du Quénelec : plus personne… Alexandre, le fermier, me dit : «Ils ne sont plus ici depuis hier, mais il reste un parachutiste dans le coin du champ, derrière un tas de fagots…». C’est de là, en effet, que je vis un soldat s’arracher doucement, le canon de la carabine en avant. C’était le lieutenant Jaslienski qui me reconnut. Marienne doit être au village du Collédo, me confia t-il, à un kilomètre de là… Parvenu à ce village, je ne le trouvai pas. C’est en définitive à Lilléran, sur la commune de Guéhenno, à la ferme d’Emile Boulvais, le beau-frère du commandant Guimard que je rencontrai à nouveau enfin Marienne
A Lilléran, le camp était installé dans un champ près de la maison du fermier. J’y fus surpris par l’importance du rassemblement ainsi que l’ installation de tout un matériel de cuisine. Je sus rapidement que le commandant Guimard avait demandé à son beau-frère d’ installer le camp ici, chez lui! .L’inaction et la crainte d’être capturés devenant de plus en plus insupportables, beaucoup venaient recevoir des ordres…».
Il fallut encore à M. Jégo beaucoup de marches, de pérégrinations avant de pouvoir finalement retrouver le commandant Guimard au village de Le Lehé, sur la commune de Saint Servant. C’est au cours de ces jours-là qu’il apprit que deux agents de liaison, Anna et Geneviève Pondard, étaient venues prévenir qu’un camion, rempli d’armes, viendrait de nuit de Callac à Lilléran. Des responsables furent désignés pour surveiller les bourgs avoisinants et certains carrefours où l’ennemi pourrait tendre une embuscade… Mais, le camion ne vint pas… Les jours qui suivirent en cette première semaine du mois de juillet 1944 furent rudes pour Joseph Jégo et ses camarades. Les Allemands intensifièrent leur quadrillage de la région. Au camp, le chien de la ferme, énervé par les allers et venues est finalement étranglé, pour ne pas éveiller les soupçons de l’ennemi. Les hommes restent sur le qui-vive et beaucoup d’entre eux dorment mal ou pas du tout. Bien des S.A.S sont encore isolés dans la nature, restés sans liaison depuis le 20 juin. Joseph Jégo et son ami G.Guimard restent en vain « en planque » près du pont de Lézourdan, point de rendez-vous donné à plusieurs S.A.S avant leur dispersion. Dormir en pleine nature, sur un tas de foin providentiel ou au flanc d’un coteau, semble une solution plus prudente pour Jean Jégo. Mais, les patrouilles ennemies se multiplient…« Croyant le 5 juillet être en définitive, plus en sécurité au P.C de Marienne, je me suis résolu à rejoindre Lilléran. Quelle ne fut pas ma surprise de constater que le camp n’existait plus !… Le chemin boueux qui menait à la ferme n’avait plus les traces habituelles. Une grande inquiétude s’empara de moi. Tout était silencieux. A la porte de la ferme, personne ne me répondit. La maison, elle-aussi semblait désertée. J’insistai et frappai durement à la fenêtre. De son lit, le fermier, Boulvais, me pria de déguerpir au plus vite mais, après m’avoir reconnu, il me dit d’aller au Moulin de Châteauneuf. A l’aube, je parvins à ce moulin à eau. Ses pales tournaient. M. Le Pallec, le meunier, semblait très affairé. Il me dit de repartir au plus vite, les Allemands pouvant arriver d’une minute à l’autre. Il me précisa cependant qu’un groupe de paras s’était réfugié à un kilomètres de là dans un grand champ envahi par les genêts… »
Le P.C s’était reformé à Le Quénelec. Renseigné, Joseph Jégo y parvint et put constater un renforcement des hommes de garde. Que s’était-il passé ? Marienne, souriant, est assez fier de raconter la manoeuvre réussie qu’il a menée contre l’ennemi :
«Le camion chargé de matériel a fini par arriver. Mais, il s’est trouvé face aux Allemands au bourg de Guéhenno et nos hommes ont tiré les premiers. Le camion a continué sa route sans être endommagé. A Lilléran, le guide a pris place à côté du chauffeur pour indiquer les changements de direction. Arrivé au bois du Collédo pour y dissimuler le chargement, il a fallu tirer le camion avec des chevaux. Les Allemands ont organisé poursuites et recherches, mais pendant qu’ils s’organisaient, le camp avait été déplacé de Lilléran à Quénelec. On a fait circuler du bétail pour camoufler les traces de toutes natures. Au matin, le fermier Boulvais s’est mis à charroyer du fumier. Les Allemands, déployés toute la journée dans le secteur, n’ont pas pu apercevoir de traces suspectes ».Les S.A.S., au nombre d’une quinzaine, campent à nouveau dans le champ situé en contrebas de la ferme, les radios se dissimulent avec tout leur matériel sous un abri de branchage. Ils émettent à répétition et se plaignent de leurs correspondants de Londres qui renvoient plusieurs fois le message pas compris. Jean Jégo put entendre un opérateur dire : « A force de nous faire répéter, ils vont bien finir par nous faire avoir ».
Marienne venait d’être nommé capitaine à Londres et Guimard commandant. Le nouveau capitaine qui a recu de Bourgoin des directives pour la préparation d’un plan d’action sur une grande partie du département, travaille sur une grande carte, dans le coin du champ, accompagné de sa secrétaire, Anne Créquer, qui porte les données sur un simple cahier d’écolier. Anne en fait ensuite une copie, également manuscrite, pour la remettre au commandant. Marienne conserve celui de couleur jaune-orange et assure qu’il prévoit tout pour qu’en aucun cas il ne tombe entre les mains de l’ennemi.Le cahier de couleur bleu-vert est confié à Marie Thérèse Goyat, une des messagères du maquis, qui n’est pas très rassurée de faire la route avec un tel document, bien qu’elle ait déjà transporté de tels documents et qu’elle en transportera d’autres par la suite.
Le destinataire se trouvait alors au village du Guernion en la commune de Saint-Servant-sur Oust…
Au Quénelec, les agents de mission qui arrivent et repartent en toutes directions sont de plus en plus nombreux. En plus des liaisons à établir entre les différents groupes, il faut trouver de quoi alimenter la cuisine du camp… Les menus ne changent guère : au déjeuner, généralement porc et pommes-de-terre, pour le dîner, soupe au lait. Les cochons sont achetés sur pied dans les fermes, mais encore faut-il en trouver ! Le lait est également acheté dans les fermes des environs car la production de la ferme du Quénelec est totalement utilisée pour fabriquer du beurre. Louis Mahieux, le boucher de Guéhenno, abat les cochons et fournit parfois des viandes de son commerce.
Au camp, la peur d’être dénoncé est présente dans les esprits de chacun. Joseph Jégo se souvient avoir ouvertement fait part de cette crainte à son chef Morizur : « Comment reconnaître l’ennemi s’il se déguise en F.F.L ?… lui ai-je demandé ». Non sans humour, il me répondit : « Le jour, je vois clair. C’est par contre la nuit que mes craintes sont les plus grandes car je n’entends pas très bien… Mais, tu sais, le boche se reconnaît à l’odeur! Il sent mauvais ! Alors… »Certains F.F.I, comme Henri Denoual, envisagent leur engagement dans les parachutistes. Cette éventualité traversa l’esprit de Joseph Jégo, mais les événements en décidèrent autrement.
Le 9 juillet, un dimanche, les Allemands avaient cerné le bourg de Saint-Jean-Brévelay. Sur la place du village, tous les hommes de 18 à 60 ans avaient été rassemblés. Au camp, dès cette nouvelle connue, tout le monde se tint prêt. Marienne estime J. Jégo. Il lui enjoint de se poster avec ses hommes dans un coin du champ et s’il fallait partir, ce serait lui, Jégo, qui lui servirait de guide pour le mener à une nouvelle cache…
« Mon camarade Denoual me dit qu’à l’instigation de Morizur, Marienne avait accepté l’idée d’aller s’attaquer aux Allemands à Saint-Jean-Brévelay, au cours de la nuit. Des prisonniers étaient enfermés à l’école Notre-Dame. On avait songé à les libérer et à évacuer discrètement les habitants les plus proches de l’école… Mais un habitant avait réagi vigoureusement en disant que les Allemands, furieux, mettraient le bourg à feu et à sang. En fait, dès l’après-midi, les prisonniers furent conduits par les Allemands à Locminé… »Le soir, la décision est prise de déplacer à nouveau le camp à Kérihuel en Plumelec. «A notre arrivée, avait annoncé Morizur, nous allons peut-être provoquer une réaction de désagréable surprise de la part des habitants du village, mais, il faut bien que nous nous réfugions quelque part !… « Joseph Jégo, pour sa part, décida de rejoindre l’état-major dans la région de Quily-Saint-Servant. « Au moment de nous séparer, Marienne m’exprima son regret de me voir partir, mais Morizur, au contraire, me fit signe de me hâter car d’autres camarades m’accompagnant étaient déjà en chemin… »
Au village de Castillé en Lizio, ayant quitté le reste du groupe, Joseph Jégo fit halte à la maison Denoual. Reçu par Augustine Denoual, Joseph Jégo constata son inquiétude : son mari n’était pas rentré et toute sa famille était en danger…
Parvenu au Lehé à Saint-Servant, Joseph Jégo alla chez les Boulvais. « La femme, que je connaissais pourtant, ne voulait plus me connaître… Elle ne savait rien, ne dirait rien. Sur mon insistance et après quelques explications, elle finit par me dire que les Allemands avaient visité le village et que maquisards et paras avaient du s’enfuir du côté du château de Castel en Quily. Reprenant ma route par Lizio, à la sortie du bourg, il y avait un barrage. Deux troncs d’arbres étaient disposés au travers de la chaussée, de manière à faire une chicane. Une sentinelle se tenait entre les deux. M’efforçant de faire bonne figure, avec un léger sourire, je ne me suis même pas arrêté et enfilais la chicane sans descendre de bicyclette…A Le Castel, Joseph Jégo put obtenir de certaines de ses connaissances quelques renseignements qui le menèrent au café du Pont de l’Herbinaie… « En arrivant au Pont, j’aperçus Guimard qui longeait le canal avec une fille brune. Faisant semblant de ne pas l’avoir vu, je me dirigea directement vers le café. Je rangea ma bicyclette en l’appuyant au mur, tout près d’un homme occupé à réparer la chambre à air de la sienne. J’entrais et demandais une consommation. A la jeune fille qui vint me servir, je demanda de prévenir Guimard qui, lui, était entré directement dans la cuisine. La fille me fixa du regard, puis quitta la salle sans rien dire. J’aperçus alors Guimard. Il leva les bras et me fit signe de le suivre aussitôt à la cuisine.
D’emblée, je lui fournis tous les renseignements susceptibles de l’intéresser, en lui faisant part que le P.C de Marienne était réinstallé à Kérihuel en Plumelec. Guimard me confia alors que l’homme, réparant sa bicyclette, était l’ officier para Gray, déguisé en civil. La jeune fille brune devait l’accompagner le lendemain matin pour une mission avec Marienne. Elle ne connaissait qu’une partie du chemin et Guimard pensait qu’elle aurait peut-être des difficultés pour atteindre Kérihuel. Il me demanda d’accomplir la mission à sa place. Après un peu d’hésitation, je m’engageais encore à retourner sur Plumelec le lendemain matin. Le dîner servi au café fut simple, mais copieux. N’ayant rien pris depuis le petit déjeuner, je pus apprécier beaucoup. Après quoi, nous avons pu avoir un lit dans une maison voisine. Réveillés vers 5 heures, nous estimions, l’un et l’autre, avoir bien dormi, comme si nous étions en sécurité… Et pourtant ? La famille Lanoëc, avait l’habitude de prendre de tels risques, leur café étant depuis longtemps un lieu de rencontre entre résistants…
Au cours de cette époque, surmonter sa peur a été un défi véritable pour Joseph Jégo qui s’est toujours efforcé d’être particulièrement prudent. En ce mardi 11 juillet 1944, Gray et lui envisageaient donc l’itinéraire le plus sûr pour rejoindre le nouveau P.C de Marienne. « Mon compagnon se sentait rassuré avec ses fausses pièces d’identité assez bien imitées. A bicyclette, nous sommes donc partis pour Kérihuel en Plumelec. Au bourg de Quily, personne dans les rues… J’étais partisan de prendre la route de Lizio et de Saint-Aubin alors que Gray préférait passer par Le Roc-Saint-André et Sérent. A mon grand étonnement, il sortit d’une poche une sorte de carte d’état-major de la région. Posséder alors un pareil document était vraiment imprudent. Mais, Gray était plus âgé que moi et, de plus, un officier. Je préférai ne pas lui faire part de ma stupeur. Les deux itinéraires envisagés ayant à peu près la même distance, je souhaitai passer par Lizio : la veille, les Allemands ne m’y avaient même pas fait descendre de bicyclette alors qu’ils surveillaient tout particulièrement le bourg de Serent. Gray, bien décidé à revenir par la nationale, trancha: l’itinéraire paraissant le moins dangereux fut retenu. Nous passerions par Lizio. Décision qui se révélera, ô combien, lourde de conséquences… »
Arrivés à l’approche du village de Carouge en Lizio, une patrouille d’une dizaine d’hommes, retranchés dans un fossé hors de portée de vue, surgit sur la route à moins d’une soixantaine de mètres de Gray et de Joseph Jégo. Plusieurs fusils furent braqués. L’ennemi établissait un barrage… « Nous roulions côte à côte, mais étions déjà trop près d’eux pour pouvoir nous enfuir. Il fallait faire face… Je pris de l’avance sur mon compagnon pour arriver avec cinq à huit mètres d’avance. Je m’efforçais de faire bonne figure, de prendre un air rassuré. De toute la patrouille, un seul homme parlait correctement français, sans même un accent particulier. C’était un petit soldat bien en chair et très nerveux. Sur sa demande, je lui présentais ma carte d’identité qui était véritable. Il saisit mon portefeuille et contrôla son contenu. J’avais beaucoup d’argent (6 000 F). Je lui répondis que c’était là toutes mes économies. Il me répliqua sèchement qu’étant né en 1922, j’étais donc immanquablement un réfractaire au S. T. 0. Je lui avoua franchement que oui. Il manifesta sa désapprobation en hochant la tête mais me remit mon portefeuille et mes papiers. Alors que je montra ma volonté de poursuivre mon chemin, je fus retenu par mon guidon. Gray, derrière moi, était à son tour contrôlé. Il ne fallut alors pas plus de dix secondes pour que les Allemands s’aperçoivent qu’ils venaient de faire une prise importante. Ils se mirent d’un seul coup à hurler et à parler tous ensemble. Ma bicyclette me fut aussitôt retirée des mains. L’officier braqua le canon de sa mitraillette sur ma poitrine. Cet homme blond foncé, à la face rougeaude, de très grande taille m’impressionna.
Je fus abreuver de questions : « D’où venez-vous ? Où le conduisiez vous ? De quoi avez-vous parlé ? Depuis combien de temps rouliez-vous ensembles ?» Je me contenta de dire que je venais de rencontrer cet homme… Pendant que Gray était déjà victime de brutalités, on m’ordonna de me mettre tout nu. On me fouilla minutieusement: en plus de mon paquet de cigarettes, ils ne trouvèrent seulement qu’une boîte de pâté de porc que m’avait donné le sergent-chef Tastard. L’un d’eux me dit : «Anglais ! Anglais !» A l’interprète, je répliquais que c’était mes parents qui m’avaient donné cette boite et que c’était un produit français car il y avait des indications en français dessus… Je fus ensuite questionné sur les raisons de mon voyage. Je développais un alibi: «En promenade à bicyclette avec un copain qui allait voir son amie, j’avais eu une crevaison. Comme nous n’avions pas ce qu’il fallait pour réparer; j’avais été obligé d’aller chez des gens pour réparer. Mon copain m’avait expliqué la route à suivre et était reparti sans moi. Reprenant la route, je devais m’être probablement trompé de direction et, par conséquent, je m’en retournai à Plumelec… «
Je fus conduit le dos au mur d’une remise qui se trouvait à quelques mètres. Là, l’interprète me demanda de dire la vérité et me posa fermement la question ferme : «Où le conduisiez-vous, d’où veniez-vous ?» Restant sans réponse, l’officier qui avait toujours sa mitraillette braquée sur moi, prêt à m’abattre, me donna un coup-de-poing dans la figure qui m’emporta la peau du nez, déclenchant un important saignement. Après les questions réitérées de l’interprète : «Où le conduisiez vous, d’où veniez-vous ?… «, l’officier qui menaçait toujours de m’abattre, tenta de m’envoyer un deuxième coup-de-poing que j’esquivais et qui ainsi alla dans le mur. Alors, saisissant sa mitraillette, il me donna un brutal coup dans l’épaule. Je me plaignis : j’étais innocent! On m’enjoignit alors de me rhabiller sur la route. Les soldats m’aidèrent à cause de mon épaule. Pendant ce temps, Gray était encore questionné et brutalisé. Sans me laisser le temps de boucler mes souliers, on me commanda de prendre ma bicyclette et de reprendre la route vers Lizio. Conduit par l’un d’eux qui, avec la bicyclette de Gray (les Allemands n’en ayant pas, une voiture sera envoyée chercher Gray) roulait à côté de moi tenant le guidon d’une main et son pistolet, braqué sur moi, de l’autre. Le long de ce parcours de près de deux kilomètres, je fus tenté de jouer ma chance en me jetant sur lui, mais dès que je ralentissais pour être en meilleure position, il me faisait signe de rouler plus vite… »
Au bourg, M. Jégo est jeté dans une voiture sans portière. « Je suis du côté gauche, dès que je bouge les mains, un soldat me les remet sur les genoux. Je devine que je suis conduit à Josselin, où bientôt la voiture passe le pont de Sainte-Croix, traverse la ville pour s’arrêter aux dernières maisons, route de Mohon. Là, accroché par la veste, je suis conduit dans un bureau. C’est une école, aménagée pour une utilisation bien différente. L’interprète qui était à notre arrestation, entre. Il est horriblement furieux. Le regard fixé sur moi, il me dit : «En civil ; en civil ! un comble pour nous ! « Je me comporte alors comme quelqu’un qui ne comprend pas très bien. A ce moment, deux soldats entrent avec Gray, tandis qu’on me fait sortir dans la cour à l’extrémité de laquelle il y a un préau où l’on m’ordonne de casser du bois à la hache le dos tourné à la cour. Après quelques minutes, j’entends des plaintes en provenance du bâtiment du fond de la cour et je comprends qu’il s’agit de tortures. Je me prépare à cette éventualité. Au bout d’un certain temps (environ une demi-heure), un soldat vient me chercher et me conduit à l’endroit d’où provenaient les cris. Dans la pièce, une salle d’école, mon compagnon Gray m’est présenté ; il a la figure ensanglantée, tuméfiée et déchirée, la lèvre inférieure coupée et à demi-pendante, les vêtements maculés de sang. Visiblement, il a eu la tête plongée dans un seau d’eau qui se trouve là ; cependant, il se tient encore bien debout. Profitant des quelques secondes pendant lesquelles nous sommes tournés l’un vers l’autre, il a le temps, sans être remarqué, de me faire un signe par un mouvement de la figure et un clignement des yeux, mais quelle en était la signification ?… Après quelques instants, ils font sortir Gray dans la cour. Ni moi, ni personne, ne le reverront…
A mon tour, je me trouve face aux tortionnaires qui se préparent comme des ouvriers pour une dure corvée. Plusieurs d’entre eux, en tenue débraillée, parlent parfaitement le français. Ils commencent par m’affirmer que mon compagnon avait parlé, que c’était moi qui le conduisait… Alors, qui m’avait envoyé et d’où venions-nous?… Puis, ils ajoutent : «Nous le savons, c’est le commandant, le gros qui est à côté du canal, qui vous a envoyé. Alors où ?» Comme je recommence les mêmes explications arrangées, l’interlocuteur m’arrête et dit : «Vous avez vu votre camarade? Si vous ne voulez pas parler, eh bien, à votre tour, vous y passerez comme lui…».
Coûte que coûte, Joseph Jégo devait tenir, il s’en était fait le serment… Quand Monsieur Jégo évoqua les moyens employés pour le torturer et le résultat du traitement qu’il dut subir, nous étions sincèrement horrifiés. Pour les Allemands, il fallait à n’importe quel prix obtenir des renseignements précis sur l’opération lancée dans la région de Saint-Marcel et obtenir de leurs prisonniers la localisation des parachutistes S.A.S et des F.F.I.« Sans plus attendre, précisa M. Jégo, on m’attacha les poignets avec une cordelette de parachute, et on me fit asseoir sur le plancher. Une barre de fer m’est alors passée entre le creux des genoux et le devant des avant-bras, de manière à être en boule. Dans cette position, deux bourreaux se mirent à me frapper avec des flexibles dont l’extrémité est prolongée par des fils métalliques découverts et recourbés. Je suis frappé sur les parties fessières et lombaires. J’ai par deux fois la tête plongée dans un seau d’eau. Pour cela, deux bourreaux me soulèvent par la barre et laissent la tête descendre au fond du seau. Conservant très bien mon esprit, je tiens bon le plus longtemps possible et ensuite, laisse un relâchement de tout mon corps. A ce signe, on me retire ; puis la séance des coups reprend. Les questions posées sont toujours les mêmes : «Où le conduisiez-vous ? Où sont les terroristes à Plumelec ?». Comme je ne dis rien, je reçois des coups de plus en plus durs. Finalement, je ne fais plus que me plaindre et implorer les esprits célestes ; ce qui provoque la colère de mes bourreaux, mais aussi leur découragement. Au bout de la séance, qui m’a semblé bien longue, mais qui n’a probablement pas duré plus d’une demi-heure, les tortionnaires, qui sont au nombre de quatre à six à se relayer, me laissent sans me retirer la barre d’entrave. Avant de quitter la pièce, l’un d’eux souhaite me donner un coup de pied dans la tête et profère deux ou trois mots de fureur, la chance fut pour moi qu’un autre intervienne aussi vite car le «godillot» était déjà levé. »
Dans la minute qui suivit le départ de ses bourreaux, Joseph Jégo est surpris car d’autres soldats pénètrent dans la pièce. Ils retirèrent aussitôt son entrave ainsi que l’attache de ses poignets. Tous sont horrifiés. Joseph Jégo, à son grand étonnement, les entendit parler français entre eux. « Après m’avoir allongé sur une sorte de lit de camp, ils se chargèrent de me nettoyer et soigner vaguement mes plaies. L’un d’eux, déjà âgé, au visage maigre et cheveux grisonnants, s’affaira à laver le plancher du sang et des matières fécales qui tapissaient une grande partie du sol. « Ce vieux m’apporta bientôt une boisson et renouvela régulièrement son offre. Le soir, au moment de leur dîner, il vint m’offrir à manger ; il insista même mais je n’accepta que de boire. Au moment de se coucher dans cette salle, qui leur servait de dortoir, plusieurs me demandèrent si ça allait… Je répondais faiblement, disant que je craignais de passer une nuit difficile. Parmi eux, il y avait un Belge, étudiant en médecine, qui me dit : «Je dors très légèrement, si vous avez besoin vous m’appelez». La nuit me fut effectivement pénible. Je souffrais tant psychologiquement que physiquement.
Au matin, le cuisinier (ce maigre aux cheveux gris) m’apporta un premier ersatz de café et me dit l’avoir sucré, bien qu’il n’avait pas de sucre pour la section. M’apportant un premier morceau de pain, il regretta de ne pas avoir mieux : ce pain complet était cuit selon lui depuis deux ou trois mois. Très vite, je compris que plusieurs désiraient parler avec moi… Pour me mettre en confiance, ils me donnèrent des informations sur un peu tout. Ils me dirent que leur section était entièrement formée de Lorrains, d’Alsaciens et de Belges. Cette unité, affectée depuis une longue période à la garde d’un état-major dans la région parisienne, avait été appelée depuis peu en Bretagne pour faire la chasse aux «terroristes». Moi, semblant tout ignorer, je me mis à les interroger à propos de ces «terroristes». Ils m’expliquèrent que pour eux c’était «terrible», qu’il y en avait partout, qu’ils pouvaient leur tirer dessus à tout moment, surtout la nuit ; qu’ils les recherchaient en vain le jour car ils étaient déguisés en civil. Ils ajoutèrent que l’on m’avait retrouvé avec «l’un» de ces terroristes et que je subissais, vraisemblablement par erreur, le même sort que tous ceux qui avaient été capturés. Savais-je ainsi que mon compagnon avait sur lui une carte d’état-major ? Ils m’apprirent que Gray avait aussi gardé sur lui son maillot d’évasion (maillot que portaient les parachutistes et qui pouvait être défait pour devenir une cordelette de vingt mètres de long, pouvant résister au poids d’un homme). Ils me précisèrent que cet homme avait dit être d’origine française, mais avait émigré en Angleterre et s’était fait naturaliser Anglais. L’un d’eux ajouta même avec ironie : «Et maintenant, il est revenu pour sauver la France!» De ce dialogue, je compris vite qu’ils croyaient encore à la victoire de la «Grande Allemagne nationale-socialiste» et l’espéraient aussi !
L’un d’eux, un Alsacien, dit qu’il avait combattu dans l’armée française en 1940, mais que remobilisé en 1941 dans l’armée allemande, il resterai toujours combattant pour le national-socialisme. Ils me présentèrent bientôt des balles de mitraillettes, des jaunes et des blanches. Les blanches étaient anglaises et les jaunes allemandes. Les Anglais n’avaient donc même plus de cuivre !… J’écoutais leur exposé d’un air naïf. Pour eux, l’Allemagne était assurée de la victoire, ne serait-ce que par l’emploi de nouveaux engins de guerre terribles : ses VI, V2, V3 et jusqu’au VI0 !… Le front de Normandie ? Ce n’était pas inquiétant, d’ailleurs, l’ennemi piétinait et serait tôt ou tard refoulé à la mer… Par contre ce qui les préoccupait, c’était la montée du terrorisme… »
Joseph Jégo clama son innocence auprès des soldats, qui de leur côté espéraient obtenir de ce paysan breton, à sa libération, un peu de beurre et quelques autres victuailles afin d’améliorer leur ordinaire… Leur chef de section leur affirma que le prisonnier serait probablement d’abord envoyé à l’hôpital, mais qu’il fallait attendre l’avis de la Gestapo de Saint-Jean-Brévelay qui avait autorité sur Plumelec. Etant toujours sous la surveillance de la Gestapo, Joseph Jégo en déduisit qu’il ne devait pas se faire d’illusion et profiter de la moindre occasion pour s’évader et tenter le tout pour le tout…« Au matin du quatrième jour, vendredi 14 juillet, me réveillant d’un profond sommeil, après avoir passé la majeure partie de la nuit sur les nerfs, je fus étonné de me retrouver seul et de ne rien entendre dans la pièce voisine. Deux soldats entrèrent dans le dortoir. Leur équipe était partie à « la chasse aux terroristes » dans la forêt de Lanouée, et eux étaient chargés de me garder. Ils m’offrirent le petit déjeuner. Je leur demandais de m’aider à m’asseoir sur le bord du lit pour être plus à l’aise. Une fenêtre était juste à ma portée. Profitant d’un moment libre entre leur va-et-vient, je pus voir par les carreaux qu’un grand mur entourait un coin de terre, cultivé en potager et que ce mur était écroulé à un endroit. Au milieu de ce potager, il y avait un puits. Un peu plus tard, un pied sur le coin du lit, je suis parvenu à tourner la poignée de crémone, puis à desserrer la fenêtre par le bas avec la lame de mon couteau. Mes gardiens ne me laissaient seul que de courts moments et je n’étais pas habillé. Je demandai alors à aller aux cabinets d’aisance qui se trouvaient dans la cour, les soldats m’aidèrent à m’habiller. Ils m’aidèrent à me déplacer en me soutenant par le bras, un de chaque côté, tandis que je me laissais largement supporter. Revenu au lit, ils me proposèrent de la lecture. Comme je faisais mine de refuser, ils me recommandèrent de me tenir dans un coin, de ne pas me faire voir aux fenêtres à cause des parachutistes qui, eux, étaient logés dans l’autre bâtiment, sortaient dans la cour et allaient à l’eau au puits du potager. Je n’avais à l’esprit qu’une chose : tenter ma chance au plus vite. Mes gardiens ne me laissaient sans surveillance que de courts moments. J’imaginais saisir l’occasion de la lecture. Je surveillais à la fenêtre, un parachutiste repartait du puits avec des seaux d’eau. J’informais mes gardiens que, finalement, un livre m’aiderait peut-être à passer le temps… Ils m’en apportèrent un, puis retournèrent à leurs occupations.
Il était environ 9 heures, lorsque je posais le bouquin sur le lit. Un pied sur le coin du lit, j’ouvris la fenêtre et je montais sur l’appui. Un homme, qui bêchait dans l’autre potager au-delà du mur de séparation, me regarda. L’idée qu’il ne donne l’alarme me traversait l’esprit, mais tant pis, je me laissais glisser doucement contre le mur. Je traversais le potager et passais la brèche du mur écroulé.Ayant réussi à courir, malgré mon état, sur à peu près quatre centaines de mètres, je savais que seul, je n’irai pas très loin. Aussi, voyant deux jeunes garçons occupés à passer la houe dans leur champ de betteraves, je leur fis signe. Sans hésiter, l’un franchit les cinquante mètres pour venir jusqu’à moi. «Je viens de m’évader. Si tu veux m’aider, je serai sauvé. Si tu me laisses, je suis perdu». Le jeune homme me répondit sans hésitation : «Les Allemands ont tué mon père dernièrement, je t’emmène». Rapidement, il avisa son frère de rester au champ avec leur cheval, puis m’aida à me glisser dans le chemin creux proche.
Le sentier était en pente et j’accrochais mon sauveteur par la veste. Nous marchions péniblement mais assez vite, le plus vite possible. Une fois suffisamment éloignés, il m’allongea dans un champ de pommes-de-terre et alla chercher sa mère. En quelques minutes, il revint accompagné de sa maman qui, en arrivant, me prit dans ses bras en pleurant à grosses larmes. Nous pleurions tous les trois… Elle décida de remplacer mes vêtements, déchirés et maculés de sang en me donnant ceux de son époux défunt. Il fallait faire vite car j’avais la hantise d’être recherché à l’aide d’un chien. En trois à quatre minutes, elle revint, apportant un costume que j’enfilais à la place du mien qu’elle irait enterrer. Elle recommanda à son fils de repartir aussitôt avec moi, tout en nous prodiguant des conseils de prudence. Mon jeune guide avait des relations avec la résistance depuis l’assassinat de son père et connaissait un compagnon F.F.I, Denis Guéhenneux, qui habitait au bourg de Guégon. Il me proposa de m’y conduire. C’était assez loin et il fallait franchir le canal… René, le jeune garçon me dit : «Le meunier de Saint-Jouan est mon oncle, il a une barque, il ne refusera pas de prendre le risque de nous passer». Nous devions faire un long détour pour atteindre le moulin car selon ce que nous avait répété sa maman, les Allemands étaient en ébullition ce matin-là et circulaient de tous côtés». Nous avons fait de longs détours mais nous n’avons pas vu d’Allemands.
Au moulin, le meunier, Jules Surel, était absent. La fille de la maison prévint un réfugié hébergé chez eux qui s’occupait dans le moulin, Pierre Le Dévéat, un F.F.I. Le jeune homme s’empressa de prendre la barque et nous fit traverser sans problème… »
C’est un homme rompu de fatigue qui arriva chez Denis Guéhenneux. Ce dernier avait rejoint le Pelhué le 8 juin, y avait couché et séjourné aux lendemains de la dislocation de Saint-Marcel. Sans hésiter, il prit M. Jégo en charge, ce qui n’était pas sans risque pour lui et les siens. Denis Guéhenneux confirma une bien triste nouvelle : le capitaine S.A. S. Marienne, le lieutenant Martin, le sous-lieutenant Morizur et on ne savait combien d’autres, ainsi que les gens du village de Kérihuel, avaient été surpris de bon matin et abattus…
Couché dans une remise, Joseph Jégo passa une longue nuit d’insomnie. La douleur des coups reçus et la hantise de se faire surprendre et à nouveau capturé l’assaillaient…« Vers 8 heures, après l’accord de ses parents, Denis m’invita à aller chez lui, estimant que le risque n’était pas plus grand. Ensuite, il décida d’aller à la boucherie et de confier au boucher Danet l’existence de ma présence pour avoir un peu de viande sans tickets. Denis en revint avec des côtes de veau. Pour ma part, je pensais à ma famille et ma crainte était que les Allemands ne tombent sur l’un d’eux. ».
A la maison Guéhenneux, l’inquiétude grandit d’un coup lorsque l’on apprit que les Allemands arrivaient en nombre au bourg de Guégon et interdisaient toute circulation. Une fouille systématique des maisons était à craindre…« Par un carreau de fenêtre qui surplombait le bord de la route, nous confia M. Jégo, je voyais leurs casques, certains à moins de trois mètres de moi. Denis et moi-même étions bien conscients du danger. L’étable de la ferme communiquait avec l’habitation. Il y avait environ quarante centimètres de fumier, couche suffisante pour m’y enfouir. Denis me recouvrit de paille et de fumier. Je restais là jusqu’à ce que l’ennemi ait quitté les lieux, soit pendant environ deux heures. Aucune perquisition n’eut lieu !… »
Le danger couru par les Guéhenneux était trop grand et Joseph Jégo décida de partir pour le village de la Grée Janvier à Billio. Sa soeur, Bernadette, s’y est réfugiée chez les époux Thomas. Comme il souffrait encore beaucoup Denis Guéhenneux l’accompagna. « Il me prépara deux bâtons. En terrain plat et descente, j’arrivais à marcher seul, mais dès que nous rencontrions une côte ou un talus, Denis devait me tirer au moyen des bâtons. ». La marche est exténuante et il faut sans arrêt fuir, passer loin des maisons, éviter les chiens et les dénonciateurs. Après une nuit fraîche passée à la belle étoile, Joseph Jégo a bien du mal à repartir.
Finalement, le 16 juillet, les deux camarades arrivèrent à la Grée-Janvier à 8 heures. « Ma soeur me regarda et ne me reconnut qu’après avoir un peu hésité. Une immense joie nous saisit alors. Bernadette pleurait de me voir ainsi. Les nombreuses arrestations, celle de notre père, la tragédie épouvantable de Kérihuel, les recherches de plus en plus intenses dans les villages qui terrorisaient la population, l’avance des Alliés en Normandie arrêtée et vigoureusement contre-attaquée depuis quelques jours, tels furent les sujets qu’évoqua Bernadette Jégo à son frère. L’heure n’était pas à l’enthousiasme…
ules Thomas, bien qu’ayant plusieurs jeunes enfants, prit le risque d’héberger provisoirement Joseph Jégo dans une loge couverte de paille. Celui-ci était trop exténué pour continuer son chemin. « Paulette Grandin, une femme du village qui avait des notions d’infirmière, vint pour soigner mes blessures qu’elle trouva inquiétantes. Le médecin de Plumelec avait été arrêté et on ne pouvait prendre le risque de faire appel à un autre docteur. »
Mais comme la poursuite des Allemands s’intensifiait dans les environs de Billio, M. Jégo dut se réfugier à quelques distances de la ferme, dans le fossé d’un champ bien dissimulé par un haut talus. Là, les Thomas le ravitaillent et Paulette le soigne comme elle le peut… La nuit, il revenait à la loge qu’il quittait au petit jour… Cela dura douze jours, douze jours où la tension était à son comble car les Allemands poursuivaient leurs recherches…
« Au soir du jeudi 27, des bruits se répandent sur Billio. Les Allemands cernent des villages, recherchent même dans la nature ; il est encore à craindre qu’ils emploient des chiens. Je suis conscient que ma présence au village met en péril les Thomas. Ainsi, je décide de m’installer pour la nuit au milieu d’un champ de blé noir. Là, bien qu’enroulé dans ma couverture, je n’ai jamais eu aussi froid de ma vie, il m’a été impossible de dormir cinq minutes. Par deux fois, des avions passent à basse altitude, je les crois «alliés» à entendre le ronronnement de leurs moteurs, j’ai comme une sensation absurde de protection… «Le 28 juillet 1944, se sentant un peu mieux, Jean Jégo repartit vers Plumelec contacter ses camarades du maquis. Renseigné sur son chemin par quelques unes de ses connaissances qu’il n’y avait pas d’ennemi dans le secteur, M. Jégo arriva au village de Bréhé; où une partie des siens a trouvé refuge. Autre moment d’émotion : « Le parrain Joseph et tante Louise, qui depuis des semaines prennent le risque d’héberger et d’entretenir beaucoup de monde, me demandent de rester avec eux. «Arrivera ce qui arrivera ! « me rassure le parrain, tandis que la tante me confie qu’elle m’a sauvé par ses prières à mon intention… »
La venue de Joseph Jégo ne passe pas inaperçue à Bréhé puisque dés l’après-midi, le sergent S.A.S. Pacifici, déjà au courant, vient le solliciter. Il a eu à sa disposition un dépôt d’armes et munitions qu’avaient constitué des F.F.I. du secteur. Il doit en expédier discrètement la majeure partie quelque part en la commune de Bignan, où l’attendent des S.A.S. et des F.F.I. Le 31 juillet, à 4 heures du matin, le chargement recouvert d’un peu de trèfle passe le village de Bréhé. Deux S.A.S. en armes et vêtements civils, André Bernard et le sergent Judet, accompagnés de Henri Le Goff, F.F.I., suivent la charrette…
Vers 9 heures, une habitante de Bréhé, Mme Guyot qui revient de Lautréan (village situé à 2,5 km de Plumelec, route de Trédion), dit qu’aux environs de 4 heures, Lautréan a été cerné par un important nombre d’Allemands qui ont perquisitionné dans toutes les maisons et locaux, vidant même le foin des greniers. Vont- ils encore cerner les villages les uns après les autres ? Pour Joseph Jégo, il faut partir au plus vite encore. Pacifini doit rejoindre le P.C. du capitaine Puech-Samson au moulin de Cornay à Guillac et convainc Joseph Jégo de l’y suivre. Une halte est prévue à Bohurel en Sérent. Arrivé au soleil couchant, c’est l’inquiétude à la maison Louis Duval ; une importante troupe ennemie est en effet arrivée à Sérent. Elle donne à craindre que l’ennemi prépare une opération d’envergure pour le lendemain. « Pacifici trouve une bicyclette et décide de partir par la route, ce qui n’est pas question pour moi. Il me promet de venir me rechercher le lendemain… Au soir du 31 juillet, les époux Duval me conseillent d’aller rejoindre un groupe de F.F.I. dans les taillis à 200 mètres de leur maison. Je les trouve sans difficulté. Ils sont une quinzaine et m’entourent pour me poser des questions sur mes péripéties. Bien que mon récit les intéresse, il faut couper court et préparer la journée du lendemain, chacun prévoyant une attaque ennemie. Le groupe décida de se scinder en deux. Je choisis de suivre l’un d’eux qui cherchait à atteindre une maison abandonnée, située en un lieu isolé au milieu d’un bois et près d’une ancienne carrière entre Quily et Saint-Servant-sur-Oust. Sur l’itinéraire, nous traversons le village de la Grée-aux-Moines où nous nous arrêtons. Cette halte est pour décider du passage du secteur de Sainte-Catherine, où les «boches» fréquentent le café près du carrefour. Le plus facile est d’atteindre la route du Roc à Josselin et passer franchement par le croisement, mais c’est aussi le plus dangereux. Malgré mon insistance pour éviter le carrefour, aucun ne connaissant le secteur, tous s’accordent pour emprunter la route et braver le risque. Alors, je me rends à leur décision. A l’approche du croisement, nous nous séparons pour marcher en file indienne silencieusement de chaque côté de la route. Emile Grignon de Sérent est tête de file ; sur le côté gauche, Jean Lorent de Saint-Brieuc ; côté droit, moi, dernier de ce côté et sans arme. Environ cinquante à quatre-vingt mètres avant le carrefour, dans le fossé côté gauche et alors que nous arrivons à sa hauteur, un soldat, caché par des branchages de chêne, se lève en disant : «Halte là !» Au même instant, nos deux hommes de tête tirent une longue rafale de mitraillette dans la direction, où un deuxième soldat est aussi aperçu. Les deux soldats, probablement très atteints, poussent des cris d’alarmes. Très rapidement, alors que mes compagnons se replient ensemble, je passe le buisson qui longe le fossé de la route. Une couverture que la tante m’avait donnée à Bréhé et que je porte à l’épaule s’accroche aux ronces, je la laisse. J’ai à peine fait vingt mètres que les tirs à la mitrailleuse et aux fusils commencent. Je cours tête baissée, traversant plusieurs haies sans me redresser. Après une certaine distance, alors que je me suis arrêté pour reprendre mon souffle, j’aperçois mes compagnons derrière un talus, les armes braquées. »
Pas un blessé ne fut à déplorer, le tir de la mitrailleuse était probablement réglé trop haut mais il manque un homme… « Nous marchons pour nous éloigner d’environ un kilomètre jusqu’à une parcelle de terre envahie de hauts genêts. Nous nous enfonçons jusqu’au milieu pour y passer le reste de la nuit. Pendant environ deux heures, nous entendons des tirs de mitraillettes, ainsi que des éclatements de grenades. J’attire l’attention des copains sur le risque d’être encerclés et trahis par le flair d’un chien. »
Parti en éclaireur le lendemain, Joseph Jégo retrouva le camarade qui était resté isolé. Il avait échappé miraculeusement aux Allemands en s’adossant à un gros arbre. A plusieurs reprises, il dut tourner autour de l’arbre. Il avait pu constater que les soldats lançaient des grenades et tiraient des rafales dans les coins obscurs avant d’avancer…
Isolé parmi la lande et les bois, le ravitaillement n’est pas simple et Joseph Jégo fit l’expérience d’une population locale parfois hostile à toute aide. Mais, bientôt une nouvelle modifia leur existence : les « Boches » avaient quitté Serent sans se battre. Un retour à Bohurel, chez les Duval eut lieu. Mais, la prudence reste de règle car leur maison n’est qu’à cinquante mètres de la route nationale et le 4 août, l’ennemi est à nouveau à Sérent… Il a rassemblé des hommes sur la place et les terrorise.Au cours de l’après-midi, M. Jégo apprend qu’un parachutage doit avoir lieu sur le terrain Baleine à Saint-Marcel et qu’il devait donc s’y rendre avec son groupe. En soirée, ils décident de partir mais à peine la nationale franchie, Alexandre Garel, qui est parti avec un peu d’avance, se mit à tirer avec son fusil mitrailleur. Il faisait face à un convoi allemand !… Les Allemands descendirent de camions, tirant à outrance. Garel, bien pourvu en munitions, les contint. « Moi, je vis des balles tirées par les Allemands frapper les toits de la ferme des Duval. Masqué par les bâtiments, j’atteins le taillis, le traversai et continuai à m’éloigner. Etant à 400 ou 500 mètres, je vis une épaisse fumée noire s’élever au dessus de la ferme. Elle était en feu. Je regrettai d’avoir laissé Madame Duval et ses enfants derrière moi. Mais c’était trop tard, les Allemands devaient être sûrement à la ferme. Au village du Pério, trois maquisards m’invitèrent à rester avec eux. Ils étaient grisés à la perspective de pouvoir bientôt tirer au derrière de l’occupant qui battait en retraite… Toute la nuit, nous sommes restés sur le qui-vive… »
Le convoi allemand attaqué avait en fait repris sa route, Sérent était vraiment libre. La ferme des Duval, atteinte par des balles incendiaires n’avait qu’en partie été dévastée par le feu et les Duval avait pu se sauver. Les Allemands, se sentant traqués, n’étaient pas venus à la ferme !
« J’apportai mon aide pour déblayer l’étable des détritus qui fument encore lorsqu’une voiture militaire arriva et s’arrêta devant la maison. J’eus encore le réflexe de me cacher… En fait, quatre Américains étaient à bord. Un officier est sorti pour annoncer à Madame Duval la libération, puis la voiture est repartie…Le lendemain, 6 août, à partir de 8 heures, un roulement commence à se faire entendre qui semble provenir de la route de Malestroit-Sérent. Bruit discordant des véhicules qui bientôt passent Sérent et direction Plumelec. Pas la moindre circulation sur la nationale, où nous attendons la venue de la colonne des blindés américains. Les Allemands revenaient-ils sur leurs pas ?… Duval, n’y tenant plus, prit sa bicyclette pour faire un tour au bourg pour voir. Il en revint tout enthousiasmé s’écriant : «C’est les Américains ! La colonne a dû passer par Malestroit : les Allemands ont fait sauter le pont du Roc ! » . Il m’invita à trinquer avec un bon verre. Je décidais de partir aussitôt pour Plumelec. Sur la route, toutes sortes de véhicules de la colonne américaine passaient sans interruption. A Plumelec, la 7e compagnie avait placée des hommes à tous les carrefours. On se préparait à la chasse aux «boches» à partir de demain, me dit-on. Selon certains renseignements, les Allemands infestaient encore un peu partout la campagne…
Louis Simon, devenu capitaine et commandant de la place de Plumelec dont dépendait aussi toutes les communes du canton,. me recommanda de rester chez moi jusqu’au retour de mon père… » .
Les soldats américains sont acclamés par une Bretagne enthousiaste qui, après des mois de terreur, apprécie le soleil de sa libération. Les soldats répondent inlassablement les bras levés, les doigts disposés en V. Des jeunes et des moins jeunes jettent des fleurs sur la route lorsqu’ils ne peuvent les offrir. Scène de liesse authentique mais que d’amertume pour tout ceux que la guerre avait touché dans leur chair. Joseph Jégo est de ceux-là. Mathurin Jégo, son père, n’est pas revenu reprendre sa place à la tête de la ferme familiale du Pelhué… Mathurin Jégo fut l’un des cinquante et un patriotes exécutés au fort de Penthiévre le 13 juillet 1944. Entassés les uns sur les autres, leurs corps furent découverts le 16 mai 1945, les poignets liés dans le dos. Tous portaient encore des traces de tortures…
Joseph Jégo réussit à survivre à ce sombre épisode de sa vie dont le souvenir pèse aujourd’hui lourd dans son esprit. Les images de la guerre en Bosnie, en Tchetchénie, l’interpellent et ravivent sa mémoire. « Il est plus facile d’éteindre un feu quand il commence. Plus il grossit, plus il devient incontrôlable et dangereux… ». Il faut être vigilants face à l’essor des minorités. Certaines sont animées par des principes néo-fascistes, voire même néo-nazis et cela, cinquante ans après la victoire sur la barbarie hitlérienne, ce n’est vraiment pas supportable. . . votre commentaire
votre commentaire
-
Par sgidplan le 4 Mars 2015 à 18:38
Madeleine Fablet avait 32 ans lors des événements de juin 1944. Ses souvenirs sont restés presque intacts en ce qui concerne la bataille de Saint-Marcel et surtout celle du Bois-Joly, la ferme où elle se trouvait alors avec son mari, Hyacinthe, et ses enfants, Marcel, Michel, Madeleine et Annick, la petite dernière, qui avait 2 ans.
Les armes et munitions ramassées après les parachutages étaient entreposés dans les hangars. Mon mari les convoyait le jour avec ses chevaux et sa charrette vers la ferme de la Nouette, qui se trouvait à environ 1 km à vol d'oiseau.
Là se trouvaient les chefs du maquis : le commandant Bourgoin, chef des parachutistes, et le colonel Morice. Au matin du dimanche 18 juin, une patrouille allemande en repérage sur les routes des Noës a essuyé des tirs. Un rescapé a pu prévenir le bataillon allemand de Ploërmel, qui a cerné Saint-Marcel.
Les premiers tirs au Bois-Joly
Aux environs de 9 h 30, nous vaquions à nos occupations habituelles, avec certains parachutistes et résistants présents, quand nous avons aperçu les casques de soldats allemands qui se faufilaient le long des talus.
Très vite, les premières rafales de mitraillette se sont fait entendre. Cinq résistants originaires d'Auray, et Suzanne Berthelot, 15 ans, qui surveillait les vaches dans le champ Monfort, discutaient ensemble. Ils ont été abattus tous les six.
Les enfants, qui avaient été préparés pour aller à la messe, n'ont pas eu le temps de descendre au bourg. Heureusement, car à partir de ce moment le fusil-mitrailleur placé au bas de notre propriété, face à la maison, a tiré sans discontinuer. La porte, les volets ont volé en éclats, une balle est venue frapper une casserole et une autre s'est logée dans l'horloge, qui porte encore la marque.
Tout le monde s'est retranché à l'arrière de la maison, dans la cave. Nous y sommes restés jusqu'à 17 h. Nous avons alors décidé de partir à travers champs vers Sérent, chez ma belle-soeur qui habitait au Coudray. Entre-temps, mon mari, « le grand terroriste », était recherché par les Allemands. Il s'était enfui à Ruffiac avec de faux papiers, car sa tête était mise à prix.
Toutes les fermes environnantes ont été brûlées, mais la nôtre a été épargnée. Pourtant, des mèches avaient été installées dans les murs, des fagots empilés et une bombe dissimulée dans la baratte. Mais avant d'y mettre le feu, les Allemands voulaient retrouver le fermier, mon mari.
Nous ne sommes revenus au Bois-Joly que le 15 août. Pendant tout ce temps, les animaux de la ferme ont été livrés à eux-mêmes. J'ai même retrouvé deux poules à Pinieux... »
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par sgidplan le 20 Février 2015 à 13:54
Il est cinq heures et demie, Guy-Michel me réveille et m'annonce la bagarre, j'entends d'ailleurs encore les derniers coups de feu. C'est simplement un groupe de reconnaissance allemand composé de deux autos dans lesquelles sont huit soldats qui, attirés par les fréquents parachutages, est venu voir ce qui se passait et s'est heurté au feu de nos FM. Nous en avons tué quatre, fait prisonniers trois, dont un grièvement blessé et le dernier s'est échappé avec une des voitures.
Sans plus faire attention à cet incident, je vais, avant la messe qui est à huit heures, voir les chauffeurs qui s'affairent autour de leurs jeeps descendues comme eux du ciel, cette nuit. Ils montent des fusils mitrailleurs dessus car toutes les mitrailleuses se sont écrasées au sol. Pourtant, avec les débris de plusieurs, un caporal parachutiste arrive à en reconstituer une. Pendant ce temps, tout en les regardant et en les questionnant, je mange presque une boite entière de bonbons vitaminés qu'ils viennent de me donner.
Et voici la messe. C'est l'aumônier du camp qui la dit. Nous y assistons très nombreux. Après l'évangile, le prêtre nous dit quelques mots :"il ne faut pas parler de vengeance, mais de revanche ; ils ont gagné la première manche, nous gagnerons la seconde avec l'aide de Dieu. Préparons-nous au combat". A peine la messe finie, je n'ai pas seulement le temps d'aller dire bonjour à Victoire et à ses filles et de déjeuner que la bataille commence. L'allemand échappé est parti avertir à Ploërmel et ce sont plusieurs compagnies allemandes qui arrivent à l'attaque. Nos gars sont prêts, derrière les taillis et ils les attendent fermement.
L'effervescence règne au camp. Chacun s'agite et la mitraille se poursuit sans arrêt. Au premier assaut, les FFI en ligne ont eu peur et partaient déjà, mais le lieutenant Marienne était là, qui les a remis en place, je peux dire "à coups de pieds dans le derrière". Les allemands tombent comme des quilles.
Revenons au camp. Dans notre groupe des "plantons", ou "agents du GG", nous n'avions pas encore été armés et notre chef, le lieutenant Colineaux, assisté du Sergent Pretseille, y procèdent. J'ai toutes les peines du monde à obtenir une carabine. Heureusement, j'avais la permission de maman. Le pauvre Guichou n'y parvient pas et pleure à chaudes larmes ; mais il vaut bien mieux ainsi. Comme armement, on me donne une carabine américaine, merveilleuse arme légère semiautomatique et dont la précision est très appréciée.
Me voici à l'œuvre, aidé par Guy, dans notre cabane des plantons en train de nettoyer nos armes et de faire nos provisions de munitions. Je sors et rencontre le capitaine Puech-Samson qui n'a pas l'air très content de me voir ainsi habillé et armé. Il m'appelle et me dit : "Loïc, avec quelle permission ?". Celle de maman, mon capitaine ... et aussitôt, il me fait un grand sourire et me dit : "Bon, eh bien, viens avec moi à la bagarre, tu as deux minutes". Je vais vite embrasser mon petit guy-guy qui pleure encore, le pauvre gars, de me voir partir et de rester seul. Mais le commandant Bourgoin s'en occupe et va le faire partir avec les Pondart à qui il a donné l'ordre de quitter "la Nouette". Je les embrasse eux aussi, ils sont pleins de courage et les voilà qui s'en vont à travers champs, laissant tout.
Les allemands n'ont pas fait un pas et les commandants Bourgoin et Morice nous ont bien donné l'ordre de ne pas avancer afin qu'il y ait le moins de perte possible, mais seulement de maintenir fermes les positions. Je pars enfin de mon côté, avec le capitaine, vers les Hardis, Bois-Joli et Sainte-Geneviève, afin de contacter avec les bataillons engagés (deux) et de transmettre les ordres. Il n'a pour toute arme que deux grenades et force jumelles, cartes, crayons, papiers, etc... Je suis très fier d'être son garde du corps, comme il m'a dit, et je fais claquer les vieilles bottes de grand-père, que j'ai adoptées.
Avant d'arriver aux Grands Hardis, nous voyons le commandant Le Garrec qui commande le bataillon engagé, devant la Nouette. Tout va bien dans son secteur, aussi, nous continuons sur le Bois-Joli où il semble que la poussée soit la plus forte. Il faut ramper car les balles sifflent de tous les côtés. Arrivés aux Grands Hardis, on a vraiment l'impression qu'on rentre dans le bain ; le capitaine donne plusieurs ordres et nous continuons.
Un peu avant le Bois-Joli, je trouve une mitraillette chargée, abandonnée, que je donne au capitaine. Puis, nous obliquons à droite, derrière des haies, à quelques trente mètres des boches. C'est palpitant, la première ligne de nos fusils mitrailleurs se trouve à 5 mètres en arrière, à côté du petit bois à moitié en feu, auquel nous avons abouti. C'est un tonnerre du diable et sans arrêt on entend des rafales de FM et force coups de fusils, etc... Ces cochons de boches ont installé une mitrailleuse lourde dans le clocher de Saint-Marcel et elle nous gêne et nous arrose bien.
Pendant ce temps, par la radio, nous avons demandé que des avions viennent détruire et mitrailler les observatoires de Villeneuve, Saint-Marcel (le clocher de l'église) et Plumelec. Le capitaine inspecte à la jumelle et Loïc accroupi est à côté de lui, prêt à le défendre. Nos fusils mitrailleurs tirent sans arrêt tout à côté de nous et j'en ai les oreilles déconfites. Soudain, des coups crépitent et nous sifflent aux oreilles. Je tire quelques coups, mais le capitaine me dit :"Loïc, je suis touché", et il tombe. Je me précipite vers lui et constate avec un autre parachutiste venu lui aussi en le voyant tomber; que c'est une blessure à la cuisse, sans gravité.
Je lui fais avec un vieux bandage un pansement tant bien que mal, puis, alors que le parachutiste le ramène derrière la haie et le remet en train, je reprends ma carabine et fou de joie de tirer dans ces cochons et anxieux pour mon capitaine, je m'amuse une minute. Puis il faut ramener le capitaine au camp. Nous ne sommes pas très loin de la petite route Saint-Marcel - Serent qui passe près de la Nouette et où sont nos autos mitrailleuses. Aussi, chacun d'un côté, nous l'aidons à marcher. Il est d'un courage magnifique et aux petits FFI qui le voient passer traînant la patte, il leur dit pour ne pas les démoraliser : "ce n'est rien, je me suis simplement foulé le pied en sautant un fossé, allez, du courage mes petits".
Nous arrivons enfin et une jeep devenue ambulance nous transporte au camp à l'infirmerie où le médecin FFI Mahéo (ou Sassoun) le soigne. Toujours d'un courage magnifique et exemplaire, mon capitaine subit une piqûre dans le ventre qui a dû lui faire un "tout petit peu mal", mais il ne dit mot. Puis je raccompagne le capitaine dans la chambre de la ferme servant de PC. Là, sont les commandants Bourgoin, Morice, Le Gouvello, les capitaines Guimard, Brunet, etc... Il s'allonge sur un lit et, sur sa demande, je m'allonge moi aussi à côté de lui. Je suis lassé et un peu impressionné et je fais un petit somme, alors que la mitraille continue toujours.
Vers trois heures, je me lève et suis chargé par Émile Guimard de fermer les armoires des Pondart. Obligation bien difficile à remplir car, sur les trois armoires, je m'aperçois qu'aucune ne peut fermer. Apercevant un joli petit mouchoir blanc, brodé, je le prends avec l'intention de le donner à son propriétaire en souvenir. À ce moment-là, je savais déjà que nous devrons décrocher ce soir, faute d'arme lourde.
Soudain un vrombissement ; 12 avions arrivent vers nous. Ce sont nos mosquitos tant attendus. En voilà déjà un qui pique sur Villeneuve, suivi du bruit sec de sa mitraille. C'est maintenant le clocher repère qui est mitraillé. Les troupes allemandes, devenues plus nombreuses, sont désemparées et leur feu ralentit. Mais ce n'est pas pour longtemps, car aussitôt les avions repartis, ça recommence de plus belle.
Je m'en vais un moment du PC et vais avec Xavier, un très chic type, Pierre et Marie, nettoyer nos armes dans la maison de cette pauvre et vaillante madame Salles, partie elle aussi il y a quelques heures. Nous buvons en même temps une dernière de ses bouteilles, puis, les aumôniers arrivant, nous causons cinq minutes avec eux. Je reviens vers mon capitaine qui, maintenant assis, s'occupe de faire taper des ordres. Le Bataillon Caro qui est établi en la ferme de Bois Séjour est en réserve et ne se bat pas, ainsi que toutes les troupes se trouvant vers la route "Malestroit-Sérent".
Tout marchait bien quand, soudain, éclatent dans la cour de la ferme plusieurs coups de feu, suivis d'une fusillade beaucoup plus proche. Aussitôt, des FFI partent vers le lieu d'où viennent les coups, c'est-à-dire vers Bohal. Les allemands, en effet, ayant bien repéré nos positions, ont fait un détour et attaquent maintenant de ce côté là encore. Ils se sont installés sur la petite colline du bois de Behellec et ne s'en font pas. Heureusement, les postes avancés, constitués par des parachutistes, les reçoivent comme il faut et les allemands tombent là comme dans tous les autres coins, c'est-à-dire par dizaines. C'est le poste du lieutenant Ranfast, premier parachutiste arrivé au camp, qui fait le plus beau travail : ils ont quatre fusils-mitrailleurs, et il faut que je cite les noms de : Crizik, De Aima, Gérard, Chilou.
Il est maintenant six heures et demie du soir. Le capitaine ne veut pas que je retourne me battre car la mitraille est tellement forte que ce serait un réel danger. Je me contente de faire des petites liaisons et d'aider de mon mieux le capitaine et les autres officiers en les faisant boire et manger. En effet, il ne reste plus une femme au camp. Elles ont toutes été évacuées.
Nous préparons maintenant le départ, le décrochage se fera à minuit et en même temps toutes les munitions et armes que l'on n'aura pas pu emporter en camion sauteront. D'ailleurs, le capitaine charge le sergent Charles Decrept de préparer ses charges et de faire sauter le tout. Nous devrons tous partir en colonnes ou par petits groupes au Château de Callac qui se trouve à peu près à 15 kilomètres de la Nouette. Nous devrons tous nous y retrouver demain matin et nous nous y reformerons.
Pendant ce temps, le lieutenant de Camaret, accompagné de 20 parachutistes, part à SainteGeneviève où la situation est plus critique. En effet, les allemands, voyant de très loin les grands murs blancs du château s'y acharnent, croyant trouver là les chefs de ce "maquis" et, pourtant, les FFI ne sont pas aussi forts là que devant La Nouette. Le temps passe vite et la nuit, déjà, tombe. Par un émissaire, nous apprenons que les allemands ont été repoussés du secteur de Sainte-Geneviève, vers Saint-Marcel.
Le capitaine me prend à part et me dit : "Comme blessé et ne pouvant pas marcher, je vais partir en jeep. Je n'ai pas de place pour toi, mon petit Loïc ; tu vas partir à pied avec les commandants et je suis sûr que nous nous retrouverons tous les deux demain matin". Je m'étais bien juré de ne plus me séparer de mon capitaine, mais je n'osais pas résister afin qu'il ne crût pas que je voulais aller en jeep. Je fis donc mon petit bagage et suivis le commandant Bourgoin. Je dis au revoir une dernière fois au capitaine et, peu après, vers 9 heures et demi, nous partîmes, direction "Serent".
Nous nous arrêtons dans des fossés, à 800 mètres de la ferme de la Nouette, pour attendre la compagnie Cadoudal. Pendant ce temps nous sommes un peu repérés et, de la colline d'en face, les allemands nous tirent dedans. Ça me fait une drôle d'impression d'entendre les balles siffler dans les champs de blé. Puis, tout à coup, une sorte de petite explosion, suivie de plusieurs autres… Elles paraissent très proches ; ne sachant ce que c'est, je me blottis dans le fossé et serre bien fort contre ma poitrine cette carabine que je suis si heureux de porter. Les bois de monsieur Philippe sont en feu ; ça produit un curieux effet, alors que la nuit approche. Plusieurs autres qui étaient avec nous dans les bois partent dans une "citron" pilotée par Jean Grignon et Lili Fochou, deux braves ; ils emmènent le commandant Bourgoin qui, s'étant foulé la cheville en descendant au sol l'autre soir, ne peut pas marcher. Je lui refile ma petite valise dans laquelle sont mes habits civils, ça me fera toujours ça de moins à porter.
Enfin, voici Cadoudal et nous partons ; nous sommes quatre à cinq cents à la file indienne le long des chemins et au demi-clair de lune qu'il y a cette nuit, ça fait une impression bien particulière. Je suis entre Gilbert Énain et Jacques Quitelier, parachutistes radios, très chics.
Nous voici maintenant sur la grande route après avoir longtemps suivi des chemins détournés. Mais, qu'arrive-t-il ? Une grande lueur illumine toute la campagne, puis c'est une énorme explosion ; je me jette dans le fossé, comme tous les autres d'ailleurs, ce doit être les munitions qui sautent, il est minuit et demi. Nous obliquons dans un petit chemin, mais les autres ne suivent pas ; le guide va voir ce qui se passe et ne revient pas. Nous attendons, blottis dans le fossé, quand une autre lueur est suivie d'une autre grande explosion : toujours les armes et munitions qui sautent. Le lieutenant Wagner envoie Gilbert vers la route nationale, mais l'ayant rejoint, il nous avertit que la colonne est perdue. Ce qui fait que nous sommes dix, dont neuf parachutistes et un patriote, le gars Loïc, qui ne connaît pas du tout la région. Nous repérons quand même un chemin et partons vers Callac après avoir consulté une carte. Nous traversons des bois, longeons des haies, traversons des fossés, toujours sous le clair de lune et aussi prêts à recevoir les boches.
Nous arrivons ainsi près de grands ravins quand, tout près de nous, des voix, des bruits de pas très nombreux, etc... Qui est-ce ? Des FFI, des boches ? Pour plus de sûreté nous ne nous faisons pas remarquer et restons tous les dix, seuls. Puis des maisons nous apparaissent, alors le lieutenant m'envoie frapper à la porte car, n'ayant pas d'uniforme, je me ferais moins remarquer. Ce bon lieutenant oublie sans doute que j'ai des bottes aux pieds et que sous ma veste sont cousus tous mes insignes de parachutiste et autres... Je pose donc mes armes et pars en bras de chemise frapper à la porte. Rien ne répond, il est une heure du matin et les gens doivent avoir une belle peur à cause des explosions de tout de suite et de la mitraille de toute la journée.
Que faire ? Nous nous penchons de nouveau à la lueur de nos lampes sur nos cartes, mais ne trouvons rien ; de tous côtés des bois, une route, quelques maisons, un petit ravin et un ruisseau dans le fond. Ajoutons à cela la lune et un beau ciel, voilà un paysage magnifique et féerique. Nous continuons, cette fois-ci, à travers la forêt ; pas loin de nous patrouillent des cosaques mais tout va bien, et ne sachant où nous sommes nous décidons de dormir là en attendant le jour. Ce qui fut dit fut fait et me voilà allongé, la tête appuyée sur une racine et grelottant car il ne fait pas chaud.
Je dors quand même un peu, quant, à 4 h et demi, réveil. De l'autre côté de la forêt, nous apercevons un fermier et les parachutistes m'envoient lui demander des renseignements. Je repars donc en bras de chemise et fais un peu partout des points de repère. Arrivé à la maisonnette, je frappe, personne. C'est alors que de derrière le tas de fagots j'aperçois un pauvre bougre, tremblant, qui s'approche. Il ne peut presque pas répondre à mes questions tellement il a peur de moi. Cet homme a couché dehors, ayant peur que, par suite des explosions, sa maison ne tombe par terre. Callac, d'après ses maigres renseignements, doit se trouver à 4 kilomètres à l'est. Je repars trouver les autres, mais plus personne. Pourtant je siffle l'air : "Sur le pont d'Avignon" et, enfin, Gilbert se lève de derrière un talus. Les autres sont partis et lui est resté m'attendre. Je me rhabille et nous partons quand le lieutenant Loïc Ranfast, Petit chef, et une vingtaine de parachutistes, passent sur la route. Nous nous joignons à eux et nous voilà partis vers Callac. Après une bonne petite marche, nous traversons la ville et nous dirigeons sur le château de Callac, grand rendez-vous. Nous nous arrêtons à une ferme et demandons à boire, mais toujours rien à manger, je commence à avoir faim. Je cause beaucoup avec Petit Chef qui me raconte le décrochage à minuit.
Enfin nous arrivons aux gorges et, enfin, voici le fameux bois où nous devons tous nous retrouver. Il y a là déjà tous les camions et les blessés. C'est la joie pour les parachutistes de se retrouver entre eux. Je retrouve le lieutenant Colineaux et le commandant Le Gouvello.
Les radios sont déjà affairés autour de la camionnette où se trouvaient leurs affaires. Ils me proposent de rester avec eux mais j'ai dans la tête de retrouver le capitaine Puech-Samson qui, lui, doit être là depuis hier soir. Je monte donc au château et là se trouvent tous les chefs en discussion, entre autres les commandants Bourgoin et Morice, mais pas de capitaine. Découragé et affamé et surtout bien fatigué, je me couche au pied d'un talus non loin des chefs et m'endors, je ne sais combien de temps, mais ce que je sais c'est que, tout à coup, je me sens réveillé et, ouvrant les yeux, j'aperçois le commandant Bourgoin qui, devant moi, me regarde en riant. Je me lève aussitôt et veux me mettre au garde à vous, mais je retombe tellement je suis fatigué. Alors, très gentiment, le commandant s'occupe de moi et me fait monter dans un grenier à foin où je dors vraiment bien.
Quand je me réveille, trois déceptions viennent me frapper : d'abord, une abondante pluie tombe et la cour est déjà inondée ; ça va être gai. Ensuite, j'ai beau chercher partout autour de moi, je ne retrouve plus ma carabine, on me l'a volée, j'en pleure presque, d'autant plus que j'ai encore sur moi toutes mes munitions. Je vais pour descendre, furieux, quand je ne trouve plus d'échelle.
J'appelle Maurice, le cuisinier, qui est en train de faire cuire sous un hangar de la viande pour le repas. Il m'apporte l'échelle, je vais à l'auto du commandant où j'avais mis la veille mon petit baluchon, je le retrouve fort heureusement, mais j'ai beau demander, chercher, m'affairer, toujours pas de carabine.
Il est presque midi, chacun va et vient, les ordres se donnent, les autos vont dans tous les sens et tout cela sous la pluie, dans la boue, et traqués. En effet, les allemands s'amusent maintenant à nous courir après et, déjà, dans quelques bois, les FFI se sont rabattus. Le capitaine n'est toujours pas là ! Je me joins aux radios auxquels le commandant Bourgoin me confie. La décision est prise de se disperser et de ne pas reformer de camp, l'endroit n'étant pas assez propice.
Alors chacun fiche le camp de son côté et va rejoindre sa famille, sa ferme, mais les pauvres parachutistes vont être, eux, obligés de se cacher dans des endroits inconnus. Je vais donc partager leur vie, tant mieux ! Le lieutenant Marienne, toujours avec son bandeau sur la tête, donne des ordres, réunit les jeeps et part pour nous protéger. Enfin le déjeuner ; drôle de déjeuner, un bout de viande sur du pain trempé. La pluie est de plus en plus forte et les traces des roues se voient de mieux en mieux dans la boue. Je reste un peu à arranger le camion des radios et, sur ma demande, ceux-ci m'affirment que ça ne fait rien qu'on m'ait volé ma carabine et qu'il y en a une autre pour moi dans l'auto. Je les crois (mal m'en prit).
Le bois est maintenant à peu près désert. Je vois passer les commandants Bourgoin et Morice et les capitaines Guimard et Brunet, tous en civils, ils vont prendre le vrai maquis. Ils me demandent de les accompagner jusqu'au moulin de Saint-Aubin où il y aura une cachette sûre pour nous. Mais je ne suis pas en civil et je n'ai pas le temps de me changer, car ils sont pressés ; je les rejoindrai donc avec les radios et le camion. La pluie tombe toujours, enfin nous partons. Où sont les allemands ? C'est à peu près calme aussi dans un bruit que l'on trouve pour le moment bien trop fort, la 11 légère avec Lili, Jean Guignon, René Allain, Raymond Guillard, part, suivie de près par notre petite camionnette conduite par un garagiste, chargée d'armes et de matériel radio, avec la lieutenant Hoffman et ses deux radios, Gilbert et Jacques et moi-même.
Le capitaine n'est toujours pas là et je suis désespéré. Voici maintenant la route, puis la route nationale, c'est bien imprudent, enfin tant pis, il faut passer. Les boches patrouillent mais nous n'en rencontrons pas quand soudain, après un petit village, au détour de la route, on nous annonce : "les Cosaques !" Que faire ? Le premier petit chemin venu fait notre affaire, mais pour comble de malheur la camionnette tombe en panne. Je suis très nerveux, nous poussons la voiture, nous voici enfin à l'abri des vues indiscrètes mais non des oreilles, car avec ses petits pneus et la boue, la pauvre Citroën ne peut plus avancer et patine en faisant un boucan du tonnerre.
Nous arrivons tant bien que mal au milieu du chemin et nous arrêtons car, paraît-il, il y a aussi des allemands de l'autre côté ; j'en doute fort étant donné qu'avec le bruit que l'on faisait les fritz devraient déjà être là. Chacun prend un poste de garde de chaque côté. Le premier qui arrive est descendu ! C'est ici la seule fois où j'ai eu vraiment peur car s'ils étaient arrivés nous étions encerclés et pris. J'en profite pour me mettre en civil et mets toutes mes armes et munitions dans le fond de la voiture. Nous fumons une cigarette et, Gilbert étant revenu d'une exploration et ne nous annonçant rien de grave, nous repartons par l'autre côté, ne pouvant faire demi-tour. Voilà la grande route, personne. Et, prudemment, chacun, de peur, rentre chez soi, et d'allemands point ne voit !
Les moteurs ronflent et nous faisons à peu près 3 kilomètres. Déjà, nous apercevons le moulin de Saint-Aubin où je retrouverai le colonel Bourgoin. Enfin, nous quittons cette grande route où tant de fois, il y a 15 jours, nous avons passé Guy et moi à vélo en mission. Nous sortons dans un petit chemin où il y a d'immenses mares d'eau et il pleut toujours. Nous n'en sortons plus. C'est alors qu'apparaît un homme boitant et à l'air un peu farouche. Je l'arrête et le conduit au lieutenant. C'est un dénommé Gaby qui connaît bien les filles Mallard du camp et qui nous mène vers le colonel Bourgoin car nous ne savions plus le chemin. Je pars donc, armé, avec lui qui partira ensuite chercher ses chevaux pour dépanner les autos. Voici le moulin délabré où, à la fenêtre, j'aperçois la tête du colonel. À la bonne heure, ils ne se sont pas perdus.
Je monte le petit escalier de bois et les retrouve en haut autour d'une boite de conserves et d'un bon morceau de pain. Je suis très bien accueilli, il va sans dire ! Et je me restaure moi aussi, quelle faim ! Puis voilà Madame Chenailler, la femme du colonel Chenailler, dont le nom de guerre est Morice, chef de notre camp. Elle vient apporter du beurre. Elle est à la Follette, ferme à 300 mètres d'ici, avec ses deux fils, dans le maquis aussi. Puis les chefs partent et me confient à Yvonne Mallard qui devra m'emmener coucher soi-disant chez le curé de Saint-Aubin ou chez elles, à SaintAubin aussi. Avant de partir, le colonel Bourgoin me dit encore : "Loïc, c'est bien, tu as été magnifique, je ne l'oublierai pas et dès que je pourrai télégraphier je le ferai savoir à ton père. Les FFI comme toi sont vraiment des types épatants". Que d'éloges !! Ils s'en vont, et je reste avec Lili, Jean, etc… Ils s'installent pour la nuit sur des matelas, comme Yvonne tarde à venir. Il fait bien noir quand elle arrive et il pleut encore un peu, vraiment quelle journée ! Sa sœur Marie est venue aussi. Ce sont deux vaillantes filles et qui ont fait depuis bien longtemps déjà de la résistance et qui ont été ruinées par les boches. Un de leurs frères, d'ailleurs, a été tué par eux. Nous nous engouffrons dans la nuit, avec les affaires du colonel Bourgoin, pour les camoufler. C'est un sac assez lourd.
Soudain, un bruit de pas et une ombre qui se profile au clair de lune. Qui est-ce ? Nous nous accroupissons parmi les genêts et l'être passe sans nous avoir vu. La prudence est la mère de la sûreté et ce serait vraiment pas fort de se faire prendre maintenant, on ne sait jamais. Vu la distance de Saint-Aubin et sur mes instances, nous allons à la Follette, nous camouflons dans un fossé le fameux sac et rentrons dans la toute petite maison où se trouvent les chefs. Je monte dans le grenier et m'affale sur la paille, entouré d'une bonne couverture. Pourtant, bien qu'épuisé, je ne peux m'endormir de suite. D'abord, la tension nerveuse est trop forte et les aboiements incessants des chiens, les allemands ne rôdent-ils pas autour ? S'ils arrivent, aucune issue, tant pis.
Et puis où sont maman et les petits ? Que sont devenus grand-mère et tante et aussi SainteGeneviève et puis mon petit Guy parti avec les Pondart, où est-il ? Ah, que de questions angoissantes, puis je m'endors.
L'histoire de ces deux jours, les plus beaux de mon existence, est terminée. Pour une histoire plus complète, il me faudrait raconter mes activités d'avant le camp, du 1er au 7 juin, du camp, du 7 au 17 juin, et après le camp à la Follette, du 19 juin au soir au 3 juillet.
Septembre 1944
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par sgidplan le 31 Janvier 2015 à 18:00
La bataille marqua indiscutablement les esprits et l'occupant en Bretagne, à la veille
de la Libération de la région. Mais elle s'avéra également lourde de conséquences.Après le décrochage, au soir du 18 juin 1944, une traque sans merci fut entreprise par les
Allemands, malgré les pertes essuyées, notablement plus élevées que du côté français. Les maquisards comprirent dès ce soir que l'occupant n'allait pas en rester là.Ordre fut donné de se disperser le plus discrètement possible par petits groupes. Peu avant minuit, les stocks de munitions restés sur la zone de La Nouette furent dynamités. "Chaque formation devait dès lors rentrer sur son secteur d'origine. C'étaient les consignes", se souvient Joseph Jégo, résistant
de la 7e compagnie basée à Plumelec*. Joseph Jégo fut de ceux qui prirent la direction du château de Callac, propriété de M. de Lignère, à l'instar du commandant Bourgoin, du colonel Morice, du capitaine
Guimard ou encore du lieutenant Marienne.Le choix s'est porté sur Callac sur la base de renseignements fournis par les agents qui avaient constaté en fin d'après-midi qu'une troupe n'arrivait de ce côté. Le capitaine Puech-Samson, lui, resta en arrière garde avec l'un des agents de l'Etat major. C'est d'ailleurs lui qui fit détruire le dépôt d'armes
et de munitions. Le décrochage par petits groupes Les deux commandants et le capitaine, accompagnés de trois agents de liaison, partirent pour Callac vers 22 h, par mesure de sécurité, à tour de rôle, chacun
des agents précédant le groupe à environ 50 mètres. Le trajet se déroula sans incident.Après avoir séjourné au château durant la nuit, les membres de l'Etat major rejoignirent les villages de Folliette et Bréhélin en Sérent en longeant la rivière. Ils y restèrent une douzaine de jours avant de
quitter les lieux pour se diriger vers Lizio et Saint Servant sur Oust. Après un passage éclair au village du Hé puis de Guergnon, le groupe se sépara. Le commandant Bourgoin fut conduit au moulin de Guillac (sur
les rives du canal de Nantes à deux doigts d'être arrêté, il fut évacué vers La Ville-Ursule en La Croix-Helléan. Plusieurs jours après, il partit pour Sainte-Hélène sur le front de la poche de Lorient. Il y resta jusqu'au 7 août 44, jour de la Libération de Vannes.Le colonel Morice, lui, fut hébergé au bourg de Guillac avant de partir pour le moulin à papier de Bréhand-Loudéac. Le capitaine Guimard resta seul avec ses quatre agents et ses trois agentes de liaison en rapport avec deux agentes de l'extérieur. Quant au groupe dont faisait partie le lieutenant Marienne, il se rendit sur Plumelec, au Pelhué. Joseph Jégo fut de ceux-là; "Nous étions près de cent, la moitié du groupe qui était à la bataille." Au matin du 20 juin, stupeur : un groupe de Russes à cheval approcha à moins de 300 mètres de la ferme, à la recherche de maquisards. "Mon frère compta 35 chevaux.
“Certains corps n'ont jamais été retrouvés.”
Les Russes devaient être au moins autant. On est parti alors en vitesse, laissant derrière nous des
uniformes sur le linge. Dans la cour de la ferme, se trouvait encore un groupe, dont le lieutenant Martin et le chef du ravitaillement. Les Russes sont passés à quelques dizaines de mètres d'eux. Je m'étonne encore qu'ils ne soient pas intervenus et qu'ils ne se soient pas vengés sur la famille : ils n'avaient pu manquer de
voir le groupe resté dans la cour." Le plus vraisemblable, c'est qu'ils ne souhaitaient pas en découdre : "Je pense qu'ils ont fait semblant de ne pas les voir, qu'ils n'avaient aucune envie de risquer leur peau." Il y eut
des actes manqués. "La guerre, c'est ça." C'est un peu la loterie. "On pouvait tomber sur un groupe de salauds comme on pouvait tomber sur des soldats plus arrangeants.Mais j'ai toujours constaté que, dans un groupe, les premiers l'emportaient sur les seconds..."
Le groupe de Marienne se disloqua à son tour: "Nous partîmes dans les bois et allâmes d'une ferme à une autre." Transformés en fugitifs, les maquisards migrèrent de planques en planques jusqu'à ce que les
miliciens découvrent le 12 juillet le camp improvisé à Kerihuel en Plumelec. L'une des
pires représailles allemandes de la région s'en suivit : dix-huit personnes dont trois fermiers du village et quinze paras SAS furent tués dont le lieutenant Marienne.D'autres eurent lieu. "Plumelec a payé un lourd tribut, peut-être plus encore que Saint Marcel. Jusqu'à la Libération, tous les habitants des campagnes furent très affectés et effrayés par ces représailles."
De la fin juin au 6 août, la répression fut en effet terrible. Les plans des maquisards furent trouvés, la résistance désorganisée. De nombreux FFI furent capturés, torturés ou tués. "Le 23 juin, plusieurs centaines de soldats sévirent dans tout le bas de la commune. Ils abattirent de nombreux paras
et civils. Certains corps n'ont jamais été retrouvés. Le 27 juin se tint une terrible rafle, certainement la plus importante sur Plumelec." Joseph Jégo fut directement touché par cette vague de représailles sanglantes. Au Pelhué, son père fut arrêté le 30 juin et embarqué pour le fort de Penthièvre où il fut fusillé ainsi que six
autres Plumelecois. Joseph Jégo fut arrêté par les Allemands le 11 juillet. "Je fus surpris alors que je marchais sur une route. J'ai été embarqué pour Josselin avec un jeune para."Joseph Jégo crut sa dernière heure arrivée.
Les Allemands passent les deux hommes à tabac avec une brutalité incroyable. "Ils voulaient nous faire parler, qu'on balance d'autres camarades. Je ne le sus que plus tard, mais mon compagnon de captivité fut fusillé le 18 juillet." Joseph Jégo échappa de justesse à une mort certaine. Il parvint entre temps à s'évader, le 14 juillet, alors qu'il était détenu dans la cellule de torture. "Mes geôliers m'avaient laissé dans la salle de torture. J'étais allongé, déshabillé, sur une espèce de couche. Ils me surveillaient.
Comme j'avais besoin d'aller aux toilettes; j'ai demandé que l'on me donne mes vêtements prétextant que je ne pouvais sortir ainsi dans la cour. Au retour, je suis revenu sur mon lit. Les soldats, des Alsaciens, me proposèrent alors un livre, puis partirent de l'autre côté du compartiment."
Aussitôt, Joseph Jégo profita du répit pour soulever la crémone de la fenêtre qui donnait sur la rue et s'enfuir...
Au final, l'après la bataille fit plus de victimes que le combat en lui-même. Pour autant, la bataille fut-elle une erreur, comme certains ont pu le penser rétrospectivement ? Les avis restèrent partagés - et le sont encore - Source de terribles représailles, elle permit aussi de fragiliser l'étau allemand et galvanisa les
maquisards partis après la bataille sur d'autres fronts, comme celui de la Vilaine et
de la poche de Lorient . . . votre commentaire
votre commentaire
-
Par sgidplan le 20 Octobre 2014 à 21:45
Combats de Saint Marcel
LES 28 MAQUISARDS-F.F.I, PARACHUTISTES du 4 ème S.A.S et CIVILS MORTS AU COMBAT OU TUES LE 18 JUIN A SAINT MARCEL

Lors de la première attaque à 9 heures vers la ferme du bois Joly
Suzanne Berthelot, 15 ans, originaire de la région parisienne
Daniel Casa, 20 ans, S.A.S originaire de Marseille
Jean Le Blavec , 21 ans, F.F.I originaire de Crach
Paul Le Blavec, 20 ans, F.F.I originaire de Crach
Joseph Planchais, 20 ans, F.F.I originaire de Bain de Bretagne
André Robino, 21 ans, F.F.I originaire de Crach
Lors de la deuxième attaque à 10 heures vers Sainte - Geneviève
Cpl Henri Adam, S.A.S originaire d’Alsace
S/Lt Michel Brès, 32 ans, S.A.S originaire de Madagascar
S/Lt Roger Le Berre, 23 ans, F.F.I originaire de Brest
Louis-Marie Malbert, 36 ans, S.A.S originaire de St Quay -Portrieux
Lors des combats entre 14 heures et 22 heures et lors du repli vers Les Hardys-Béhélec et sur la route de Saint Marcel
Lt Henri Rio, 25 ans, F.F.I originaire d’ Auray
Sgt Adrien Le Canu, 26 ans, F.F.I originaire d’Auray
Vers La Petite Haie en Sérent
Jean-René Mollier, 22 ans, S.A.S originaire de Lac au VillersNicolac Schmitt, 20 ans, S.A.S originaire de Philippsbourg
Vers La Ville- Glin en Bohal
Charles Goujon, 29 ans, F.F.I originaire de la TrinitéPorhoët Lt Le Bouédec Louis, 33 ans, F.F.I originaire de Ploërdut
Dans un secteur non déterminéSerge Fercocq, 19 ans, F.F.I
Paul Guégan, 47 ans, F.F.I originaire de La Palud Trinité-sur-Mer
François Le Yondre, 21 ans, F.F.I originaire de La Trinité-sur-Mer
Robert Ménard, 20 ans, F.F.I originaire de Paris 8e
Georges Moizan, 21 ans, F.F.I
Faits prisonniers et fusillés à la Nouette
Emilien Le Grel, 23 ans, F.F.I originaire de Locoal-MendonVincent Le Sénéchal, 23 ans, F.F.I originaire de Mendon
Fait prisonnier et fusillé à Vannes le 18/07/1944
Laurent Le Lem, 31 ans, F.F.I originaire de Carnac et quatre combattants F.F.I non identifiés
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par sgidplan le 14 Octobre 2014 à 19:09
Ce texte est issu du livre de Henry Amouroux " Joie et douleur du peuple libéré - 6 juin au 1 septembre 1944 "
Le 5 juin, quelques-uns des hommes de du Colonel Bourgoin appartenant à ces unités " Special air service " créées pour jeter le trouble derrière les lignes ennemies ont été parachutés en Bretgane¹
1. Les S.A.S. datent, à l'initiative du Lt David Sterling, de juillet 1941
Delplante est parti à la recherche de Marienne et, l'ayant retrouvé, il a gagné le P.C. du Colonel Morice et Colonel Guimard, à Saint Marcel, lieu de rassemblement de tous les résistants de la région, groupés là, en principe, dans l'attente d'un débarquement de diversion dans la presqu'ile de Quiberon, feinte imaginée par les Alliés au même titre que la feinte qui fit croire à un débarquement sur les côtes du Pas-de-Calais et du Nord.
D'autres parachutistes - notamment les rescapés d'un combat qui s'était déroulé dans la forêt de Duault - devaient arriver à Saint Marcel et y découvrir, selon le Boterf, historien de la Bretagne dans la guerre, un spectacle surprenant, aussi bien par sa gouaille bon enfant que par son imprudent désordre et sont patriotique laisser-aller.
D'après tous les témoignages, le maquis de Saint Marcel, surnommé à quatre lieues à la ronde " La Petite France ", vit et recrute à ciel ouvert. La garde, mal ou peu assurée, laisse entrer et sortir qui veut. Les bistrots des villages voisins reçoivent la visite de maquisards bavards et vantards. Un parachutage a-t-il lieu ? C'est sous le regard non seulement de tous les FFI du camp, mais encore de leurs familles et de leurs amis, informés de l'événement: J'avais tout à fait l'impression, écrira le radio Jean Paulin, de me trouver un soir de 14 juillet avant guerre, attendant le feu d'artifice qui devait clôturer la fête et qu'une population en gaieté s'apprêtait à applaudir.
Les maquisards spéculaient sur le patriotisme indiscutable de la population et se sentaient d'autant plus en sécurité qu'ils étaient chaque jour rejoints par de nouvelles recrues qui prenaient parfois plaisir à narguer ouvertement les Allemands.
Comment le passage de très nombreux avions alliés (150 entre le 6 et 17 juin) parachutant hommes et matériel à quatre kilomètres de l'observatoire allemand de la Grée-en-Plumelec; comment les fréquents sabotages opérés par les " sticks " parachutés, mais également par les maquisards dans la région de Malestroit et de Ploërmel; comment les imprudences commises par des unités, s'affichant par bravarde cocardière, à l'image du bataillon volontaires de Pontivy empruntant en plein jour les routes du Morbihan avec, pour le précéder, une avant-garde de 80 cyclistes armés; comment autant de bruyants et visibles indices d'une mobilisation populaire alimentée, armée, encadrée et dirigée depuis Londres, n'auraient-ils pas inquiété les Allemands et ne les auraient-ils pas incités à réagir brutalement contre une résistance jugée assez rassemblée pour que ses pertes soient lourdes, assez mal équipée pour qu'elle ne soit pas en état de rester efficacement ?
Lorsque les Allemands attaquent, le 18 juin, après que sept des huit feldgendarmes envoyés en patrouille vers 4h30 ont été tués - mais le huitième s'est échappé et il a donné l'alarme - quelles sont, à Saint-Marcel, les forces en présences ?
Du côté des maquisards, 2700 hommes environ: 8° bataillon FFI du Commandant Caro, 2° bataillon du Lt Colonel Le Garrec, bataillon du Général de réserve de La Morlaix, compagnies des Capitaines Cosquer et Bessières et 200 parachutistes du Colonel Bourgoin. Assez bien équipés en armes automatiques, les résistants sont totalement démunis d'armes lourdes. Les avions alliés ont bien parachuté quatre mitrailleuses Vickers mais, en arrivant au sol, elles ont toutes été détériorées par la fusion des grenades incendiaires placées dans les mêmes containers. Dans la nuit qui précède l'attaque, l'armurier Le Gall va certes réussir à reconstituer l'une de ces mitrailleuses qui sera placée sur l'une des quatre jeeps que les appareils alliés avaient précédemment larguées, chacune d'elles étant soutenue par six parachutistes, mais comment une seule mitrailleuse pourrait elle répliquer victorieusement au feu de toutes les armes allemandes ?
Selon le mot de Robert Aron, l'occupant va mettre en jeu des unités croissant selon une « progression géométrique » : une patrouille (celle des huits felgendarmes), puis un bataillon, puis un régiment, enfin une division.
Le combat de Saint-Marcel se déoulera d'ailleurs au rythme de l'arrivée des renforts allemands. Ne parlons pas des gendarmes liquidés à l'aube. C'est à 6H30 que deux cents hommes d'un bataillon allemand, venu de Malestroit, se lanceront à l'assaut des lignes françaises près du château des Hardys. Fauchés par les armes automatiques des maquisards, rejetés par une contre-attaque d'un détachement de parachutiste commandé par le lieutenant Marienne, qui dirige, debout, les opérations dans la jeep équipée de la mitrailleuse Vickers, les survivants allemands devront se replier.
L'occupant ne saurait rester sur cet échec. Si, vers midi, une certaine accalmie règne sur le front, c'est tout simplement parce que l'allemand attend l'arrivée de nouvelles troupes alertées à Vannes, à Coëtquidan et même à la Baule. Des unités antiparachutistes, des Géorgiens, de l'artillerie, des blindés, représentant au total l'effectif d'une division, vont successivement arriver sur la nationale 774.
Renseignés par de nombreux villageois, Bourgoin et les autres chefs de la Résistance n'ignorent rien de la mise en place du dispositif allemand. Mais ils ne peuvent le désorganiser. Aussi Bourgoin demande-t-il à Londres l'intervention de l'aviation alliée.
Celle-ci se présentera vers 16 heures, alors que les combats ont déjà repris au nord, au sud et à l'est des Hardys et de Sainte-Geneviève, sur un front d'environ deux kilomètres. Mais à l'action des Thunderbolt et des Mosquito est trop brève pour briser l'assaut allemand. Sans doute les avions mitraillent-ils les camions rangés sur la nationale 774, ils ne peuvent rien contre des troupes qui, dans les bois, se trouvent au contact avec les maquisards.
Aussi, d'un commun accord, les résistants et le commandement des parachutistes décident-ils d'abandonner le camp à 22h30, abandon qui doit être suivi de la dispersion de tous les combattants dans le Morbihan et dans les départements voisins. Encore faut-il tenir jusqu'à 22h30, alors que la pression ennemie se fait toujours plus vive.
Les heures qui suivent verront donc des combats acharnés autour de positions – Le Bois-Joly, le château Sainte-Geneviève- dont la provisoire sauvegarde permet l'évacuation des familles de paysans, des blessés, d'abord transportés à Sainte-Geneviève, puis, au fur et à mesure que l'étau se resserre, d'une partie des armes, des paquetages, des postes émetteurs, de ce qui peut trouver place dans une vingtaine de camions devant lesquels une route, jusqu'au dernier moment, restera miraculeusement libre.
Les F.F.I. des bataillons Le Garrec, Caro, de La Morlaix se battront bravement, les parachutistes accumuleront les actions d'éclat, attaquant furieusement à 20 heures avant de subir une contre-attaque lancée, quinze minutes plus tard, par un ennemi qui sait la victoire à sa portée, mais le résultat de tant de sacrifices sera décevant.
Il existe plusieurs façons de lire un bilan. Si l'on évoque seulement les pertes de la journée, la victoire paraît être du côté de la Résistance. Les Allemands auraient, en effet, perdu 560 tués, les Français 50 parachutistes et 200 maquisards. Comme tant d'autres engagements à la comptabilité aujourd'hui impossible, puisque faussée par la propagande, le chiffre des morts allemands paraît surévalué. Cependant, même si la Wehrmacht a perdu deux fois plus d'hommes que les maquisards et que les parachutistes, est-ce cela qui importe dès l'instant où le terrain doit être abandonné à un ennemi impitoyable ?
Terminée la bataille de Saint-Marcel, une autre bataille commence. Ou, plus exactement, commence la chasse à l'homme. Les villageois, jusqu'alors enthousiastes, généreux, imprudents, se terrent.
Selon Le Bortef, les maquisards qui ont quitté Saint-Marcel découvrent le 19 juin au matin, « une population claquemurée derrière ses volets dans l'attente anxieuse des premières réactions de l'occupant »< . Réactions qui seront immédiates et cruelles.
Avant de se replier de Saint-Marcel, Bourgoin – qui vient d'être nommé lieutenant-colonel, mais il l'ignore - a rendu leur liberté à tous les prisonniers allemands. A l'un deux, il a remis une lettre adressée au général allemand, commandant la région : « Les parachutistes français, libres, écrit-il, sont des soldats d'une armée régulière portant un uniforme et se battant à visage découvert. Ils observent les lois de la guerre et respectent les conventions internationales. J'espère que les troupes allemandes feront de même. »
Bourgoin est-il informé des directives données le 18 octobre 1942 par Adolf Hitler ? Je ne sais pas. Mais en juin 1944, voici près de deux ans que le Führer a ordonné d'exterminer « jusqu'au dernie, au combat comme à la poursuite » même lorsqu'ils sont « en uniforme régulier de soldats », tous les « individus faisant partie des commandos et employés comme agents secrets, soboteurs, etc. ». Se constituent-ils prisonniers, toute pitié doit « être refusée » à ces « gredins ».
Sans doute le texte du 18 octobre 1942 ne concerne-t-il pas les soldats ennemis capturés ou qui se rendent au cours de batailles normales (attaques sur une grande échelle ou opérations importantes du débarquement par mer ou par air), mais les parachutistes français de Bourgoin, lâchés derrières les lignes allemandes, et à plus forte raison les maquisards et ceux qui les aident seront considérés et traités comme des « gredins » indignes de pitié.
La chasse qui commence vise indistinctement tous ceux et toutes celles qui, de loin ou de près, ont participé à la Résistance. Les plus exposés sont évidemment les blessés de la bataille de Saint-Marcel. Plusieurs d'entre eux, dont 17 parachutistes, ont pu être transportés clandestinement à la clinique de Malestroit. Le 23 juin, lorsqu'un détachement allemand procédera à une inspection, ils seront tous sauvés grâce au courage et à la présence d'esprit du docteur Quéinnec et des sœurs augustines.
Revêtus de tenues religieuses par la mère supérieure et par l'économe, mère Marie de la Trinité, plusieurs parachutistes purent ainsi s'abîmer en longues prières dans la chapelle, cependant que le docteur Quéinnec fit passer pour des victimes d'un récent bombardement des hommes atteints pendant la bataille.
C'est un miracle. Mais les miracles ne se reproduisent pas.
A Sérent, à Guéhenno, où cinq parachutistes et dix-huit maquisards ont trouvé la mort dans une embuscade, à Plumelec, à Bot-en-Guégon, à Caradec, à Pluvigner, où huit maquisards eurent les jambes, puis la colonne vertébrale brisées à coups de barre de fer, à Kergoët, à Locminé, les Allemands, et parfois les miliciens, vont faire régner la terreur.
Sans doute les drames qui ont eu pour théâtre une partie de la Bretagne sont-ils moins connus des Français que d'autres drames. La mémoire collective a retenu Tulle et Oradour. Elle a oublié – si jamais elle les a sues – les horreurs commises par cette colonne du 2è régiment de renfort de parachutistes qui, sur son passage, pille le bourg de Guégon, mitraille les passants, exécute un enfant de quatorze ans, le jeune Bertho, accusé d'avoir ravitaillé le maquis, fusille quatorze garçons près du Faouët et sept autres à Pluherlin massacrés, ceux-là, sous les yeux de leurs parents et amis.
A Locminé, où malgré les ordres allemands des jeunes gens ont suivi le cortège funèbre de leur camarade Jean Annic, trente-deux d'entre eux seront arrêtés le 3 juillet puis exécutés. Le 12 juillet, toujours à Locminé, Allemands, Géorgiens et membres de la « formation Perrot », ayant rassemblé tous les hommes de dix-huit à quarante cinq ans dans la cour de l'école communale, feront avouer à deux anciens maquisards de Saint-Marcel des caches d'armes : sous un pommier, des fusils ; dans une tombes, des grenades et des mitrailleuses. Les deux maquisards seront fusillés et, le 25 juillet, vingt-quatre garçons de la région seront tués d'une balle dans la nuque par deux gradés du commando S.D. De Rennes.
Le commando Bourgoin avait réclamé pour ses parachutistes le respect des lois de la guerre. Lorsqu'ils capturent, près de Château-Remaison, cinq maquisards et neuf parachutistes, les hommes du capitaine Walter Holtz ne tiennent aucun compte des protestations des parachutistes faisant état de leur qualité de combattants réguliers. Au même titre que les maquisards, ils seront abattus d'une rafale de mitraillette.
Dans leur chasse aux résistants, les Allemands sont aidés par quelques Français qui mettent à profit le patriotisme parfois imprudent de toute une population pour obtenir des renseignements, se glisser dans les réseaux ou, plus simplement, retrouver, dans les bois où ils se terrent, les rescapés de Saint-Marcel.
Si Bourgoin, et le colonel Morice pourront, jusqu'à la fin, échapper à toutes les recherches, bien des résistants – maquisards et parachutistes – devaient tomber dans les filets tendus par le trio infernal que forment Zeller, Munoz et Gross.
L'ex-officier Louis-Maurice Zeller, dit Marc Evrard, ou encore Marc Denis, a été rayé des cadres de la marine pour trafic de stupéfiants. Sauvé de la noyade par des soldats allemands, c'est, affirmera-t-il à son procès, afin de prouver sa reconnaissance à ses bienfaiteurs qu'il s'engagera dans la L.V.F., servira à Saint-Brieuc d'agent recruteur pour la Légion antibolchevique puis, de glissades en trahisons, acceptera sans barguigner le rôle d'agent de renseignements.
Comme d'autres agents allemands, il est à la recherche de Bourgoin, et sans doute la prime de cinq millions promise par les Allemands n'est-elle pas étrangère à sa passion de chasseur. A défaut de capturer immédiatement Bourgoin, du moins espère-t-il capturer un parachutiste qui, en parlant sous la torture, le mènera directement ou indirectement jusqu'à l'homme qu'il recherche.
L'un des adjoints de Zeller s'appelle Munoz. Un malin, le traître Munoz. Comme il a arrêté le lieutenant parachutiste Grey et le sergent Jego, c'est vêtu de l'uniforme de Grey qu'il parade dans un café de Guéhenno. Sans penser à mal – comment penser à mal devant ce para de la France libre à la recherche de ses copains ? -, des consommateurs bavards, mais malheureusement exactement renseignés, fournissent des indications sur la retraite du lieutenant Marienne, l'un des héros de la bataille de Saint-Marcel.
En compagnie de plusieurs maquisards et de six parachutistes, Murienne, « le lion » de Saint-Marcel, est caché près de Kerihuel, dans les dépendances d'une ferme occupée par deux beaux-frères, Gicquello et Danet.
Le 12 juillet, au petit matin, lorsque Munoz, accompagné de plusieurs « faux maquisards », et toujours revêtu de l'uniforme du lieutenant Grey, se présente chez Danet, pourquoi le fermier se méfierait-il ? C'est donc lui qui conseille Munoz et à sa bande d'aller réveiller huit maquisards qui dorment dans un appentis. Réveil brutal. Les maquisards sont saisis, désarmés, jetés à plat ventre sur l'aire de la ferme. Marienne, le lieutenant Martin, les sergents Maddy et Judet, le caporal Baujon, les premières classes Blettein et Flamant n'ont rien entendu. A quelques centaines de mètres de la ferme, ils dorment toujours sous les parachutes dont ils se sont fait des abris.
Le sergent Judet, seul rescapé du drame, a laissé un rapport sur cette matinée du 12 juillet 1944.
« Deux miliciens étaient entrés sous notre tente, braquant, sur nous une mitraillette et nous injuriant à qui mieux mieux. Nous fûmes conduits à la ferme qui nous ravitaillait. En arrivant dans la cour, je vis étendus par terre, les mains sur la tête mais encore vivants, une vingtaine de civils et une dizaine de femmes debout. Nous fûmes mis face au mur, les mains en l'air et nous fûmes fouillés.
Le capitaine Marienne et le lieutenant Martin furent séparés de nous et, sur un ordre, se couchèrent aux côtés des civils, dans la même position que ces derniers. Jusque là, je croyais encore simplement être fait prisonnier et j'échafaudais déjà des plans d'évasion, lorsque j'entendis une rafale et vis un de mes camarades, immédiatement à ma droite, se crisper. J'ai sauté par-dessus le corps de mon ami et je me suis enfui à travers les buissons. »
A l'exception de Judet, tous les parachutistes et tous les maquisards seront exécutés ainsi que le fermier Danet et l'un de ses voisins, le lieutenant Morizur, qui avait servi de guide à de nombreux parachutistes.
Avant d'incendier le hameau, Zeller et trois des meurtriers de Marienne et de ses camarades se feront photographier devant leurs victimes.
Tragique photo que celle de ces Français chasseurs de Français. Armes à la main ou à la bretelle, les voici debout, goguenards et triomphants au milieu des cadavres. On les devine ivres d'un succès dont ils espèrent qu'il en annonce bien d'autres !
Au bénéfice des Allemands, Zeller et ses complices réussiront, en effet d'autres « affaires ». Ce sont eux qui arrêteront le lieutenant Alain de Kerillis qui a été parachuté dans la nuit du 7 au 8 juin et qui se cache, avec trois paras blessés et neuf hommes valides mais épuisés, près de la ferme de Kerlanvaux. Kerillis ne sera pas tué immédiatement. Zeller a ordonné de l'enfermer, en compagnie du lieutenant Fleuriot, dans une cellule de la prison-école de Pontivy. Il attend d'eux une information sur la cachette de Bourgoin. Interrogés, et l'on sait ce que cela veut dire, pendant près de trois semaines, le lieutenant Fleuriot, qui succombera sous la torture, et le lieutenant Alain de Kerillis ne parleront pas.
Les Alliés approchent. Il devient urgent de se débarasser de témoins qui deviendraient de terribles accusateurs.
En uniforme Allemand, Zeller, Munoz et Gross assisteront, le 23 juillet à l'exécution d'Alain de Kerillis ; de Jamet, le lieutenant de gendarmerie de Quimperlé ; du radio « Rolland », de Morlaix, et de l'architecte Donnart qui, sous le pseudonyme de Le Poussin, avait considérablement contribué à l'organisation de la Résistance dans le Finistère.
Avec ces quatre résistants tombe le lieutenant Grey.
Celui dont Zeller et Munoz avaient, tour à tour, revêtu l'uniforme pour mieux approcher et abuser les résistants.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par sgidplan le 12 Octobre 2014 à 15:42
C'est un fait d'histoire plutôt méconnu : la première bataille de la Libération, le jour
même du Débarquement en Normandie, s'est déroulée dans le Morbihan, entre Sérent
et Saint-Marcel. Depuis la défaite de 1940, il y eu certes de nombreux engagements, mais jamais de bataille à proprement parler. L'occupant s'était toujours heurté à des forces mobiles s'évacuant rapidement. A Saint-Marcel, les effectifs engagés, la volonté de tenir sur place, l'acharnement de l'ennemi dans la riposte ont marqué la journée du 18juin 1944 qui restera dans l'histoire de la Bretagne et de la France libre.Utilisée comme base de réception de renforts et d'armes par le commandement FFI, le
terrain de La Baleine à côté de la ferme de La Nouette à Sérent accueillit dès le 1er juin des bataillons (bataillons Caro et de la Morlaix) en vue de préparer une vaste opération de diversion. Péparée de longue date, elle est destinée à fixer des divisions
allemandes nombreuses en Bretagne et susceptibles de venir en renfort sur le front de la Normandie.Le 4 juin, la BBC diffuse le message conventionnel "Les dés sont sur le
tapis", ordonnant le plan vert, qui se traduit par la mise en application d'opérations de
destruction de voies ferrées.Le 5 juin,nouveau message : "Il fait chaud à Suez", ordre d'application du plan rouge, donnant le coup d'envoi d'opérations de guérilla.
Dans la nuit du 5 au 6 juin, un petit détachement du Régiment de chasseurs parachutistes est largué dans la région de Plumelec. Cet élément précurseur,
commandé par le lieutenant Marienne, est attaqué malheureusement par les Allemands (lire chapitres précédents) et essuie des pertes : c'est le premier mort de la campagne de Libération en France. Le stick réussit malgré cela à joindre le PC du commandement FFI à La Nouette.Dans la nuit du 9 au 10 juin, le commandant Bourgoin est parachuté à Saint-Marcel avec
200 hommes de son régiment avec armement, jeep et munitions. C'est à partir
du 10 juin que commencèrent les parachutages massifs d'armes et de munitions qui permirent d'armer les maquisards bretons. Pendant la semaine du 11 au 18 juin, le terrain de Saint-Marcel est survolé par plus de 150 avions ! En une seule nuit, le 17 juin, 35 avions déversent 750 containers d'armes, quatre jeeps équipées et 50 hommes.En plus de la défense fixe du terrain constituée par les deux bataillons, d'autres bataillons commencent à affluer vers Saint-Marcel afin de percevoir leur armement.
Le 10e bataillon (commandant Le Coutaller) traverse le département aller et retour pour
recevoir le matériel d'une compagnie complète ! Le 1er bataillon (commandant
Hervé) perçoit également son armement à Saint-Marcel. Aussitôt, armés et équipés, les
unités regagnent leur zone d'action.Dans la nuit du 13 au 14 juin, le 2e bataillon FFI (commandant Le Garrec) arrive à
Saint-Marcel pour être équipé à son tour. Ce bataillon venait de subir dans les bois de
Saint-Bily une dure attaque, devant laquelle, faute d'armes, il ne put que chercher à s'éclipser dans les bois où l'ennemi n'osa pas le pourchasser. Le 2e bataillon ne
dut rester que trois jours au terrain de parachutage. Ce séjour fut prolongé par les
circonstances, le mauvais temps n'ayant pas permis les réceptions d'armes attendues.Ilétait encore à Saint-Marcel le 16 juin et prit une importante part à la bataille. Le 18 juin, au lever du jour, au moment où se déclencha la bataille de Saint-Marcel, la
situation des unités françaises était la suivante :- le terrain de parachutage dont le centre était situé à 1 km au nord du
hameau de La Nouée était couvert de tous côtés par des unités FFI et des parachutistes.Le PC était installé dans la ferme de La Nouée.
Le lieutenant-colonel Morice, chef
départemental FFI, assurait le commandement
de ses troupes, le commandant Bourgoin
dirigeant son unité de parachutistes et
l'ensemble des opérations.
- A côté de l'Etat major, dans les dépendances
de la ferme, était installé le service de santé par
le médecin commandant Mahéo.
- Le bataillon Caro avec 1.000 hommes bien
armés couvrait le nord et l'ouest du dispositif.
- Le bataillon de la Morlaix (500 hommes)
couvrait le nord-est du quadrilatère.
- Le bataillon Le Garrec (1.000 hommes)
couvrait le sud et le sud-est. - La liaison entre
les bataillons Le Garrec et de la Morlaix était
assurée par l'unité de parachutistes (200 hommes).
- Les jeeps armées formaient avec une section
de parachutistes une unité mobile à grande puissance de feu sous les ordres du capitaine Marienne.En cas d'attaque, l'ordre était de tenir sur place.
Ci-dessus : document FFLSAS
Les excellents champs de tir des armes automatiques couvraient la position et des
avant-postes bien placés permettaient d'éviter toute surprise. Différents itinéraires
de dispersion avaient été toutefois définis avec lieux de regroupement en cas
d'attaque trop puissante de l'ennemi.Le 18 juin, les Allemands ne pouvaient plus ignorer la présence, dans la région de Saint-Marcel, d'un rassemblement de forces adverses. Les 150 avions parachuteurs
n'avaient pu mener leurs missions, on s'en serait douté, sans se faire repérer à un
moment ou à un autre par les postes de guet allemands, en particulier celui du moulin de La Grée en Plumelec et celui du château de Villeneuve.Dès le 15 juin, les projecteurs de l'aérodrome réquisitionné de Meucon éclairaient les avions larguant leur containers. Plusieurs parachutages trompés par des signaux ennemis avaient d'ailleurs été capturés par les Allemands. Convaincus d'une menace imminente, ce sont ces derniers qui prirent les devants, le 18 juin, au petit jour...
4 h 30. Poste de surveillance, château des Hardys-Béhélec, 4 h 30 du matin, heure
solaire : le feu est ouvert. Deux voitures de Feldgendarmes allemands pénètrent dans le camp par la route de Saint-Marcel à L'Abbaye. La première voiture réussit à
traverser le barrage, mais la deuxième est sitôt détruite par un anti-chars. Les
Feldgendarmes du premier véhicule ouvrent le feu sur le poste des maquisards qui tient
la route, tuant le chef de poste, le sergent chef Le Canut, et blessant deux FFI du
bataillon Le Garrec. Les maquisards ripostent : cinq Allemands sont tués, deux
sont faits prisonniers. Un seul parvient à s'échapper. Il donnera l'alarme. C'est vers
6h30 que la garnison allemande de Malestroit, à 3 km de Saint-Marcel, est prévenue.Cette garnison comprenait un bataillon de la Wermacht de 500 hommes.
Aussitôt, deux compagnies sont mises sur pied pour attaquer le camp. Un plan
retrouvé quelques jours plus tard par le recteur de Saint-Marcel révèlera aux
Français ce que les Allemands connaissaient du camp : ils le plaçait au nord de la route
de Saint-Marcel, à L'Abbaye. C'est sur cet axe, naturellement, que se concentra l'effort
allemand, conforté par le fait que c'est sur ce secteur que se produisit l'embuscade au petit matin du 18 juin. L'axe d'attaque se porte sur un front d'environ 500 mètres au nord-est du camp, du côté du Bois-Joly. Cinq FFI et une bergère tués à bout portant Profitant de la protection offerte par les haies et les chemins creux, les troupes ennemies progressent sans être vues. L'un des hommes, suivant le chemin sortant du calvaire de Saint-Marcel vers Les Grands-Hardis, réussit à atteindre le poste situé à 100 mètres au sud de la ferme du Bois-Joly, sans avoir été découvert. Accompagné d'autres Allemands, ils débusquent un poste FFI : ils abattent cinq FFI ainsi que la bergère de la ferme qui gardait ses vaches dans la prairie voisine. L'effet de surprise est réussi pour les Allemands, mais l'alerte est belle et bien donnée. Entre Sainte-Genevieve et la route, tout le monde était à son poste.A 9 h du matin, l'aumônier de Saint-Marcel, l'abbé Guyodo, s'apprêtait à donner la messe à Sainte-Geneviève. Il confessait lorsque se déclencha la fusillade vers Le Bois-Joly. Il se rendit aussitôt sur les lieux du combat pour donner aux blessés le secours de son ministère. Les armes automatiques françaises ouvrirent le feu dans toutes les directions. Surpris à leur tour, les Allemands se jettent dans les champs de blé pour accentuer leur progression. Ils se couvrent par des grenades fumigènes et atteignent vers 9h30 la ferme du Bois-Joly. Une contre-attaque à coup d'armes automatiques les rejettent de la ferme. Les pertes sont importantes. Les Allemands se font faucher, ils préfèrent se replier sur Saint-Marcel. Cette première action dura trois quarts d'heure. Elle engagea la 2e compagnie du 3e bataillon, deux sections du 12e bataillon et une section de parachutistes. Les mortiers allemands à l'action A 10h, l'attaque allemande reprend.
La direction générale donnée est la même, mais l'effort se déplace tout de même plus
nettement vers le nord du Bois-Joly et Sainte-Geneviève. L'effectif est doublé : deux
compagnies sont cette fois engagées. Cette deuxième attaque voit l'entrée en action des mortiers allemands qui prennent à partie les lisières du bois de Sainte-Geneviève, d'où partent les rafales françaises les plus nourries. La bataille fait rage jusqu'à midi.
Les Allemands cloués au sol par les tirs automatiques, subissent de lourdes pertes
dans les champs de blé et les prairies du sud de Sainte-Geneviève. Les blessés affluent à Saint-Marcel où ils sont évacués. Du côté français, aussi, les pertes sont importantes.
Les premiers blessés sont dirigés vers le château de Sainte-Geneviève où Mlle Bouvard prodigue les premiers soins. L'évacuation des blessés vers le poste de secours se fait ensuite par des jeeps des paras qui assuraient le service par les chemins creux. Le poste de secours de La Nouée reçoit les blessés soignés sur place avant de les évacuer à la tombée de la nuit. Au poste de La Nouée, le commandement ne reste pas inactif. Il n'intervient pas pour le moment dans la bataille : les chefs du secteur avaient leurs troupes bien en main, les positions initiales restaient inviolées. Mais il se constitua des réserves prêtes à entrer en action pour une contre attaque si les troupes devaient se replier. Ces réserves de la valeur d'une compagnie, prélevée sur le 12e bataillon et renforcée par des paras, furent disposées au centre de la zone d'action de l'ennemi dans les bois, à 400 m au Nord du Bois-Joly.
L'Etat major interallié de Londres fut alerté vers midi. Il lui fut demandé des secours par les airs et des ordres. Une légère accalmie se produisit vers midi, mais le combat ne cessa pas pour autant. Les Allemands restèrent sur place et tirèrent sur tout homme qui se vit voir.A 14h, l'attaque reprend et s'étend. Elle déborde nettement au nord du château
de Sainte-Geneviève et comprend au sud le secteur des Hardys-Béhélec.Le front s'étire désormais sur 2.5 km. Alors que dans la matinée seules les troupes allemandes étaient engagées, désormais des renforts allemands mais aussi georgiens sont intégrés. Ce sont les Georgiens qui attaquent les Français au nord-est du dispositif de la compagnie Laralde. L'ennemi avance dans les taillis à l'Est de Sainte-Geneviève. Mais les paras tiennent. Les bois sont en feu. Vers 14h30, la défense à
hauteur du château de Sainte-Geneviève est démantelée par la perte des servants de
deux FM tués à leur poste. L'ennemi se jette dans la brèche et arrive jusqu'au château. Il est pris à partie par des armes automatiques placées à la hâte et ne peut déboucher. Les lignes se fixent dans cette région jusqu'à 19h00.
Au centre, l'action qui n'a pas cessé, reprend de la vigueur en direction de la ferme du
Bois-Joly. A 17h30, les lignes françaises deviennent intenables. La ferme est prise. Il
faut reporter le front sur l'arrière, en lisière des bois. Au sud de la route de L'Abbaye, le
calme avait été relatif une partie de la matinée. L'ennemi avait pris un contact
assez lâche entre le château des Hardys-Béhélec et le village de Saint-Marcel.
L'après-midi, en revanche, l'attaque s'étend à ce secteur où les Allemands essayent de
progresser vers l'Ouest. Ils y sont contenus. L'arrivée des bombardiers alliés Vers 16h, le secours demandé à Londres intervient dans les combats. Un escadron de chasseurs
bombardiers effectue des tirs sur les rassemblements ennemis et attaquent à la
bombe les colonnes arrivant depuis plusieurs itinéraires. A 19h00, une violente contre attaque venant du nord-est est déclenchée sur le flanc de l'ennemi. Elle progresse malgré les difficultés du terrain et les réactions allemandes. Le château de Sainte-
Geneviève et ses alentours sont repris. Mais l'ennemi s'accroche au centre du dispositif et il est impossible de reprendre le Bois-Joly.A 20h00, l'action allemande continue à s'étendre. Non seulement, toute la face Est du camp subit la pression, mais le combat gagne le Sud où une attaque se déclenche en
direction des Hardys-Béhélec suivie d'une autre sur L'Abbaye. Le bataillon Le Garrec,
déjà fortement attaqué entre le château et le Bois-Joly, doit faire face à cette nouvelle
action venant du Sud. Les troupes allemandes viennent du camp de Coëtquidan. Elles ont débarquées vers 18h00 sur la RN 776. L'attaque de ces troupes fraîches est extrêmement brutale. Malgré de lourdes pertes pour l'assaillant, elle progresse.
L'artillerie qui entre en jeu et les balles incendières mettent le feu aux bois en
arrière des défenseurs. Une contre-attaque à la grenade menée par le lieutenant Rio,
qui est tué dans l'action, rétablit la situation un moment menacée. Quant au bataillon
Caro qui n'avait pas jusqu'ici pris à partie, il subit de son côté vers 20h00 une dure attaque.
Ces troupes fraîches repoussent durement les Allemands par un feu nourri d'armes
automatiques. A la même heure, le PC de La Nouée apprend que sur tous les
itinéraires des camions amènent des renforts. Le secteur Nord resté calme jusqu'ici semble s'agiter. Les postes avancés voient au Sud de Saint-Abraham les Allemands se masser. Inquiets, le colonel Morice et le colonel Bourgoin tiennent conseil, peu avant la
tombée de la nuit : leurs troupes ont résisté en restant sur leurs position, sauf à hauteur du Bois Joly. Mais la consommation de munitions avait été forte, surtout pour les FM (forces mobiles).
De plus, l'acharnement allemand permet de prévoir que le lendemain, dès le point du
jour, l'attaque en force reprendrait. L'artillerie commence d'ailleurs à se faire
entendre. Ils estiment donc qu'il y a lieu de prévoir un repli. Les ordres de Londres
indiquent que les projets du haut commandement ont été modifiés. Ils prescrivent que maquisards et paras se dispersent tout en continuant la guérilla.
Les ordres du mouvement donnés à la tombée de la nuit du 18 juin ne sont donc
que la stricte exécution des ordres du haut commandement. Le décrochage commence vers 22h00. Il dure une grande partie de la nuit. Les bataillons, après avoir couvert leur mouvement par une arrière garde restée en contact avec l'ennemi jusqu'au départ des gros, se dispersent dans leurs secteurs où ils se disloquent par compagnie voire par section. En l'occurrence, le bataillon Le Garrec prend la direction d'Auray et
Pluvigner, le bataillon Caro la direction de Saint-Jean-Brévelay, Locminé et Josselin, le
bataillon de la Morlaix la direction de Sérent et Pleucadeuc. Les unités
parachutistes se dispersent elles aussi par sections pour aider à la constitution des
douze bataillons FFI du Morbihan.Le PC FFI s'installe à Callac où il continue à diriger la nouvelle phase des opérations à venir : sabotages et guérilla.
Le 19 juin au petit jour, les Allemands comprennent que l'armée qui les avait si durement atteints la veille a disparu. Ils se vengent sur les paysans et détruisent le village de Saint-Marcel, les châteaux et les fermes en nombre. Ils torturent et déportent de nombreuses personnes sans pouvoir toutefois obtenir de renseignements précis sur les combattants. Reste que la portée du combat est importante.
De Saint-Marcel, des liaisons ont été prises avec tous les départements bretons. Les contacts sont conservés avec Londres par les équipes radio du colonel Bourgoin et les parachutages d'armes se poursuivent sur différents terrains à une cadence qui ne se ralentit jamais. Quinze mille hommes sont armés par le 4e régiment de chasseurs parachutistes. Le dernier poste de commandement est Sainte-Hélène où pas moins de vingt nouvelles jeeps armées sont reçues par parachutage et sur planeurs. Sur tout le Morbihan, l'ennemi ne connaît plus le repos. Empêcher tout mouvement aux isolés, harceler les convois, retarder par des destructions tout déplacement de troupes, telle est la mission dont sont chargées les Forces françaises de l'Intérieur du 20 juin au 1er août 1944.
Elle est remplie malgré les représailles, les tortures, les fusillades, les incendies.
L'Allemand est traqué dans les villes. Tout mouvement se heurte à des sabotages et des destructions qui bloquent les convois et les livrent aux coups de l'aviation alliée.
Jusqu'au jour de la Libération, plus un train ne circulera librement en Bretagne...
D'après Le Maquis breton et le Bulletin des
Amicales FFI du Morbihan, juillet 1947LE BILAN
Trente Français furent tués et soixante blessés. Ils furent évacués au cours de la nuit et dispersés dans les fermes. Malgré les perquisitions et les menaces allemandes, tous ceux qui avaient besoin de soins
chirurgicaux furent opérés et soignés en clinique. Les pertes ennemis furent estimées selon une fourchette très large d'une petite centaine à 560 !
Si les estimations tendent vers 70 tués allemands (50 morts et 20 disparus), il est difficile en revanche d'évaluer les pertes des soldats ukrainiens et georgiens faits prisonniers sur le front Est et enrôlés dans les
armées du Reich. Une certitude : le chiffre de 560 avancé après la guerre ne tient plus.
Ces pertes étaient dues à l'imprudence des attaquants qui sous-estimèrent les capacités de défense françaises et furent fauchés en masse dans le champ de blé par les armes automatiques. Les Français relâchèrent leurs prisonniers. Cet acte eut des suites tantôt heureuses, tantôt malheureuses. Les
prisonniers avaient pu connaître les noms des chefs de l'orgaisation. Les Allemands s'en servirent pour les traquer. Il est intéressant de constater dans le rapport de la Feldgendarmerie de Ploërmel que les
troupes qui les combattaient "n'étaient pas des terroristes, mais une armée hiérarchisée et bien tenue". Les Allemands admettèrent pour la première fois, sur les arrières de la bataille de Normandie, l'existence d'une
force réelle qui leur infligea des pertes cruelles. Elle était en relation constante avec l'Etat major interallié puisqu'elle avait fait venir l'aviation dans le combat. Cette armée fut d'autant plus dangereuse qu'ils ne
connaissaient pas l'effectif ni les positions. votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique